Que se passe-t-il devant le tableau, la photographie, l’œuvre d’art contemporaine ? Le critique et professeur honoraire de l’université de Genève Laurent Jenny revient inlassablement à cette interrogation que l’observation des œuvres renouvelle d’année en année. La folie du regard est une étape de ce parcours. Comme dans ses précédents ouvrages, à travers des analyses se dessine un certain rapport aux images, celui d’un savant se méfiant du trop de savoir. On retrouve avec une vraie joie la voix de l’auteur. Jamais péremptoire, et unique, comme seule l’est celle des écrivains.
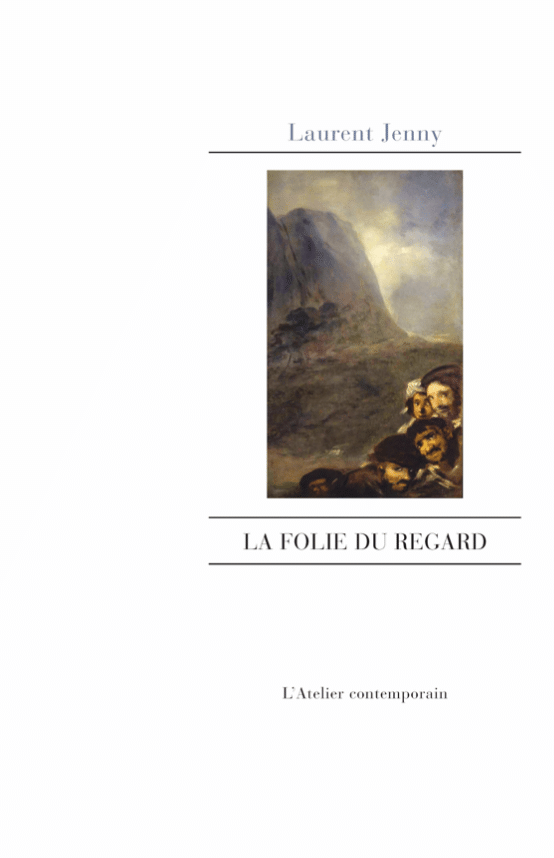
Une dizaine de petits essais sur des œuvres hétérogènes, allant de Lascaux à Giacometti en passant par Cranach, Penone, Seurat, Paul Strand, Fragonard… Dans l’ensemble, du célébrissime. Fallait-il ajouter une nouvelle couche interprétative ? A la manière d’un exercice de pensée, et de plaisir, l’auteur a sélectionné du très connu, mais pas pour faire valoir son talent d’herméneute, pourtant grand. Ce lettré nous invite à nous désencombrer l’œil face aux œuvres, postulant que le savoir, historique, sociologique, iconographique, fait apparaître autant qu’il masque une image. Revenant, par exemple, sur L’œil du Quattrocento de Baxandall, Laurent Jenny émet des doutes non pas sur la teneur de cet ouvrage décisif mais sur ses effets sur le regardeur. Comprendre les raisons qui présidèrent à la création d’une œuvre ne nous aide pas à mieux la voir : « La peinture se laisse comprendre, mais peut-être pas voir. » Comme dans son livre précédent, Le désir de voir, l’opposition entre comprendre et voir est structurante.
Cette opposition a des conséquences. Selon Jenny, si les connaissances aident à comprendre l’image, il faut pourtant s’en défaire pour voir. Jenny nous appelle à déchausser nos lunettes : « Il s’agit, pour voir, de creuser des jours dans un écran de mots. » Les mots des autres, les mots des savants, ou de l’opinion. Face à Fragonard, Jenny le montre d’abord bien embaumé dans son image de peintre galant, pour en faire ensuite saillir l’étrangeté. Des arbres trop hauts, l’obscurité anormale d’une frondaison, un chaos souterrain. Quelque chose d’autre se trame au-delà des préconceptions. Même chose avec Matisse, chez qui l’auteur détecte une claustrophobie latente derrière la lumière. Parfois, les meilleurs accompagnements ne suffisent pas. L’auteur raconte ainsi comment il tente de pénétrer Courbet par l’entremise des mots d’un autre peintre. En vain : « Même après que Soulages m’a désigné ces rares ouvertures, je reste vaincu par le sentiment d’une obturation de l’espace sans espoir... »
Non seulement les discours n’aident pas à la vision mais ils pourraient même la parasiter. Il faut être un lettré respecté comme Laurent Jenny pour se livrer à une telle mise à l’écart du savoir. Comme pour dire, placidement, que la critique d’art peut le rendre « attentif » à tel ou tel aspect de Courbet pris dans sa dimension historique, « mais c’est sur une ligne très différente de l’impact sensible qu’une œuvre peut avoir sur moi ». Le punctum produit par une œuvre a sa valeur propre. « Voir » aurait lieu lorsque advient cet impact. Si cet impact n’est pas de l’ordre du cognitif, il n’est pas non plus pure sensation ressentie face à l’image.

Le problème reste de définir la nature de cette troisième voie. Si l’on perçoit ce que comprendre veut dire chez Jenny, l’auteur définit moins nettement le terme voir. Plaisir éprouvé face à l’image ? Je-ne-sais-quoi subtil ou ineffable ? Laurent Jenny donne parfois le sentiment de chercher le mystère. Chez Cranach, c’est l’énigme qui a sa préférence : « Ce vide affiché par les Judith qui nous happe et nous entraine sur cette scène mentale indéfinissable. » De même, restituant plusieurs interprétations d’un autre tableau de Courbet : « Ce qui retient mon regard dans le tableau, ce n’est pas l’interprétation finale satisfaisante, c’est au contraire sa puissance d’énigme maintenue. » Ont sa préférence les œuvres qui résistent à leur identification à un genre pictural. Celles qui font achopper la rationalisation du discours interprétatif sans susciter pour autant de plaisir sensoriel. Ces images ne se laissent pas assigner à résidence, elles font trébucher. Portrait d’une aveugle par le photographe Strand, tableau inquiétant de Goya où l’on se retrouve regardé par des personnages… Autant de mises en image de l’acte de voir qui mettent en doute notre maîtrise et notre facilité à saisir, dans tous les sens du terme, une image. Pourquoi un tel intérêt ? « L’ébranlement de la vision est un préliminaire à la reconnaissance que le champ du regard n’est ni commun, ni paisible, ni même défini. » Jenny met en garde contre les discours qui pacifient l’image en l’expliquant, la faisant apparaître comme une sorte de rébus ou de problème à régler grâce à des grilles interprétatives qui en rendraient la signification également limpide pour tous.
Ici, Jenny approfondit une conception déjà explorée dans La vie esthétique : en parallèle du regard savant ou informé, il existe un regard qui n’appartient qu’à nous, mais qui ne se livre pas naturellement. Notre rapport le plus intime aux œuvres s’atteint grâce à un « délestage» de notre propre savoir. C’est en cela qu’il n’est pas « commun ». « Voir» serait voir en propre, selon des modalités qui n’appartiennent qu’à nous. Cette appropriation est une question de temporalités. Face à deux immédiatetés, celle du sensible et celle de l’identification de l’œuvre, Laurent Jenny appelle à ne pas se presser : « Le retentissement d’une image tient aussi à son opacité, à la lenteur de son émergence, à sa réserve de visibilité qui ne diffuse que progressivement, ébranlant peu à peu mémoire et imagination. » « Voir », cette action qu’on imagine si instantanée, consisterait en un cheminement sourd, presque inconscient. Au lieu d’assigner un sens pour s’assurer la maîtrise de l’œuvre, le regardeur devrait laisser agir l’œuvre en lui.
Refus de la maîtrise absolue, appel au ralentissement, mise à distance de l’idée de choc esthétique comme de l’érudition… Sans être une méthode ou une technique, on voit dans cette position tant éthique que politique face à l’œuvre une certaine relation dénuée de consumérisme, de scientisme ou de mysticisme. Une relation patiente avec ces objets qui peuvent nous révéler à nous-mêmes.












