Cinquième ouvrage de Simon Johannin, Le dialogue est un texte inclassable génériquement, qui propose une exploration complexe et touchante des sentiments et du corps à travers un échange amoureux entre deux voix à l’identité inconnue. L’auteur propose un travail toujours plus poussé sur la langue et les sensations.
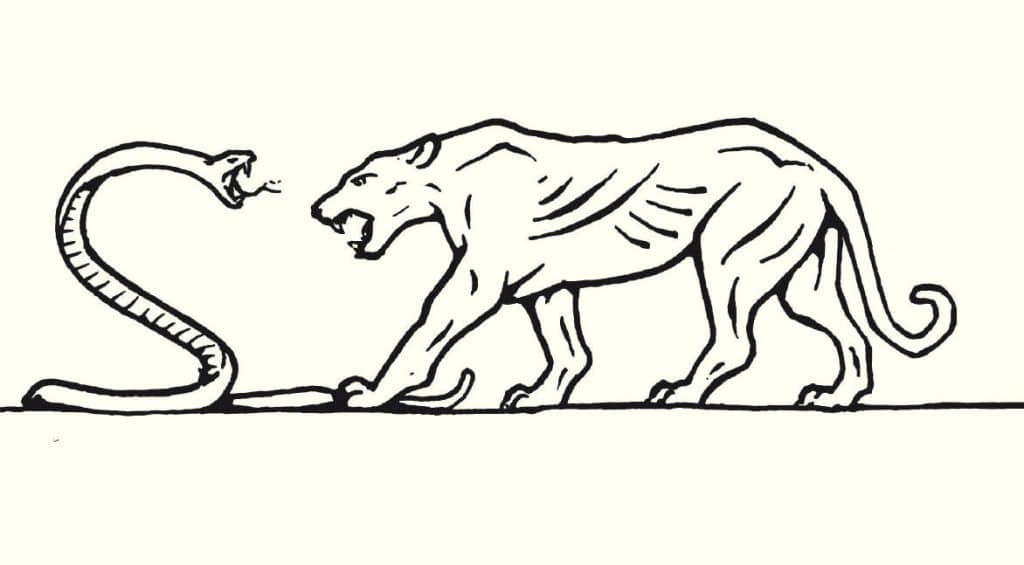
Le travail de Simon Johannin consiste en une exploration formelle radicale, tant au sein du roman que de la poésie. Le travail énonciatif est représentatif de cette exploration : dans Nino dans la nuit, centré autour de deux jeunes gens, le récit à la première personne du personnage masculin cédait fréquemment la place à la deuxième personne au moment d’évoquer le personnage féminin. Loin de se réduire à une adresse du protagoniste à son amante, la longueur et la fréquence de ces passages leur donnaient une réelle autonomie qui aboutissait à la création d’une seconde voix narrative. Les deux recueils poétiques Nous sommes maintenant nos êtres chers et La dernière saison du monde exploraient quant à eux la forme de la poésie amoureuse, genre marqué par le lyrisme et donc l’emploi privilégié de la première personne. L’auteur subvertissait cette forme, notamment par une insistance sur des sensations extérieures, qui se manifestaient presque de manière impersonnelle dans leur objectivité, mais aussi par un usage appuyé du « tu » qui, pas plus que le « je », ne désignait un locuteur défini et stable.
Le texte est tout entier traversé par l’inquiétude de vivre, de perdre l’autre, de retourner au silence […]. Il y a chez Simon Johannin une érotique de la parole, une envie de parler pour le seul désir de parler.
Cette recherche à la fois d’un contre-lyrisme et de ce que serait une écriture à la deuxième personne se poursuit dans Le dialogue, qui établit de prime abord deux locuteurs, deux points de vue, cette fois-ci fixes et matérialisés dans le corps du texte par le tiret. Le dispositif du livre est en réalité plus complexe : les locuteurs ne sont jamais nommés ni situés, le dialogue débute in medias res, et la répartition de la parole n’est jamais explicitement liée à un locuteur. Le lecteur doit dès le départ identifier chacune des voix puis maintenir son attention pour suivre sur la durée l’alternance des répliques, ce qui est loin d’être facile. Il en résulte un brouillage subtil des voix, qui finissent par se mélanger. La situation d’énonciation elle-même est obscure : un couple dialogue mais nous ne pouvons que deviner son histoire par quelques indices. Enfin, des didascalies, rares, parasitent par moments le dialogue, comme si une troisième voix, ordonnatrice du discours mais absente, épiait cette situation dont le lecteur se fait le voyeur.
Le texte est tout entier traversé par l’inquiétude de vivre, de perdre l’autre, de retourner au silence, inquiétude qui est précisément ce qui suscite le désir de toucher et de parler. Ce désir constitue la matrice du dialogue : « Je voulais sentir ta peau. Elle m’appelait. J’ai senti sous ta peau le feu qui brûlait. Tu portes en toi le feu froid, le feu chaud, le feu de tous les feux. Tu portes en toi une formule magique. Ta peau avait l’air douce mais ton regard fuyait, alors je suis venue. »

Il y a chez Simon Johannin une érotique de la parole, une envie de parler pour le seul désir de parler. Cette approche de la poésie est ce qui confère au texte toute son intensité puisqu’il exprime et en même temps enregistre la sensation de ce désir. Le dialogue propose ainsi de capter le vivant qui jaillit de l’amour et de la mort. En ce sens, l’image de la charogne, qui fera songer autant à Baudelaire qu’au premier roman de Simon Johannin, offre une image dense du lien étroit entre vie et mort :
– Quand on est mort, on est pourri de vie.
– Les vers qui mangent les morts sont vivants, on leur laisse la place. Là où il y avait la vie en nous, il y a maintenant les vers qui vivent, et tout le cosmos qu’on avait dans le ventre se répand dans les airs, dans la terre et dans le ciel autour.
– C’est beau ce que tu dis, ça donnerait presque envie d’être un cadavre.
Ce n’est qu’au seuil de la mort que l’on peut accéder à une intensité de vie supérieure, ce n’est que dans la maladie que l’on peut penser la grande santé. Le dialogue explore sensoriellement ces paradoxes ; l’autre, parce qu’il est un manque et une blessure, permet de faire l’expérience de soi : « Je suis comme toi, je sens des choses, et je n’ai pas les réponses. Certaines vérités du monde sont en moi et passent par ma bouche. Je crains que tu t’éloignes, je voudrais que tu m’attaches à toi. »
Le dialogue est donc la transcription magistrale d’affects et d’inquiétudes que la forme du livre incarne tout en rejetant tout lieu stable d’où le lecteur pourrait poser une interprétation. En un sens, Simon Johannin illustre ce que disait Susan Sontag dans son article de 1964, Against interpretation : « In place of a hermeneutics we need an erotics of art ». L’amour, la mort et le désir ne sont pas traités comme des concepts que l’on peut penser, mais bien comme une réalité matérielle que l’on peut ressentir, toucher et surtout qui met en mouvement des corps. C’est finalement le spectacle de ces corps qui constitue toute la joie éprouvée à la lecture du texte.
Cet article a été publié sur Mediapart.












