Trieste est un mythe et, comme pour bien des mythes, la vision que nous en avons est déformée et partielle. Nous connaissons les grands noms, Svevo et Saba, nous méconnaissons tous ceux qui ont vécu, écrit dans cette ville ou sa périphérie, Bazlen, Slataper, Stuparich ou Quarantotti Gambini. En nous entretenant avec sa traductrice, Murielle Morelli, nous redécouvrons cet écrivain mort en 1965, et son roman, Premières armes, qui se déroule en 1919 à Semedela, quartier de Capodimonte. Aujourd’hui, la ville se nomme Koper, et elle se situe en Slovénie. C’est une partie de l’Histoire.
Le golfe de Trieste est désormais une frontière, pour autant qu’il en existe dans l’espace Schengen, entre l’Italie et la Slovénie. Frontière, le mot est toujours resté vain : les Slaves, les Autrichiens et les Italiens ont toujours formé la population de cette zone singulière de l’Italie. Être triestin est en soi une idée. Mais des spécialistes de l’Italie diront la même chose de la Sicile, de la Sardaigne, et sans doute de la Campanie ou de la Lucanie.

Le personnage principal de Premières armes est un enfant de dix ans. Il passe ses vacances avec ses grands-parents dans un grand domaine. Une escouade s’est installée là, dans une maison appartenant à la famille, à la fin de la guerre. Pas d’officier parmi ces recrues venues du Piémont, de Toscane, des Pouilles. L’ennui règne, on se dispute, on se moque, et un certain Crippa joue le rôle de bouc émissaire. Il est sale et tenu pour stupide, presque l’idiot du village dont il est originaire. Face à lui, Frangisacchi n’est pas des plus sympathiques. Il fascine et révulse le jeune garçon. On le surnomme Lupo, et le sens de ce mot est multiple.
Conducteur d’un camion, il sera, avec Piveroni, le responsable d’un grave accident, voire d’un meurtre, celui de Nerina, une jeune fille. L’un des enjeux de l’intrigue sera de savoir qui a tué. Et puis il y a Borsarelli, un Toscan qui, pendant la guerre, a combattu parmi les « arditi ». Ces derniers, des têtes brûlées assez semblables aux corps francs sévissant dans les terres baltes vers 1918, formeront l’armature du Parti fasciste. Autrement dit, la grande histoire est là, en arrière-plan, avec ses promesses de chaos.
Mais tout ce que le lecteur apprend, il le tient de Paolo ; les perceptions du garçon, ses interprétations des faits qui émaillent le récit, sont incertaines, parfois contradictoires. Il découvre, il apprend, souvent il ne comprend pas. Draga, la servante slovène qui vit dans le domaine, est brutalement renvoyée. L’enfant la revoit, bien des jours après. Elle a de l’argent mais il ne comprend pas très bien comment elle l’a gagné. Il ne comprend pas non plus les jeux de mots, les chansons, les allusions des soldats. Cela tourne le plus souvent autour du sexe, de ses mots et gestes. Le mariage de Crippa dans son village, les remarques sur ses « cornes », le dépassent. Autant que la présence de sang sur un matelas, dans le camion qu’habite Crippa, et qu’emprunte Frangisacchi.
Souvent Paolo entend sans voir, et son témoignage sur la mort de Nerina est au mieux confus, au pire contradictoire et dangereux pour les accusés. Nous laisserons au lecteur le soin de démêler le vrai du faux. Ce roman est aussi un roman policier, avec ses faux coupables, ses vrais assassins (mais pas seulement assassins) et ses rebondissements.
L’essentiel reste – comme souvent chez Quarantotti Gambini – la place donnée à qui apprend, découvre, s’initie. Paolo voit sa grand-mère revenir d’Autriche. Elle avait les cheveux noirs, ils sont devenus gris, au terme de la détention. Il assiste au retour de Toni, le valet chargé de la jument Fuga et des voitures. L’homme avait été renvoyé pour alcoolisme ; le grand-père lui a pardonné. Et c’est, pour l’enfant, comme si ces prestigieuses voitures étaient des carrosses de conte. On est entre roman « réaliste », situé en un lieu et un temps précis, et imaginaire lié à cet espace sans limite, aux immenses peupliers qu’on y voit, à tout le paysage et aux animaux qui le peuplent. C’est un roman touffu, dense et concis, comme l’est le monde de Paolo. Il apprend, il décrypte, il saura.
Afin d’en savoir plus sur Quarantotti Gambini nous avons questionné sa traductrice, Muriel Morelli.
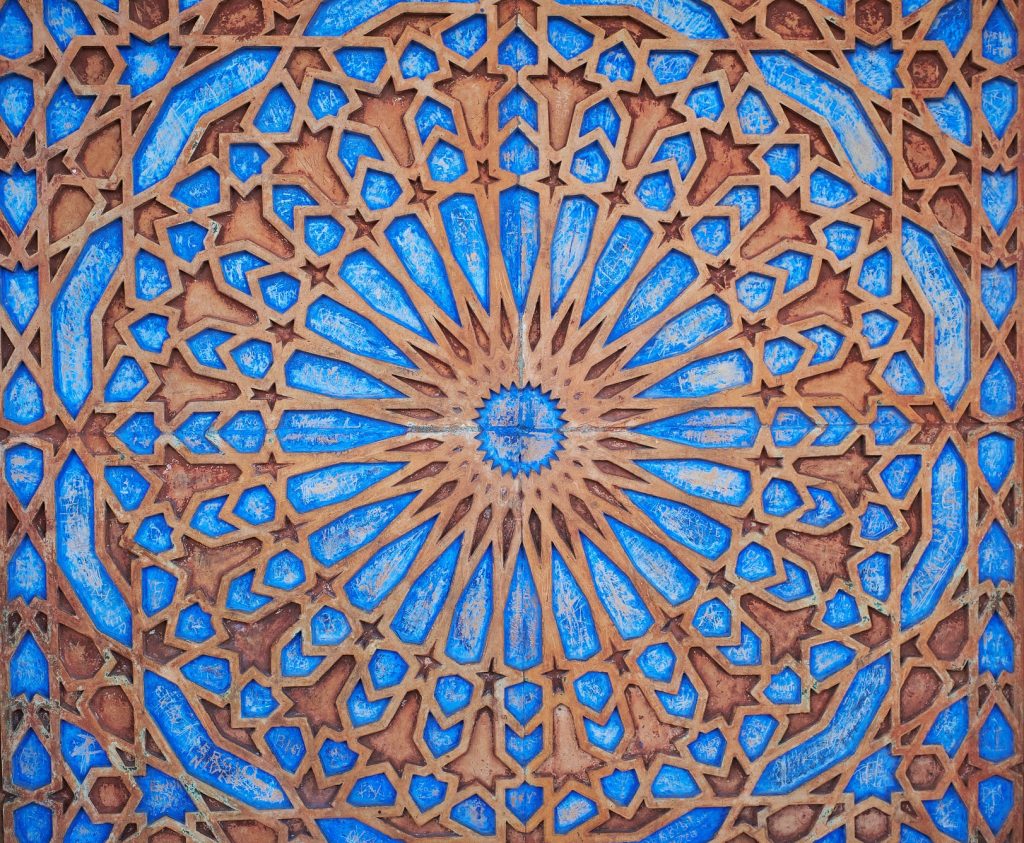
Dans la « constellation » triestine, Quarantotti Gambini occupe une place importante, ne serait-ce que par son lien avec Umberto Saba avec qui il a correspondu. Pouvez-vous évoquer le romancier et poète qu’il était ?
En effet, Gambini publie ses premières nouvelles grâce au soutien de Saba, de presque vingt ans son aîné, qu’il rencontre à Trieste en 1929. Les deux hommes resteront très liés, en témoigne leur correspondance publiée après leur mort sous le titre Il vecchio e il giovane (Le vieux et le jeune), en 1965. Ils vont échanger intensivement pendant la période de rédaction des Régates de San Francisco, c’est d’ailleurs Saba qui trouve le titre du livre, L’onda dell’incrociatore (La vague du croiseur), évoquant la vague du désir qui frappe les jeunes protagonistes du roman. On retrouve chez les deux écrivains un intérêt pour les éveils brûlants de l’enfance et de l’adolescence, sans doute sous l’influence de la psychanalyse qui a fait son entrée en Italie par Trieste grâce au psychiatre Edoardo Weiss, dont Saba est un patient fervent.
Après le succès des Régates de San Francisco (Prix Baguta 1948), qui se déroule à Trieste dans les années 1930, Gambini écrit Premières armes (1955) puis Le cheval Tripoli (1956), deux romans situés à Semedela, en Istrie, dans le domaine de son grand-père maternel (dont il prendra plus tard le patronyme, Gambini) où il a passé son enfance et son adolescence. L’écrivain envisage de les rassembler dans un cycle intitulé Anni ciechi (Les années aveugles), auquel s’intégrera Le redini bianche (Les rênes blanches) publié à titre posthume en 1967. Dans cette trilogie, Gambini remonte le cours de son enfance à travers le personnage de Paolo, de plus en plus jeune au fil des romans. En 1958, il publie La vie ardente, porté à l’écran quelques années plus tard. Il meurt d’une crise cardiaque à Venise à l’âge de 55 ans en écrivant des vers. Ses deux recueils de poésie, Une histoire d’amour et Soleil et vent, seront publiés après sa mort.
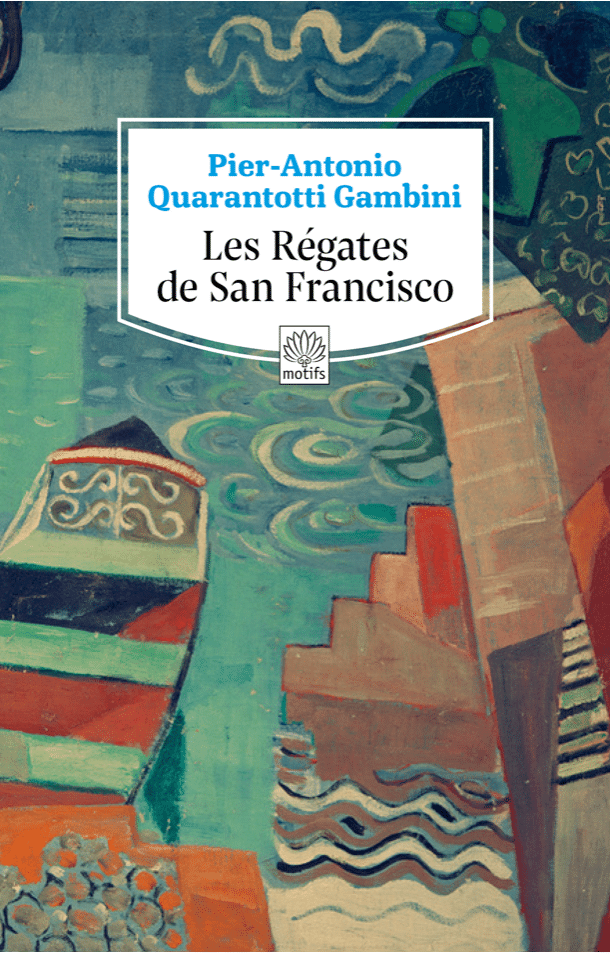
L’enfance et l’adolescence, voire l’état de jeune adulte, sont ses thématiques préférées, par exemple dans Les régates de San Francisco.
Les enfances et les adolescences racontées par Gambini se forgent dans un contexte complexe et mouvant : l’Istrie, région multilingue sous domination austro-hongroise, passe à l’Italie puis à la Yougoslavie ; pendant la Première Guerre mondiale, les Istriens italophones espèrent la victoire de l’Italie, mais quand les Italiens arrivent, ils apportent bientôt le fascisme et de nouveau la guerre. En choisissant de raconter l’histoire à la troisième personne du point de vue de l’enfant, l’auteur nous plonge dans un trop-plein de réel. Ce que voit ou entend un enfant excède ce qu’il peut comprendre, et c’est ce décalage entre vécu et compréhension, où se glissent angoisses, désirs et fantasmes, qui fait la matière littéraire de Gambini. Dans Premières armes, Paolo est un témoin extraordinaire, il enregistre les faits et en expose tous les possibles justement parce qu’il n’en a pas les clefs d’interprétation.
Le désir et le sexe tiennent dans l’œuvre de Gambini une place prépondérante et, à le relire aujourd’hui, on mesure combien il fut un peintre précis de la construction du masculin. Une masculinité agressive souvent animée par l’orgueil blessé, comme dans Les régates de San Francisco où les deux jeunes mâles frustrés Ario et Berto fomentent une action punitive contre la fille qui leur échappe et son amant qu’ils envient. Dans Premières armes, l’enfant Paolo absorbe sans comprendre les expressions des jeunes soldats où l’acte sexuel se décline sur le registre de la prédation jusqu’à ce qu’il assiste à un « passage à l’acte » dont la responsabilité pourrait être collective.
Trieste et l’Italie, ce n’est apparemment pas tout à fait la même chose, quel lien notre écrivain entretient-il entre ces deux pôles ?
Trieste était une ville au carrefour des cultures germanique, latine et slave, mais nombre de Triestins au début du XXe siècle étaient irrédentistes, ils souhaitaient être rattachés au royaume d’Italie. Gambini fait partie d’une génération qui grandit dans le mythe d’une Italie salvatrice, possiblement républicaine, et qui déchante aussitôt avec la montée du fascisme. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Italie et la Yougoslavie de Tito se disputent l’Istrie, et, à la suite d’une période de flottement sous contrôle de l’ONU, l’Italie ne gardera que Trieste qui se verra ainsi coupée de son arrière-pays. Pour Gambini, la partition est douloureuse, les lieux de sa jeunesse sont tout proches mais désormais inaccessibles, sinon à travers la littérature. Et il assiste à l’exode de milliers d’italophones (et de slaves aussi) fuyant la Yougoslavie de Tito pour s’entasser dans des camps de réfugiés près de Trieste. Pour lui comme pour de nombreux Triestins, le communisme n’est plus désirable, aussi se sent-il en décalage par rapport à ses compatriotes écrivains proches du Parti. De plus, en 1945, Gambini est licencié de son poste de directeur de la bibliothèque Hortis de Trieste, car soupçonné (à tort) de connivence avec le fascisme. Les lettres de soutien d’Umberto Saba, de Giani Stuparich et autres intellectuels triestins n’y changeront rien. L’écrivain s’installe définitivement à Venise avec le sentiment d’avoir perdu sa ville, à laquelle il consacrera deux récits : Printemps à Trieste (1951) et Lumières de Trieste (1964).
Vous avez gardé dans la langue d’origine (le triestin ?) un certain nombre de mots. Pour quelle raison ?
Ces mots en langue vénitienne ou istriote, proche du vénitien, étaient en italique dans le texte original et parfois suivis d’une traduction italienne de l’auteur intégrée au texte. Ils ont donc été mis en exergue par Gambini qui, par ailleurs, n’utilise pas le dialecte dans sa prose.
Grâce à cette traduction et édition, nous redécouvrons cet auteur assez prolixe. Envisagez-vous d’autres publications ?
La plupart de ses œuvres ont été traduites aux éditions Gallimard par Michel Arnaud dans les années 1950 et 1960 ; sa poésie a été publiée chez l’Age d’Homme par Laïla Taha-Hussein dans les années 1980. Parmi les romans, seul Les rênes blanches, qui clôt le magnifique cycle de Paolo, est inédit. Nous envisageons en tout cas de rester dans cette région de l’Italie en publiant d’autres écrivains de frontière.












