Et si les courses de têtes du Roi-Soleil avaient offert un poème cinétique concret, dont ne s’approchent aujourd’hui que les manifestations de rue ? Autour, cette fois, d’un « soleil cou coupé » assurément plus sombre. Approche double, critique et concrète, d’un renversement d’astre, signée Emmanuel Rubio, à qui aucune des facettes de la lettre n’échappe.
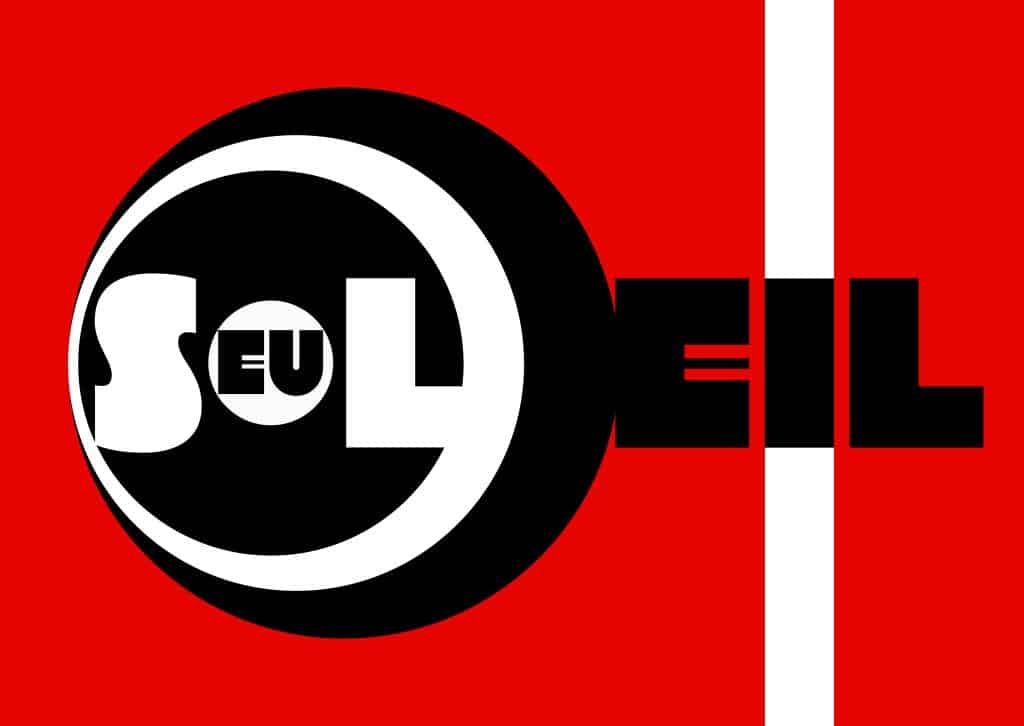
On ne peut toujours faire la guerre et y briller. Mais les loisirs, par bonheur, offrent l’occasion de s’y préparer et d’y exceller avec moins de risque. On y reconnaît les véritables grands hommes. Ainsi de cette « course de têtes et de bague » organisée en 1662 en l’honneur du roi Louis XIV, qui put y démontrer ses talents équestres. La noblesse y était réunie pour y prendre des têtes du bout de la lance. Des têtes de Turc, de Maure et de Méduse. L’exercice était moins périlleux que celui des tournois, qui avait coûté la vie au bon roi Henri II d’un coup de lance dans la visière, mais permettait d’en maintenir la mémoire. Le lustre n’y était pas moindre et l’ensemble des cavaliers, répartis en quatre quadrilles, romain, turc, persan, indien, pouvait figurer un monde tout entier paré de somptueux atours. Chacun aussi bien, à côté de la lance, portait l’écu où s’inscrivait sa devise.
On prête peu d’attention aujourd’hui à ces devises, que d’aucuns jugeraient volontiers disparues du champ littéraire. À l’époque, ces associations d’un motif dessiné et d’une sentence, assez brève pour tenir sur un écu, font pourtant l’objet de traités et de recueils. Elles appartiennent, avec les maximes, les aphorismes, à cette littérature de la densité à laquelle le XVIIe siècle se sera tant consacré, et avec tant de brio. Avec les emblèmes, les énigmes, les médailles même – auxquelles Colbert entendait prêter la plus grande attention –, elles participent encore d’un genre hybride, tendu entre texte et image et qui, par bien des aspects, se prolonge dans cette poésie contemporaine qu’on dira volontiers concrète, tant elle fait de part à la physique de sa lettre, visuelle, pour le goût qu’elle a de l’image, ou spatialiste, pour citer Pierre Garnier, qui consacra naguère un recueil entier au dialogue avec les devises peintes du merveilleux château de Bussy-Rabutin, en Bourgogne. À moins que l’on n’y cherche les ancêtres des logos.
Il eût en tout cas été malheureux qu’un tel spectacle que cette course de têtes se perdît pour la postérité ou les yeux de l’étranger, qu’il importait d’impressionner en attendant de le défaire. On en fit un livre, dont le texte fut confié à Charles Perrault, déjà premier secrétaire de l’Académie des Inscriptions et des Médailles, et la réalisation à l’Imprimerie royale. L’ouvrage est splendide, tant par sa typographie que par ses gravures. Les cavaliers y paradent toujours, sous ces costumes enchanteurs que Perrault décrit avec une minutie sans pareille. Et c’est ainsi, également, que l’on découvre les devises, reproduites, retranscrites, traduites et même commentées, jusqu’à emplir bien des pages.

Le tout présente un ordre si imposant, si assuré, qu’on ne sait plus très bien, à force, ce que l’on regarde : les devises des quadrilles, ou de nouveaux quadrilles de devises. Les fêtes et décors du Roi-Soleil sont tellement prévus pour ce second temps de la propagande livresque qu’on finit par les percevoir en elles-mêmes comme de véritables textes. Et quel texte, ici, que celui tout en mouvement des devises parcourant en tous sens le champ de course ! Quel merveilleux poème cinétique, bien supérieur assurément à ce morceau d’épopée en latin, entièrement tourné vers le passé, qui vient conclure l’ouvrage.
Les traités rapportent souvent les devises aux amours entendues ou secrètes. Ici frappe pourtant la constance du thème solaire. Miroir ou arbre au soleil, dont le premier tient tout son éclat et le dernier toute sa substance (« Soli » [« À lui seul »]), aigle visant le soleil (« Probasti » [« Vous m’avez éprouvé »])… On n’en finirait pas d’énumérer les exemples de ce type, et les devises finissent par se ressembler étrangement, la variation primant sur l’originalité absolue : combien de miroirs, de girasols tournant avec le soleil ? De phénix soumis à ses rais autant qu’à leur bûcher ? « CAUSA PLACET » (« La cause m’en est agréable »), « UNUS CUNCTA MIHI » (« Lui seul m’est toute chose »).
À tout prendre, le thème solaire ne s’oppose guère au cadre amoureux. Le contexte en décide pourtant tout autrement : c’est autour du Roi-Soleil que s’organise cette cour de sentences tout à sa gloire. « UNO SOLO MINOR » (« Le soleil seul est plus grand que moi ») déclare la lune pleine de Monsieur, qui commande au deuxième quadrille. Et sous le croissant de lune du prince de Condé, qui dirige le troisième : « CRESCIT UT ASPICITUR » (« Il augmente selon qu’il est regardé »). Il n’est jusqu’aux multiples feux en tous genres, classiquement passionnés, que le commentaire officiel ne rapporte presque exclusivement au champ politique, pour son érotisation maximale. « Je brûle quand on me regarde », déclare cet énième miroir : « ce chevalier assure que son courage redouble, selon qu’il est regardé de son prince ou de sa maîtresse ».
La Course de têtes et de bague offre peut-être le poème solaire le plus assuré, le plus politique qui soit, ou plutôt son reflet, tant le mouvement devait prêter de grâce à ces lignes. L’or et l’argent font la matière des costumes, plus distribués au fur et à mesure qu’on s’approche du roi tandis que le bleu et le noir envahissent l’ailleurs. On comprend mieux la précision des descriptions de Perrault : ces éclairs d’or et d’argent devaient donner à la parade toute sa dimension stellaire. Bien avant le Coup de dés mallarméen, un poème gigantesque, éminemment collectif, se confondait avec la voûte du ciel étoilé. Dans le livre, la devise du roi paraît d’ailleurs trois fois, avec un luxe inouï et des dimensions hors de mesure : une tête solaire, parée de rayons et ces seuls mots : « UT VIDI VICI ». Il n’a plus besoin de venir, comme le faisait encore César : il est toujours là, au centre. Nous lisons, mais c’est lui qui nous regarde.

Que trouverait-on aujourd’hui de comparable à cette physique de la poésie comme rituelle, à cette mise en scène où devises et emblèmes tournoyaient vraiment, cavalcadaient aux rythmes les plus divers ? Pourra-t-on seulement s’imaginer, par-delà le glacis livresque, cette poésie véritablement concrète, où les mots les plus choisis tissaient autour du Roi-Soleil une cosmogonie en élans perpétuels ? Pour en découvrir l’équivalent contemporain, il faudrait peut-être se tourner vers les manifestations et leur chapelet d’écriteaux improvisés. Cartons, drapeaux, bannières tressent là un texte sans cesse mouvant. Le slogan s’est substitué à la devise, mais c’est la même esthétique du resserré, le même bond vers l’essentiel… et le rapport au pouvoir qui toujours prédomine. L’esprit les anime ou tente de le faire. « Tu nous mets 64 on te mai 68 », « Ma pancarte est pourrie, cette réforme aussi ». Le trait est plus satirique qu’édifiant, mais c’est aussi que ces processions-là tiennent plus du carnaval que de la messe et qu’elles commencent d’exercer leur pouvoir propre par le ridicule dont elles drapent les puissances reconnues. Le souverain y figure en carton-pâte, prompt à s’enflammer. Toute noblesse revient à terre, y compris celle des belles lettres : « Si j’avais voulu me faire baiser, j’aurais voté Brad Pitt. »
Que devient le soleil, dans ces conditions ? Il ne brille plus par sa présence. À moins qu’il ne faille revenir, tant la haine du souverain est parfois grande, à cette autre figure solaire, telle qu’elle surgissait au sortir de « Zone » d’Apollinaire : « Soleil cou coupé ». La métaphore, à vrai dire, traverse le XXe siècle comme à la dérobée, le hante et parvient jusqu’à nous pleine d’un noir éclat. Un brouillon de « Zone » lui donnait quelque contexte : « Le soleil est là c’est un cou tranché / Comme l’auront peut-être un jour quelques-uns des pauvres que j’ai rencontrés // Le soleil me fait peur, il répand son sang sur Paris ». Coupée de ces alentours dans la version finale, la formule devient pourtant plus énigmatique. Elle se resserre aussi sur sa lettre : Jean Ricardou aimait à souligner combien le « cou » semblait naître par apocope de « coupé ». Quand le vers reparaît en 1948, tel quel, en couverture d’un recueil d’Aimé Césaire, il est devenu devise, sous la photographie d’un masque africain. Les lettres rouges et noires l’égrènent par morceaux. Mais ce sont les jours révolutionnaires qu’il semble désormais convoquer, en amont des exécutions de droit commun, pour des poèmes que traverse entre autres « la tête du cauchemar fichée sur la pointe de lance d’une foule en délire ».

C’est aussi qu’entre temps Georges Bataille s’est emparé de cette figure solaire paradoxale. « Soleil pourri », paru dans la revue Documents en 1930, rappelle comment l’astre a pu, au cours des temps, être « exprimé mythologiquement par un homme s’égorgeant lui-même et enfin par un être anthropomorphe dépourvu de tête ». Il n’en fallait pas plus pour susciter, quelques années plus tard, le mythe nouveau de l’Acéphale, auquel André Masson prêterait ses traits magnifiques. « La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l’univers. Dans la mesure où elle devient cette tête et cette raison, où elle devient nécessaire à l’univers, elle accepte un servage. » « Au-delà de ce que je suis, je rencontre un être qui me fait rire parce qu’il est sans tête, qui m’emplit d’angoisse parce qu’il est fait d’innocence et de crime : il tient une arme de fer dans sa main gauche, des flammes semblables à un sacré-cœur dans sa main droite. » Ou encore, pour suivre le mode astrologique : « Acéphale est la terre / La terre sous la croûte du sol est feu incandescent / L’homme qui se représente sous les pieds / L’incandescence de la terre / S’embrase / Un incendie extatique détruira les patries / Quand le cœur humain deviendra feu / Et fer / L’homme échappera à sa tête comme le condamné à la prison. »
Terre devenant soleil en se coupant de lui et se retournant sur ses profondeurs, condamné échappant à sa geôle par la décollation même qui semblait le menacer : tout indique une passion violente pour le renversement. Et c’est bien, dans cette inversion généralisée des schèmes classiques, la rencontre des échelles qui signe à son tour la frappe d’un mythe rigoureusement opposé à l’apothéose de Louis XIV. Cette imbrication d’échelles diverses, rien ne la montre mieux que le devenir du groupe Acéphale réuni autour de la revue du même nom. Tandis qu’il évolue d’un côté vers une société secrète à l’horizon sacrificiel, il donne encore naissance au « Collège de sociologie », aux discussions publiques. Là, Bataille et Klossowski évoqueront sans détour le cou coupé majeur : celui de Louis XVI, fondant l’entrée dans un monde de la mort de Dieu. Dès 1936, Bataille entendait bien célébrer l’« anniversaire de l’exécution capitale de Louis XVI » : un tract en atteste, daté du 21 janvier, pourvu d’une belle tête de veau sur plat et de l’annonce d’une conférence sur « les 200 familles qui relèvent de la justice du peuple ». Le Collège de sociologie ne manque pas de rêver d’une société qui sacrifierait annuellement son dirigeant, dans l’équivalent moderne d’un rite de régénération.
Le moment historique n’est pas à négliger. À partir de 1936 et de la guerre d’Espagne, c’est l’ombre d’un conflit généralisé qui plane désormais sur l’Europe. Plus précisément, d’un conflit entre démocraties et régimes dictatoriaux. Face à la brutalité de ces derniers, très évidemment préparés à la guerre, face aussi à la tentation autoritaire qui a gagné une partie de la population, la démocratie peut sembler devoir être profondément réactivée, réancrée dans son histoire et ce qui pourrait être sa mythologie. L’appel à un mythe de décapitation solaire, qui entraînerait avec elle le chef de la communauté aussi bien que son double en chacun de nous, tient là sa véritable économie symbolique, comme un ultime remède en temps de crise.
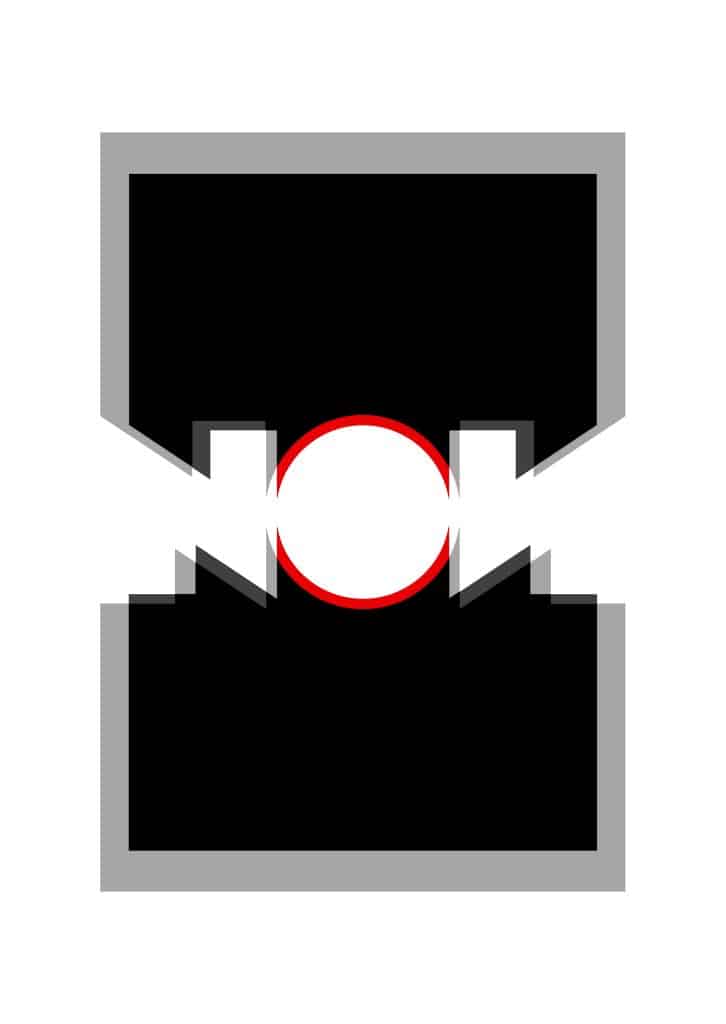
Les temps, avec le retour de la guerre aux portes de l’Europe, la montée en puissance de régimes autoritaires et de l’illibéralisme comme modèle possible, signent peut-être aujourd’hui une sorte de retour. L’angoisse démocratique qui se fait à nouveau jour est-elle comparable à celle qui saisit la fin des années 1930, auxquelles chacun se réfère désormais si souvent ? Ce qui est certain, c’est que ce réflexe de retour à 1793 marque une des caractéristiques des manifestations de ce printemps 2023 et de leur parade de devises. Quelque chose comme une signature. Au lendemain de l’usage de l’article 49.3 à l’Assemblée nationale, c’est « MORT AU ROI » qui fleurit en lettres géantes sur le mur des Tuileries de la place de la Concorde, soit en ce lieu même où se tint son exécution et où, le jour d’après, l’effigie du président de la République est jetée dans un bûcher symbolique. « MORT AU ROI », encore, en lettres presque aussi grandes, sur la colonne de la Bastille, quelques semaines plus tard, et modulé encore sur tant et tant de panneaux. Sans oublier les ballons de tête foulés au pied, les hakas aux doux gestes d’égorgement, ni les chants : « Louis XVI, on l’a guillotiné. Macron, on peut recommencer », que l’on entend désormais couramment. Le cou coupé hante la France. Et avec lui moins un rêve de nuit et de terreur que de lumière rejaillie. Le soleil paradoxal n’attend plus que les poètes pour reprendre sa forme mythologique.












