Soyons pessimistes : notre rapport à la musique est en lambeaux, dans ce piège sans doute faux que nous tend l’opposition entre le récit ancien de la critique musicale et celui des plateformes numériques, où s’opère ce que Guillaume Heuguet appelle une « molécularisation de la culture musicale » [i]. Mais les lambeaux recèlent certaines joies et le monde n’est jamais une tenaille avec seulement deux pinces, comme en témoigne l’effervescence éditoriale consacrée à la musique ces derniers mois. L’un des bouts par lesquels on peut aborder cette masse de parutions serait les textes écrits par les musiciens eux-mêmes.
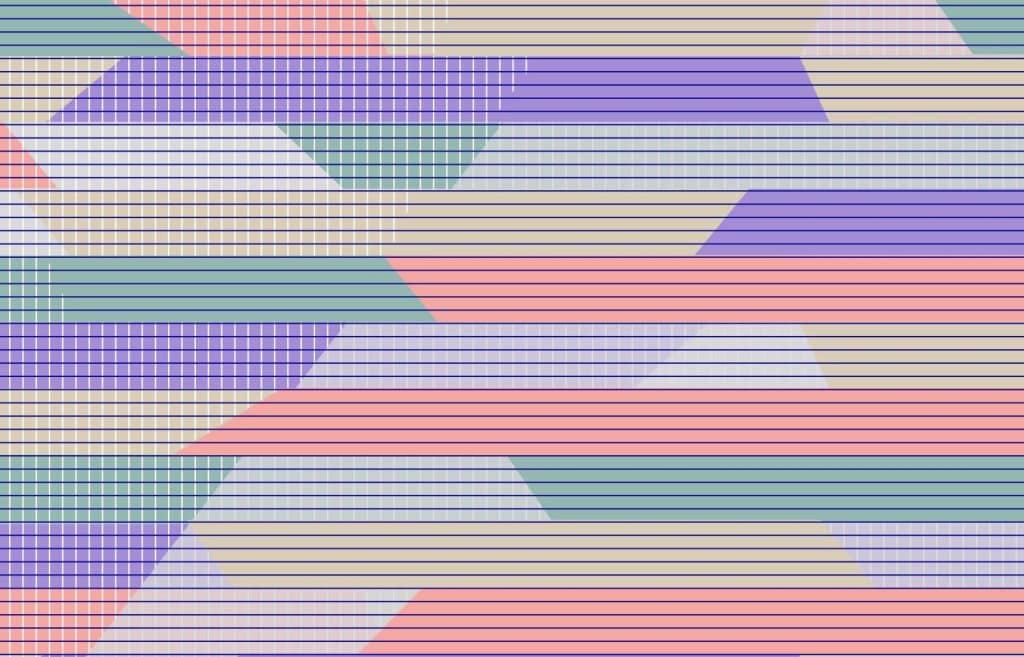
Les Conversations de Steve Reich, magnifiquement éditées et traduites, permettent de se plonger dans la musique qui va bien, à défaut de porter toujours à l’optimisme. Le compositeur états-unien a décidé pendant le confinement de 2020 de faire retour sur son œuvre par un moyen aussi simple qu’efficace : des conversations avec les personnes qui l’ont accompagné durant sa longue et pléthorique carrière. Ces dix-neuf dialogues frappent par leur capacité formelle à déplier les implications de la musique de Steve Reich, à travers le temps et les moyens d’expression, mais aussi à replier les mystères de la création musicale sur la force des liens de celles et ceux qui jouent. La convivialité (sincère ou construite, peu importe) qu’édifie le texte permet de se plonger dans cette complexité avec plaisir, tout en abordant tout ce qui fait souvent problème avec les musiques en question : la technique, le sens et son envers, les concepts et le sensible dans tout ça…
Conversations est exemplaire de ce qu’un texte bien conçu peut permettre pour aller vers la musique et trouver avec elle un rapport approfondi et ouvert. Dit autrement, lire Steve Reich permet de mieux l’écouter, et réciproquement. Ce n’est pas sans précédent (Stravinsky, Schoenberg, Hampton Hawes, et beaucoup d’autres) mais c’est toujours significatif. L’efficacité du récit appelle de légères réserves, notamment dans sa volonté d’exagérer un peu la centralité de la musique de Reich dans de très nombreuses musiques des soixante dernières années : les dialogues avec Brian Eno ou Jonny Greenwood, guitariste de Radiohead, cherchent clairement à attester d’une influence de Reich sur la musique populaire qui est indéniable mais plus marginale (y compris dans le livre) que ce que suggèrent ces échanges. D’ailleurs, ce genre de choses ne se mesure pas.
La plupart des interlocuteurs et interlocutrices de Steve Reich sont ses partenaires musicaux réguliers, souvent de longue date : le chef d’orchestre Michael Tilson Thomas, le percussionniste Russell Hartenberger, la violoniste Elizabeth Lim-Dutton… Les échanges permettent de suivre l’évolution de la musique de Reich et de ses pratiques depuis les premières expérimentations des années 1960 sur bandes magnétiques, dont l’impact se fait encore tant sentir (It’s Gonna Rain et Come Out) jusqu’aux œuvres consacrées au judaïsme (Tehilim, The Cave, Proverb) en passant par les tentations monumentales (The Desert Music) ou les plus fameuses pièces de musique de phase (Clapping Music, Six Pianos). Le plus captivant dans cette perspective est d’entrer dans le point de vue des acteurs de cette évolution vers un enrichissement de la musique de Reich, à tous les points de vue : la radicalité encore spontanée des débuts allait en effet de pair avec une musique conçue dans l’irrévérence amusée de la débrouille, de l’amitié et des alliances constantes avec le jazz, le rock, les caniveaux de New York et les magasins de piano la nuit. La radicalité plus travaillée de la musique plus tardive (grossièrement à partir de la fin des années 1970) est clairement institutionnalisée, ce qui n’est pas du tout vécu comme tel par Steve Reich ni par ses invités.
L’exemple de Robert Hurwitz, président du label Nonesuch de 1984 à 2017, est à ce titre édifiant : l’évidence de l’affection, de l’estime, de l’entraide, est déroulée en même temps que le détail savoureux d’une collaboration entre un producteur et l’un de ses artistes fétiches. Sur un autre plan, pour qui cherche les traces des mises en lambeaux évoquées précédemment, on aperçoit clairement un quiproquo fort autour du travail entre Nonesuch et Reich au cours d’années 1980 où l’industrie du disque est déjà largement reconfigurée, mais où les deux hommes racontent un fantasme de la relation entre le producteur et l’artiste qui n’a certainement pas même existé tel quel dans les années 1960 – celui des risques pris contre la doxa et les frileux, celui qui déjoue les étiquettes, qui conteste les pouvoirs établis, celui qui valorise les « inclassables », dont Steve Reich bien sûr.

« Dans quel bac vont-ils ranger [le disque de Music for 18 Musicians] chez les disquaires ? », demande Steve Reich. « Et la réponse était : “dans trois ou quatre bacs différents” ». Ici, l’insistance des liens entre les univers esthétiques (David Bowie, Pat Metheny le label allemand ECM, les compositeurs contemporains Copland ou Messiaen) a forte valeur de définition pour Reich, qui jubile de situer sa musique à un endroit inclassable. En réalité, le témoignage qu’il offre démontre souvent tout l’inverse en faisant apparaître les liens qui unissent David Bowie, Brian Eno, les enregistrements de musique ghanéenne, et les conservatoires états-uniens ou les orchestres japonais. Ces musiques-là forment ce classicisme radical que Steve Reich a contribué avec d’autres (mais plus que bien d’autres, sauf peut-être John Cage) à installer là où il se trouve bien aujourd’hui : au cœur des institutions classiques, mais perçu comme encore contre-culturel.
La trajectoire de Steve Reich, depuis l’université de Cornell où il écoutait Pérotin, est celle d’une institutionnalisation et, d’une certaine manière, elle en donne les limites autant que l’infinie beauté. Les limites sont surtout symboliques, comme en témoigne l’importance régulièrement accordée aux confrontations entre des univers que le compositeur présuppose distincts : cette musique serait révolutionnaire parce qu’elle influerait sur la musique pop, rock, électro – ce qu’elle fait d’ailleurs – et non par elle-même. Si l’on embrasse les lambeaux, on peut lire Conversations pour y trouver la confirmation qu’en réalité Brian Eno est, aux côtés de Steve Reich, une icône centrale d’un classicisme fondé sur une radicalité, une versatilité a priori.

Depuis bien longtemps, un musicien s’intéresse plus directement à ce qui relie réellement les musiques qu’on tend trop à séparer. David Toop, dont le livre majeur Ocean of Sound (1995, réédité par les éditions de l’éclat en poche l’année dernière) est une porte d’entrée certainement inégalable dans tout ce qu’on qualifie vaguement d’underground musical. On y retrouve d’ailleurs Brian Eno, notamment à travers sa fameuse invention de la musique ambient, dont Toop montre à quel point elle réalise un rêve musical ancien (la musique d’ameublement de Satie) et formalise un phénomène déjà omniprésent (la Muzak et les musiques d’ambiance), tout en se reliant à des expérimentations musicales qu’on ne peut dénombrer (Sun Ra, Miles Davis, John Lennon, John Cage, Charles Ives, Evan Parker, etc.). La lecture croisée des deux ouvrages permet de faire apparaître Eno comme un artiste absolument central d’une recomposition des esthétiques musicales au-delà des questions de genre (rock, classique, expérimental, pop, électro, etc.) ou de situation sociale (underground, officiel, populaire, savant). Brian Eno, c’est au fond une clef commode pour comprendre à quel point un rapport dominant à la musique est structuré autour de l’idée de nouer ensemble le plus commercial (Eno a été producteur de U2) et le plus expérimental. On ne devrait plus s’étonner de ces rapprochements, qui sont la structure même de l’industrie musicale, où tout se touche constamment. Ce qui est classique, ce qui est culte, c’est ce que personne ne connaît encore, ce que tout le monde a oublié, ce qui est massivement à soi.
La démarche de David Toop est d’une certaine manière inverse de celle de Reich dans Conversations, puisque le premier permet d’appréhender la fiction des frontières symboliques entre les musiques là où le second valorise leur maintien. La forme choisie, poétique, fragmentée, trouble, restitue l’impossibilité de s’attacher dans ces frontières symboliques sans une part d’illusion – et l’illusion prend alors une importance démente, puisqu’elle est ce à partir de quoi nous écoutons. Toop a des pages saisissantes sur les techniques et leurs instruments, notamment les célèbres machines de Roland (TB 303 et TR 909) dont il permet de dépasser certains clichés liés à leur rôle de matrice pour certaines musiques (l’acid, la house de Chicago, la techno de Détroit).

La parution d’écrits plus récents de David Toop à travers l’anthologie Inflamed Invisible permet de mesurer autrement l’édification intellectuelle de ces liens, tout d’abord en montrant superbement à quel point l’écriture du musicien anglais, voix et travail d’écrivain, s’élabore dans les espaces sans noblesse où la musique fait écrire : pochettes de disques, blogs, catalogues d’exposition, tous ces médias souvent massivement lus mais rarement estimés. La liquidité du son renvoie aussi à la liquidité des textes, qui se coulent dans bien des interstices, d’où ils exhument des enregistrements et des musiques auxquels il fait bon se rapporter : ceux qui soulignent le travail pionnier des compositrices dans l’histoire des musiques électroniques (Pauline Oliveros, très connue, ou les plus confidentielles Daphne Oram et Lily Greenham), ceux qui inventent une compréhension commune fascinante entre la peinture, la littérature et la musique.
Les textes les plus récents d’Inflamed Invisible font apparaître un intérêt croissant pour les musiques électroniques produites par le label allemand Raster Noton, notamment les œuvres de Ryoji Ikeda et Carsten Nicolai (aussi connu comme Noto, Alva Noto, Aleph-1). Les productions Raster Noton sont certainement parmi les plus singulières et influentes du XXIe siècle, comme en atteste le livre étonnant qu’édite le percussionniste et musicien français Sylvain Darrifourcq, dans la forme, proche de celle choisie par Steve Reich, d’un dialogue avec un ami. Dans 20 000 mots, Darrifourcq se livre à une auto-analyse qui n’a pas d’équivalent pour un musicien français venu des musiques improvisées et du jazz. Au sein de cette analyse, marquée par un regard exigeant et influencée par la sociologie bourdieusienne, les musiques de Raster Noton apparaissent comme une ouverture esthétique vers d’autres possibilités musicales au moment où le sentiment de tourner en rond gagne le musicien.
On retrouve ainsi un sentiment étrange mais euphorisant à voir se tisser des alliances entre les formes et les références musicales qui caractérisent des façons collectives de se rapporter à la musique, comme des lambeaux qu’on rapetasse sans savoir si les autres vont savoir les nommer et les entendre. D’une certaine manière, la musique de Carsten Nicolai, Ryuichi Sakamoto ou Ryoji Ikeda apparaît comme la convergence d’une histoire réellement underground et déjà classique – au sens où elle fait autorité sur les plans esthétiques, commerciaux (ces enregistrements se vendent) et politiques (Sakamoto a composé, par exemple, le thème des jeux Olympiques de Barcelone [ii]). Jean-Louis Comolli évoquait en 1965, à propos de Charles Mingus, une « musique innommable autrement que par elle-même » : l’institutionnalisation dont Steve Reich nous fait involontairement le récit montre que bien des musiques se sont conçues comme nommables dans l’excès de noms, exclusivement par elles-mêmes. Cette question du nom agite la musique et en cela elle se relie à une inquiétude commune qui la place au cœur du monde, dont l’on dispute du nom (Anthropocène, effondrement, post-vérité et post-tout) avec le sentiment d’en perdre la préhension. Les lambeaux de musique sont à la mesure de tout ce qui est lacéré.
Si l’on veut faire voler en éclats les frontières symboliques auxquelles ce texte donne lui-même une énorme importance, on peut aussi aller écouter des disques. Par exemple celui-ci : Prends le temps d’écouter (1962-1982), musique d’expression libre dans les classes Freinet (Born Bad Records), dans lequel on entend des enfants inventer librement des musiques. La question que nous posent ces enfants est la possibilité réalisée de traverser toutes ces frontières pour jouer de la musique, lambeaux ou pas. Sans doute cela en fait-il un disque d’une importance extrême, éminent contrepoint des évidences qui nous dépassent et nous brutalisent, en affirmant que la musique est là, prête à être saisie.
[i] Audimat, n° 17, p. 10.
[ii] Sakamoto, décédé en mars 2023, était célèbre au Japon pour sa musique, depuis sa participation au Yellow Magic Orchestra, mais aussi pour ses engagements politiques nombreux : contre le nucléaire, contre des projets inutiles, contre l’invasion russe de l’Ukraine, etc. Il est également connu pour avoir composé la musique du film d’Alejandro Gonzalez Iñárritu, The Revenant.











