Si Chris Kraus est aujourd’hui un écrivain célèbre, il le doit notamment à La fabrique des salauds qui connut partout un grand succès. C’est pourtant Danser sur des débris qui le fit connaître en Allemagne, son premier roman écrit quinze ans auparavant, aujourd’hui republié et pour la première fois traduit en français. Il raconte l’histoire d’une famille allemande originaire des Pays baltes, compromise avec le régime nazi, chassée en 1945 lors de l’arrivée de l’armée soviétique et réinstallée en République fédérale. La critique de la famille et de la société qu’on peut y lire, toujours aussi percutante par-delà les années, jette les premiers jalons d’une œuvre à venir et n’est pas sans rappeler Mars de Fritz Zorn, bénéficiaire lui aussi d’une renaissance tardive : dans les deux cas, il s’agit d’un premier roman, mais Fritz Zorn n’en écrivit pas d’autres, la mort annoncée ayant mis un terme prématuré à sa carrière.

Comme pour Mars, en effet, le roman est celui d’un individu qui rejette sa propre famille, sans pour autant renier sa filiation. Il est à son corps défendant à la fois dehors et dedans, car « c’est à la douleur qu’on sait qu’on est chez soi. Pas au nom sur la sonnette ». Comme dans le cas de Fritz Zorn, celui qui écrit pour dire son malheur est proche de la mort. Mais ici, une greffe de moelle prélevée sur un donneur compatible peut encore tout arranger : et où trouver celui-ci ailleurs que dans la parentèle ? La comparaison trouve bien sûr ses limites, et, à la différence de Fritz Zorn, Chris Kraus a pu profiter de son succès. D’autres personnages qu’il a imaginés sont d’ailleurs pareillement malades ou blessés, comme le Jonas de Baiser ou faire des films : est-ce pour mieux souligner leur vulnérabilité, leur rapport douloureux à un monde qui lui-même ne va pas bien ?
Belle revanche en tout cas, Danser sur des débris est aujourd’hui un des fleurons de la grande maison d’édition Diogenes qui l’avait refusé en 2002… La genèse du roman est racontée avec beaucoup de verve par Chris Kraus lui-même, dans une postface dédiée à l’épisode rocambolesque qui le conduisit il y a plus de vingt ans chez Günter Grass, en compagnie de Volker Schlöndorff. Portant un regard amusé sur ce voyage aux allures d’équipée, et égratignant au passage l’aura de ces importants personnages, l’auteur narre les circonstances dans lesquelles il fut alors contraint d’abandonner très provisoirement ses projets cinématographiques (rien de moins qu’une suite au film multiprimé Le tambour !), pour s’essayer à un premier roman qui, une fois publié aux éditions Frankfurter Verlagsanstalt, devait lui ouvrir les portes de la réussite et lancer véritablement sa carrière d’écrivain.
Les premières pages s’imposent par leur concision, leur style nerveux, imagé, le rythme que Chris Kraus imprime à sa narration : en fait d’exposition, on est brusquement immergé dans l’action, quelques détails bien sentis suffisent à camper les personnages et l’intrigue se met en place sans détours. Rien de plus naturel, sans doute, que cette façon de faire pour celui qui a étudié à l’Académie allemande du film et de la télévision, et songe surtout à écrire pour le cinéma : ce sont les circonstances décrites dans la postface qui incitèrent le scénariste à se faire romancier, et il mit sans peine apparente ses qualités et sa formation au service d’une écriture différente, plus ample. Ce changement n’eut d’ailleurs rien d’irréversible, puisque Danser sur des débris fut rapidement adapté pour l’écran et ajouta un titre supplémentaire à la filmographie de Chris Kraus.
Les personnages principaux de ce premier roman portent les mêmes noms que ceux qu’on retrouvera quinze ans plus tard dans La fabrique des salauds. Ici, la famille Solm expulsée des Pays baltes a pris la tête d’une entreprise de ciments – dont mieux vaut ne pas savoir ce qu’elle a contribué à construire quand les nazis étaient au pouvoir. Gebhard Solm, le père, la dirige depuis sa villa près de Mannheim, véritable forteresse grand luxe à l’abri des intrusions où il vit dans l’opulence avec son fils aîné, Ansgar, issu d’un premier lit, sa deuxième femme Stiefi et les enfants qu’il a eus avec elle, Comenius et Sandra, rebaptisés Khomeyni et Saddam par leur demi-frère au moment de la guerre Iran-Irak… Humour grinçant qui cache bien des tensions et que cultive volontiers cette famille retranchée sur elle-même, alors qu’on devine aisément quelque cadavre caché dans un placard, ou quelque énigme à résoudre : une tête de lézard incluse dans un bloc de résine, découverte par hasard au fond d’un tiroir, pourrait servir d’indice, mais il reste longtemps indéchiffrable…
Des tableaux suspendus aux murs de la maison rappellent Riga ou la Courlande, le pays natal des aïeux. Gebhard est d’ailleurs allé jusqu’à installer dans son jardin un curieux dallage fait avec les ruines des tombes familiales rapportées des environs de Jöhvi (dans l’actuelle Estonie), où elles avaient entre-temps servi à construire un four. Une profanation qui en dit long ! Mais le retour de ces nobles vestiges dans la propriété des Solm, voulu comme un hommage aux ancêtres, n’échappe pas aux sarcasmes des plus jeunes qui donnent malicieusement à ces pierres reconverties le nom de « mosaïque Blut und Boden », le sang et la terre, sinistre allusion au Troisième Reich et à l’obscur passé nazi de la famille.
Le narrateur s’appelle Jesko. Frère d’Ansgar, à la fois styliste et journaliste de mode, il porte volontiers une jupe (qu’il juge plus confortable qu’un pantalon), et ne se sépare jamais de son Sénèque. Vivant loin des siens depuis des années, son retour au bercail n’est dû qu’à la greffe de moelle qu’il espère : les autres membres de la famille n’étant pas des donneurs compatibles, il ne reste plus qu’à tester sa mère, Käthe, la première femme de Gebhard. Le seul hic est que cette femme est folle, qu’elle boit, qu’elle s’est clochardisée au fil du temps et que nul ne l’a revue depuis une vingtaine d’années… Qu’importe, les Solm ne manquent pas d’entregent, ils la retrouvent, et Jesko le mouton noir découvre au début du roman sa propre mère gisant blessée et ligotée sur une table de ping-pong, comme une pièce de gibier ou mieux : comme un sac de ciment Solm. Par une véritable ironie du sort, mère et fils devenus étrangers l’un à l’autre se retrouvent plus que jamais et malgré eux réunis par les liens du sang ! Mais Käthe est-elle encore en état de comprendre ce qui se joue ? « Parvenir jusqu’à elle était impossible, elle était enfermée dans un tonneau d’années que personne n’arrivait à ouvrir. »
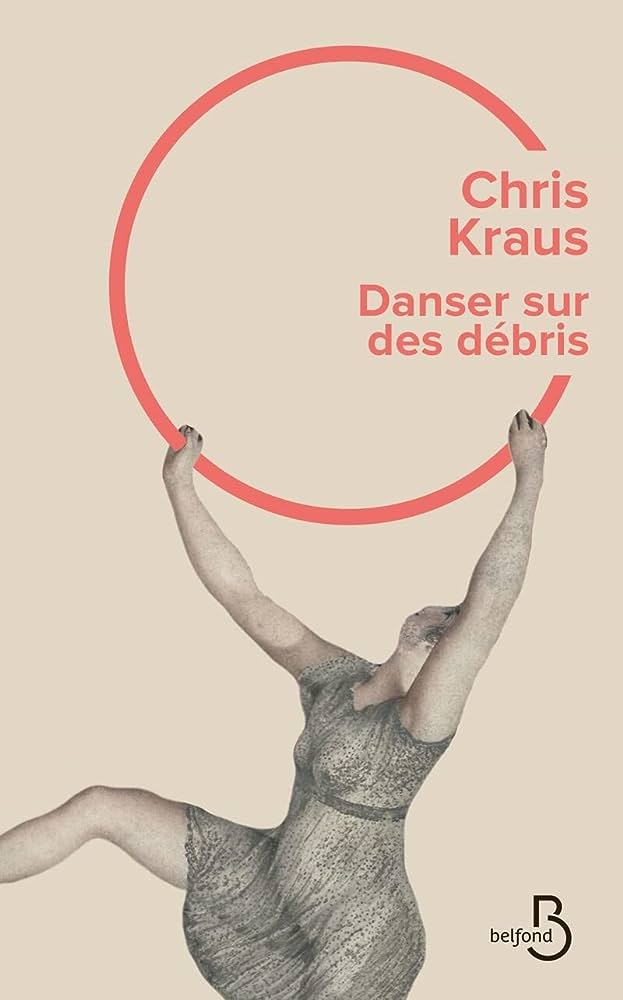
Rassemblés sans joie excessive pour sauver Jesko, les membres de la famille Solm ne cessent alors de s’attirer et se repousser dans une triangulation impossible, où les hommes savent confusément qu’ils portent dans leurs gènes aussi bien la même nostalgie du pays perdu que le même poids d’un passé coupable. Est-ce cela qui a rendu folle la femme de Gebhard ? Le roman explore méthodiquement les relations qui se nouent et se dénouent entre les personnages à l’intérieur de cet espace restreint que constitue la demeure familiale, flanquée d’une méchante cabane où on a littéralement remisé Käthe, personnage haut en couleur dont la folie n’est peut-être pas due qu’à elle-même. Son cerveau n’est d’ailleurs pas suffisamment dérangé pour empêcher tout éclair de lucidité, libérant ainsi des vérités pas toujours bonnes à entendre… Et les non-dits concernant le grand-père « Apa », exécuté jadis par les Russes au bord de la Baltique, contribuent à brouiller le jeu. L’ancienne complicité entre les deux frères, Jesko et Ansgar, est mise à mal. Stiefi est déstabilisée par le retour de la première femme de Gebhard. Quant à « Cigogne », la fiancée d’Ansgar engagée auprès de Käthe pour ses compétences d’infirmière, elle peine à trouver sa place dans cette famille dont la façade ne cesse de craquer sous la pression des conflits mal refoulés : Jesko, justement, l’admire pour sa discrétion, pour sa faculté naturelle à « rester en dehors d’une vie ». Les chapitres du roman s’enchaînent ainsi comme les plans d’un film, jusqu’à ce qu’entre en scène, en un ultime rebondissement, un autre personnage féminin, la mystérieuse Renate qui aurait peut-être de quoi dénouer la situation.
La tension que Chris Kraus a créée dès le début du roman ne se relâche pas, le ton de la narration est suffisamment varié pour qu’un excès de sérieux ne vienne jamais plomber l’atmosphère. Entre Jesko, fils tragique et pince-sans-rire, et Käthe, mère truculente et attachante jusque dans sa folie, une place est toujours réservée à l’humour, l’ironie, la justesse d’un bon mot, voire la loufoquerie, qui prêtent à sourire au plus fort du drame. Mais il y a aussi de belles surprises dans les mots de Chris Kraus, des trouvailles que Rose Labourie, la traductrice, a su mettre en valeur : quand la menace se dessine, il peint par exemple d’une phrase « le vaste rouge du ciel, comme si Dieu s’était coupé la gorge pour se répandre aux quatre coins du monde ». Et quand il se sent au fond du trou, le narrateur se voit volontiers comme « une calotte polaire qui fond lentement pour faire le malheur des hommes ».
Chris Kraus fait ainsi pénétrer le lecteur dans un véritable huis clos où tous ceux qui sont rassemblés, même si c’est pour la bonne cause, sont partagés entre haine et amour, dans une grande confusion de sentiments. Un passé mal assumé pèse sur la famille Solm, sa charge ne s’allège un peu que lorsque Gebhard, l’actuel chef de famille, dévoile l’épisode fondateur de leur malaise diffus, où la perte du pays natal se confond avec la culpabilité du grand-père. Le roman familial ouvre alors sur un grand roman historique, auquel Chris Kraus apportera quinze ans plus tard un prolongement éclatant avec La fabrique des salauds.












