Jungles, de Patrick Roberts, est un livre que j’ai mis longtemps à lire, tant le sérieux de sa documentation, la précision de ses analyses et surtout l’ampleur de son sujet requièrent une lecture attentive et qui ne ménage pas le temps nécessaire à l’extraordinaire abondance des justifications qu’il apporte à son plaidoyer en faveur de l’urgence des décisions à prendre en matière d’écologie.
Jamais ennuyeux, aussi impeccable par sa rigueur académique (le jeune auteur, formé à Oxford, est directeur d’un département d’archéologie au célèbre Institut allemand Max Planck) que par la fervente flamme militante qui l’anime, ce livre porte un titre modeste : Jungles, qui semble en restreindre la portée à une étude de l’histoire évolutive des forêts tropicales.

En réalité, à travers un sujet censé ne concerner qu’un secteur limité de la réalité – même pas toute la couverture forestière de la planète mais uniquement celle des forêts chaudes, sèches ou humides, de la zone tropicale du globe –, il visite d’abord chronologiquement l’apparition puis la diversification, enfin la situation actuelle du vivant sur terre. Les premiers chapitres rappellent, à grands traits certes mais sans schématisme (une gageure !), les étapes de ce continuum biologique, de l’algue à la forêt, celle-ci et ses larges surfaces lacustres ou ses rives marines se peuplant peu à peu d’animaux qui la façonnent à leur manière sans la mettre en danger de façon durable. Toute cette première partie constitue un excellent manuel de paléontologie, dont la maîtrise pourrait servir de base éducative à bien des étudiants spécialisés en « sciences naturelles ».
Puis un jour le genre Homo, qui émerge d’une faune très différenciée de presque semblables, finit par s’imposer et les malheurs de la forêt commencent. Car l’une des originalités du texte – au moins pour moi – est de démontrer à l’aide d’exemples que l’influence exercée par notre espèce prédatrice sur la végétation qui l’entoure ne date pas de la révolution industrielle, mais coïncide en fait au moins avec les débuts encore timides de l’Homo faber, l’homme fabricant, artisan qui a su assez vite utiliser ses pouces opposables pour empaumer de gros cailloux, les transformer en enclumes (ce que savent d’ailleurs faire les singes supérieurs), tailler d’autres cailloux en outils et surtout en armes, bref c’était parti pour une guerre fraîche et joyeuse (ça, c’est moi qui le dis, l’auteur ne manie jamais la facétie, personne n’est parfait).
De cette très ancienne antériorité de l’exploitation du vivant, plantes et bêtes, par le futur agriculteur-pasteur-guerrier, découle une conséquence majeure et c’est la première vérité peu mise en lumière jusque-là que découvre Patrick Roberts en parcourant les « jungles » considérées en général comme inviolées, bien à tort : il n’existe, en effet, aucune agglomération forestière tropicale, où que ce soit (Asie, Afrique, Amériques), qui n’ait été exploitée par l’homme et cela depuis la plus haute antiquité. Bien plus, ce ne sont pas seulement des villages de quelques cases que l’archéologie découvre dans les coins les plus « sauvages », et apparemment inhospitaliers, de la planète actuelle, mais de véritables villes que seul leur abandon, pour des causes variées et parfois difficiles à mettre au jour, a dissimulées longtemps sous la réinstallation d’un couvert végétal dense.
Ce n’est évidemment pas dans les régions d’habitat les plus anciennes, du temps des premiers Sapiens, et encore moins des Néandertaliens, que l’on peut observer de tels faits. D’ailleurs, il faut attendre l’agriculture et l’élevage pour que l’idée de ville ait un sens, et cette transformation-là s’est donc opérée loin des Tropiques. Mais les exemples, à l’époque historique, de la création de villes fortement peuplées chez les Mayas, chez les Khmers, prouve que la forêt tropicale a pu nourrir de vastes populations, au prix de grands travaux (adduction d’eau, voies de circulation, etc.). Cette exploitation de la forêt a produit ses effets néfastes, mais ceux-ci sont restés relativement modérés.

À partir de ce type de constat, à la fois négatif (l’empreinte humaine sur l’écologie de la planète ne date pas d’hier, elle a même pu accroître l’effet de serre dès le Moyen Âge, l’activité pré-industrielle ayant peut-être empêché le « petit âge glaciaire » des XIIIe-XVIIIe siècles en Europe d’évoluer vers une véritable glaciation, ce qui a été, par hasard, bénéfique) et positif (on peut user de la forêt tropicale sans la détruire), la suite des chapitres aborde la catastrophe présente et tente d’esquisser une ou deux recettes pour éviter son emballement définitif.
On trouvera ici des raisons de désespérer, et le ton de l’auteur, toujours très réaliste et exempt de pathos, n’en devient pas moins véhément sur le fond, en essayant de rapprocher de l’expérience commune de ses lecteurs supposés (tous ceux auxquels l’idéal américano-européen de croissance à tout prix, inséparable des prétendues lois du capitalisme financier, n’a pas collé des œillères inamovibles) des pronostics établis par les spécialistes du climat.
D’où il ressort qu’il n’est déjà plus temps de se fixer des objectifs minutieusement calculés de réduction des gaz à effet de serre, objectifs inatteignables, l’accélération vertigineuse des phénomènes étant une évidence que n’accompagne pourtant aucune prise de conscience universelle. La seule attitude raisonnable pourrait être de se souvenir que telle civilisation antique a su plus ou moins bien préserver l’intégrité des forêts tropicales tout en utilisant leurs ressources, et de faire confiance à ce qui reste, au sein des populations non occidentales, de savoirs anciens inoubliés pour, en s’appuyant sur leurs conseils (au Sri Lanka, à Bornéo, au Brésil, en Afrique), tenter de retarder au moins un peu la dérive des températures mondiales et leur cortège de calamités avérées (ouragans, typhons, incendies, élévation des mers, sécheresse galopante).
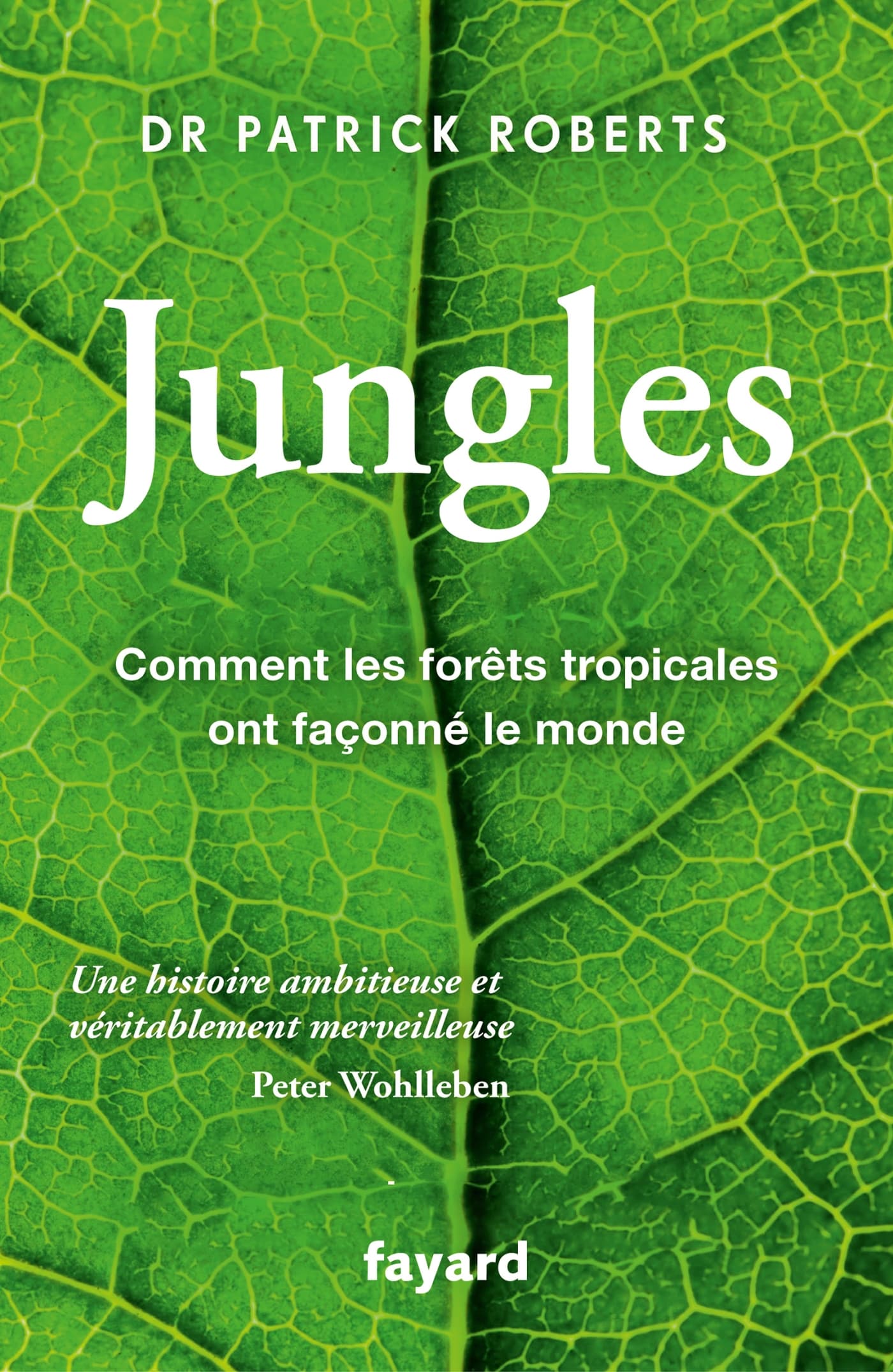
Vaste programme ! Actuellement impraticable tant il suppose une évaluation globale des méfaits de ce que Fourier, ce précurseur génial, nommait avec horreur « Civilisation » et que, en bon réaliste contemporain, Patrick Roberts rebaptise « capitalisme américano-européen ». Le mérite de cette dénomination tient à son pouvoir de critique radicale du modèle d’exploitation de l’homme par l’homme mis au point et appliqué inlassablement par l’Occident depuis 1492 et la désastreuse découverte des Amériques par Christophe Colomb. Désastreuse non pas seulement par le génocide des empires « indiens » qu’elle entraîna, mais par ses conséquences à très long terme sur l’état actuel du monde.
La traite de millions d’Africains, l’esclavage de tout ce qui restait d’habitants valides au Mexique et au Pérou après la « réussite » des conquistadors chrétiens, l’afflux d’or et d’argent en Europe, aliment premier de la révolution industrielle : notre apocalypse, programmée par l’avidité occidentale, a été prodigieusement accélérée par l’inconscience qui a présidé à la gestion, qu’il vaudrait mieux nommer digestion, d’une richesse tropicale (notamment celle des forêts) que l’on a commencé à dilapider à la fin du XVe siècle.
Je grossis à peine le trait de ce livre essentiel, qui établit clairement l’immense responsabilité de l’Occident capitaliste (j’ajouterai chrétien et aveuglément lapiniste) qui a méprisé et méprise toujours, malgré l’évidence de la faillite de son système productiviste et totalitaire, les populations « inférieures » des Tropiques, et leurs savoirs ancestraux acquis au prix d’une maîtrise de la nature qui avait su se contenter d’une demi-conquête.
Patrick Roberts est anglais, et scientifique rigoureux, d’où un style presque constamment porté vers l’understatement. L’ampleur de la tragédie écologique dont nous avons déjà joué les premiers actes sur le dos des « indigènes » des terres lointaines, mais dont le cinquième acte nous entraînera au gouffre avec eux, le contraint néanmoins à hausser parfois le ton jusqu’aux accents d’une Greta Thunberg. Qu’il en soit remercié, au moins en tant que « vox clamans in deserto ».












