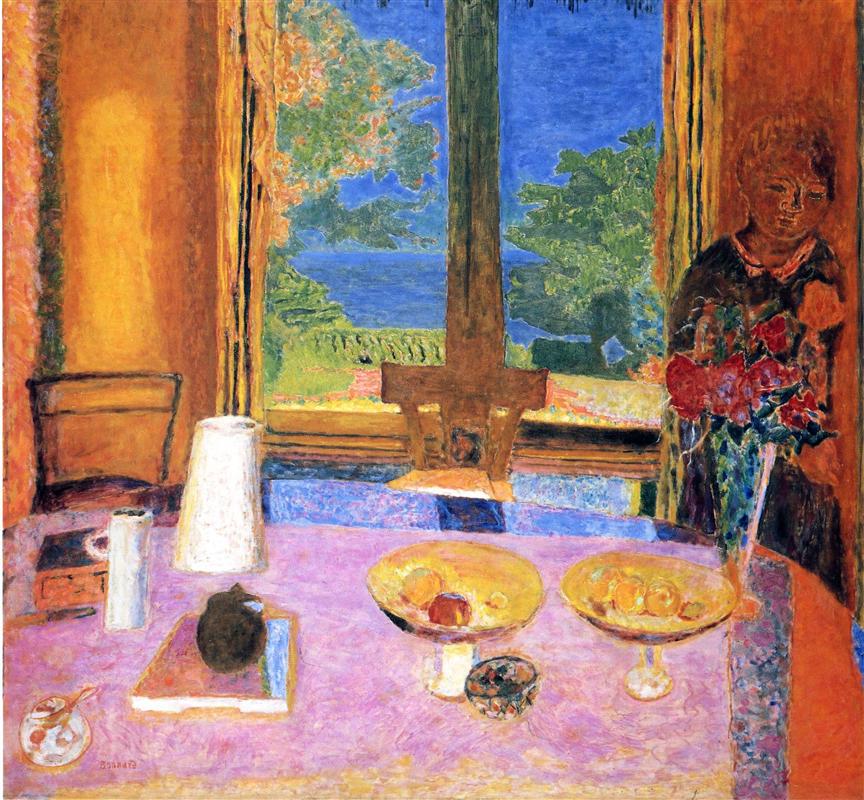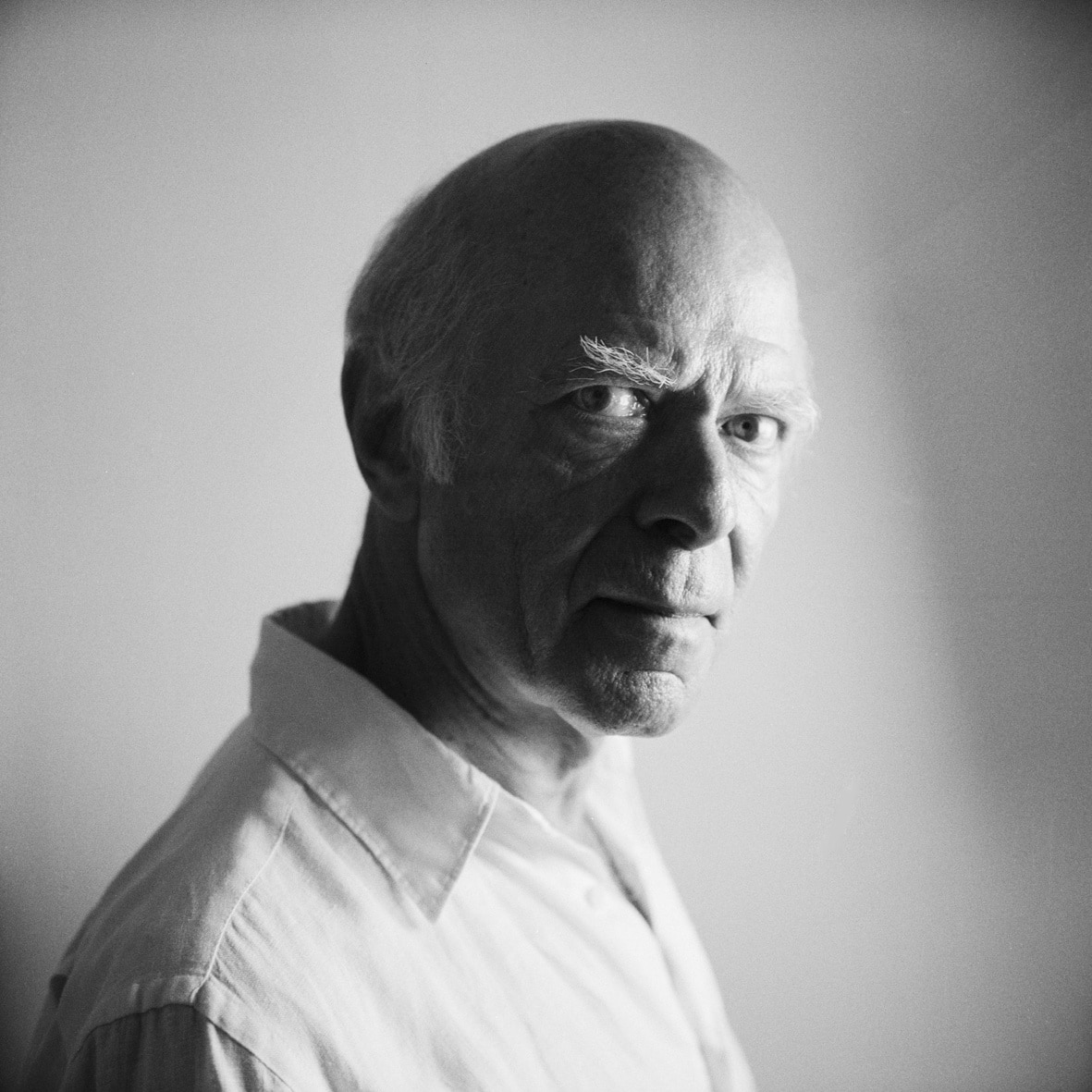« Va vivre. Va vivre ailleurs et ne reviens plus. Je préfère que tu sois vivant loin de moi, même à jamais loin de moi, plutôt que mort ici, dans ce pays, dans mes bras », dit la mère à son fils, qui vient de tâter des geôles du « Père Fouettard de la Nation ». Kossi Efoui quitte alors le Togo, avec la bourse de création récemment obtenue, pour la France où débute sa vie d’exil. Quand, une trentaine d’années plus tard, en un Avignon festivalier, il apprend par un appel de son frère que leur mère se trouve à l’hôpital « où l’on enterre les vivants », le dramaturge et romancier compose, entre désarroi et réponses aux questions de ses enfants qui orchestrent le récit, une œuvre de mémoire bouleversante et superbe de simplicité.

Un jour de la prime enfance, alors que la mère revient d’un champ loin de la maison familiale, le pagne usé qui arrime son fils à son dos se déchire soudain en deux. L’enfant tombe à terre sans un cri et conserve ouverts de grands yeux étonnés jusqu’au retour au domicile. Palpé, massé, ausculté sous toutes les coutures par sa mère follement inquiète, et ne souffrant finalement d’aucun dommage, il en gardera la réputation d’être un garçon « aux os chétifs », comme le signale quelques années plus tard son père, avec une préciosité voulue, au maître d’école à la « langue haut perchée », qui pour sa part qualifiera l’élève tantôt de « débile », tantôt de « poète ». Et, au grand dam du père, il en conservera un privilège : être porté au dos jusqu’à ses six ans, bien au-delà de l’âge habituel. Ce qui donne lieu à un autre privilège, dont nous lecteurs bénéficions : comme ces moments n’ont pas été effacés par l’amnésie infantile, il se souvient des heures blotties « squelette à squelette », et demeure ainsi « en résonance continue » avec les vibrations de la voix et du corps maternels.
Faire fi des déchirures et des frontières : l’écrivain y aura été précocement entraîné. Né officiellement en 1962 à Afoin au Togo selon ses papiers d’identité, il a en réalité vu le jour sur une route de l’exil temporaire de ses parents, quelque part sur la côte du golfe de Guinée, dans un village de pêcheurs ivoirien aujourd’hui disparu de la carte, où « seuls l’océan et le vent ont enregistré cette naissance, nulle mairie ». Pour avoir eu l’océan et le vent pour parrains, il demeurera définitivement à distance de toute assignation. Son départ du Togo, où sa participation au soulèvement populaire contre le régime d’Eyadema père lui fait courir un risque mortel, prend l’allure d’un tour de passe-passe : son passeport confisqué, il n’a droit qu’à un simple carnet de voyage. Pourtant, par la grâce de l’émeute, le passeport lui sera restitué, en France, quelque temps plus tard, providentiellement retrouvé par de jeunes protestataires du quartier dans un commissariat mis à sac, puis acheminé par une amie voyageuse.
Il est parti nanti par sa mère d’un double viatique : avant tout, aller, vivre et devenir ; puis « écrire sur le mensonge » (le premier mensonge, c’est celui de la langue coloniale) ; et pourvu, toujours par sa mère, d’une devise empruntée à Amadou Hampâté Bâ, qui disait lui-même la tenir de sa propre mère : « Les personnes de la personne sont innombrables dans la personne. » Ce sont les questions démultipliées de ses enfants (six prénoms, à différents âges, de la petite enfance à la trentaine) qui le ramènent à son tour à cette « région incendiée de [son] passé ». Un dispositif d’exposition quasi dramatique qui, tout en subvertissant un mutisme fréquent chez les exilés à l’égard de leurs descendants, contribue à révéler à ses propres yeux « cet autre moi-même qui ne se laisse voir que par autrui ». Il entre ainsi de l’art poétique dans cet essai autobiographique, à la fois récit de filiation et de deuil, rompant avec les masques de la fiction empruntés jusqu’alors par le romancier, jusque dans Cantique de l’acacia (Seuil, 2017), déjà une ode à la puissance des femmes ouest-africaines. D’ailleurs, l’écrivain livre au détour d’un chapitre cette théorie personnelle des « trois visages », exposée aux participants d’un atelier d’écriture qu’il animait : le premier est celui que l’on compose face au miroir et à autrui ; le deuxième, placé sous le regard intérieur, est celui à qui l’on dit tu ; le troisième, c’est lorsqu’on se dépasse et qu’on se surprend soi-même.

Ainsi le récit de filiation n’a-t-il rien d’une déploration funèbre. C’est plutôt une conversation que l’œuvre a perpétuée : « Chaque mot de cette nébuleuse qu’il me faut bien considérer comme une œuvre est le prolongement d’un jeu en forme de conversation en deux langues avec ma mère. ». Quand le narrateur est encore enfant, la formule magique maternelle réside en une question : « Qu’est-ce que tu apprends dans la langue de l’école ? » Ainsi, elle sait ouvrir un espace de traduction annihilant toute hiérarchie entre langues dominante et dominée. Ce véritable « exorcisme » parvient à « défaire la question » de la langue coloniale. On partait pourtant de loin : l’écrivain rappelle que, tout comme d’anciens écoliers de provinces françaises jusqu’au mitan avancé du siècle dernier, « à six mille kilomètres et cinquante ans de distance » avec une Bretonne âgée qu’il a rencontrée, et après entre autres l’Ivoirien Bernard Dadié qui écrivit en 1950 dans Climbié (Seghers), son récit d’enfance, des pages ironiques et fameuses sur le sujet, son apprentissage du français a été marqué par l’emploi du « symbole » ou « signal » (un objet infamant dont on lestait, moyennant punition, l’élève surpris à parler dans sa langue plutôt qu’en français). Ainsi, « entré dans la langue française par la porte de la violence », il en a réchappé « par la fenêtre de la traduction et de la poésie ». Car si « la violence parle toutes les langues », « la poésie aussi ! ».
À travers la figure maternelle, il ne s’agit pas non plus de célébrer des racines, bien au contraire. C’est la mère qui a soustrait son fils à l’« effroi de l’appartenance », lui permettant d’endosser avec souplesse un « être multidirectionnel ». Les parures (perles, plumes, bagues, boucles d’oreille et bracelets… ) dont il a éprouvé dès l’adolescence « un besoin impérieux », et qui lui valent régulièrement des « Madame » dont il s’amuse et se réjouit, il les tient de sa mère : un « brouillage des signes d’identification, des signes d’authentification et des lignes de démarcation » formant un héritage précieux.
Chez les « en-bas des en-bas », on hérite ainsi d’une « magie ni noire ni blanche », la « magie ordinaire qui consiste à multiplier zéro par zéro pour avoir un ». Le père, souffrant de paralysie, est un Jacob « passé de prince lumineux à souillon terreux ». Quant à la mère intrépide aux senteurs « fleur d’acacia et feuille de laurier », elle exerce son « geste précis de prestidigitateur » au potager, parmi ses tomates. Elle n’est pas sans évoquer une figure historique plus âgée, issue d’une région proche, Funmilayo Ransome Kuti. Encore appelée Olunfunmilayo, la mère du musicien Fela Anikulapo Kuti, née en 1900, périt en 1978, quelque temps après avoir été défenestrée par la soldatesque lors de l’assaut contre la Kalakuta Republic fondée par son célèbre fils. Dotée elle-même d’une forte notoriété, elle fut une infatigable militante, dressée contre l’oppression. Comme le fera la mère de Kossi Efoui, elle avait également fondé une chorale féminine, instrument de lutte et d’émancipation.
Le chant de la mère, c’est « pour ne pas penser aux choses dures », et il y en a décidément. La fin du livre le rappelle sans emphase, avec l’explication du « lait » injecté à l’hôpital. Quant au fils, il a cette formule très senghorienne : « Je n’ai jamais séparé l’écriture du chant. » Avec « ces parts de vide » nécessaires à l’accomplissement du récit et « les mots comme poupées de cérémonie », il fait œuvre de transmission et de vie. Si l’on n’a encore fréquenté ni le théâtre ni les romans précédents (tous édités au Seuil) de Kossi Efoui, parmi lesquels Solo d’un revenant (2008), L’ombre des choses à venir (2011) et Cantique de l’acacia (2017), il est temps de s’y mettre avec ce traité épuré de magie verbale – en existe-t-il une autre, d’ailleurs ?