Depuis quelques années, les Suisses s’interrogent sur leur rôle dans la colonisation et sur la position à adopter face au travail de « décolonialisme » des musées. Des collections rassemblées au XVIIe et au XVIIIe siècle par des citoyens de la Confédération ou des « cantons et républiques alliées », dans des pays non européens, sont-elles à considérer comme des ensembles d’objets rapportés en Europe dans le cadre d’un rapport de force, en partie spoliés par une puissance dominante ?
La réponse de Claire Brizon, historienne de l’art et muséologue, est résolument positive. Oui, il s’agit de collections coloniales, à soumettre au même indispensable travail mémoriel que celles des musées des grandes puissances impérialistes. La Suisse n’a pas eu d’empire colonial, mais nombreux ont été ses citoyens impliqués dans les opérations coloniales des autres nations, faisant participer la confédération aux échanges et aux actions politiques de la mondialisation des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce livre s’inscrit notamment dans la continuité d’une réflexion entamée avec l’ouvrage Une Suisse exotique ? associé à l’exposition « Exotic ? » de Lausanne en 2020, ainsi que d’une autre exposition au palais Rumine, « Retracer la provenance », dont Claire Brizon a été la commissaire scientifique en 2021.
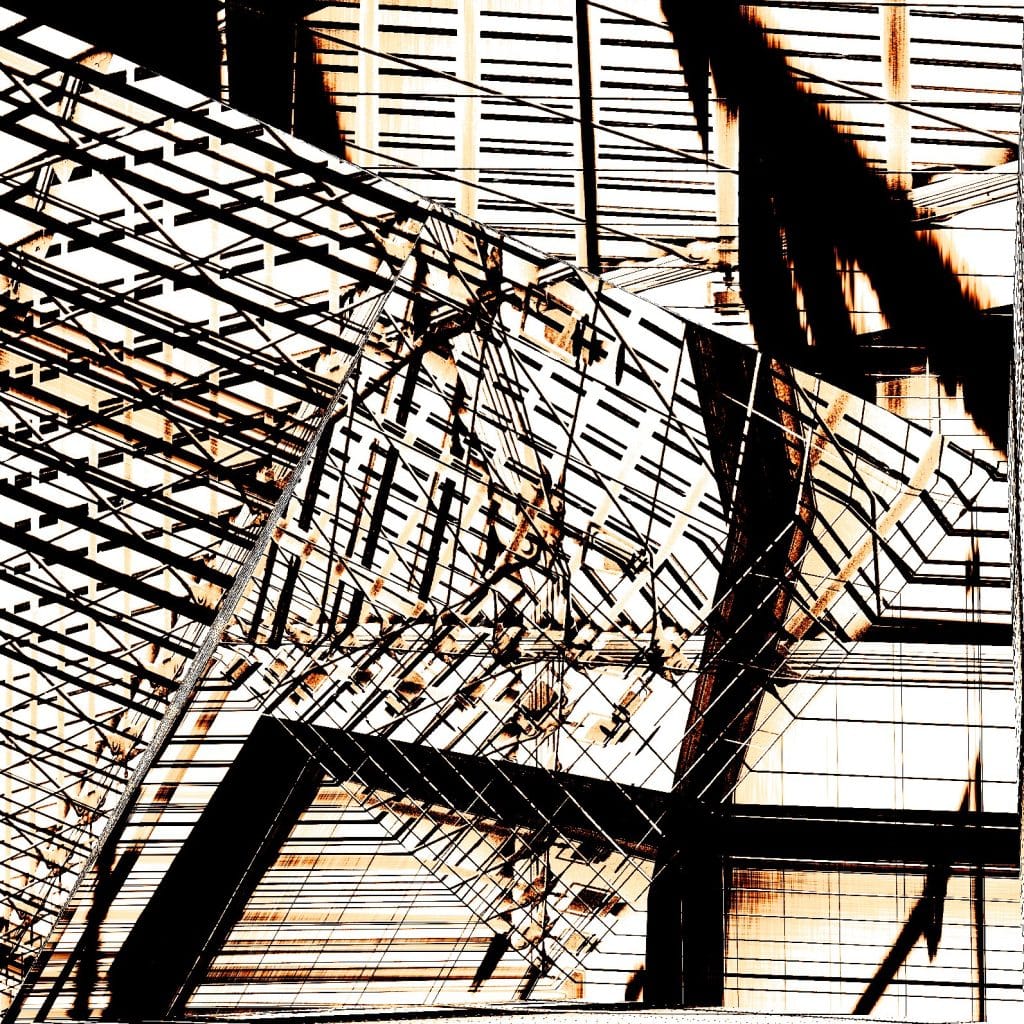
Si l’on peut reprocher à cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, de ne s’être pas totalement affranchi du modèle universitaire, c’est-à-dire d’être demeuré par endroits imprégné de formes très scolaires, il n’y a rien là qui affaiblisse le sérieux et la portée de ce considérable travail de recherche historique. Certes, le lecteur est ainsi bien accompagné dans sa découverte du propos et de sa complexité, mais le style s’en ressent, parfois très didactique et peu fluide. C’est là un problème récurrent de l’écriture des sciences sociales, dont la discussion dépasse ce cadre. Il convient de passer outre pour saluer un travail d’enquête méthodique, fort des recoupements d’une grande variété d’archives : dossiers d’inventaires et de restauration, journaux de voyage, cahiers de dessins dont des extraits sont judicieusement reproduits, correspondance des collecteurs, les objets eux-mêmes constituant évidemment la source majeure de cette recherche.
S’entrecroisent au fil des chapitres des histoires d’objets, des histoires de collecteurs et des histoires de collections. Les grandes figures de la collecte de l’époque sont classées en fonction de leur type d’engagement dans l’histoire coloniale : engagement militaire pour Hans Ulrich Meyer (1638-1692), en Indonésie dans la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ; engagement marchand en Asie pour Charles Constant de Rebecque (1762-1835), surnommé Charles le Chinois ; engagement religieux pour le jésuite Philipp Anton Segesser von Brunegg (1689-1762) en Amérique du Nord. Armée, commerce et évangélisation, tels étaient les piliers de la présence suisse dans les pays non occidentaux colonisés ou en voie de l’être.

Des personnages aux profils étonnants, plus curieux que cupides, sinon totalement désintéressés, dont les archives permettent de saisir les goûts, l’adéquation aux modes du moment, ainsi que tout un système d’appréciation esthétique des objets tributaire du contexte économique et social du moment de la collecte. Celle-ci joue un rôle dans les relations du collecteur avec le pays où il rencontre les objets et avec ses habitants, ainsi que dans les relations avec ceux à qui il rapporte les objets le cas échéant. Son prestige social s’accroit ainsi dans la société bourgeoise et urbaine suisse. Pour Segesser, par exemple, les pierres et les graines qu’il collecte sont un moyen d’être en contact avec les autochtones du désert de Sonora (Mexique et Californie) mais aussi de rester lié à sa famille suisse de Lucerne à laquelle il destine les naturalia collectés. Claire Brizon signale au passage que ces pierres et plantes aux vertus antipoisons selon les croyances locales ne sont pas anodines dans le cadre des rivalités lucernoises, « dans une tradition souveraine qui craint les complots, surtout d’empoisonnement ». Autour des objets se trament des récits sociaux et politiques communs par-delà les océans.
La Suisse ne connaît ni académie ni société savante avant 1815. Mais ses citoyens sont nombreux à occuper des postes de correspondants ou d’associés dans les sociétés savantes et académies européennes. Ils sont imprégnés de l’influence des littératures naturaliste et de voyage, qui s’ajoute à l’influence des acteurs des pays visités, artistes ou savants. D’où l’émergence d’une certaine culture de la collecte et la participation de la confédération aux réseaux savants des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais le marché des curiosités s’inscrit aussi dans l’économie de traite. Ami Butini (1718-1780) donna des objets, des animaux et des graines au cabinet de la bibliothèque de Genève, dont un gymnote, sorte d’anguille produisant des impulsions électriques, conservé aujourd’hui dans l’alcool au Muséum d’histoire naturelle de Genève. Ce collecteur de spécimens naturalistes était impliqué dans le commerce quadrangulaire avec le Suriname, ce qui donne une autre dimension à son action d’enrichissement des collections et des savoirs.
L’auteure sait rester modeste et ne prétend pas répondre à toutes les questions, notamment sur l’acquisition des objets, point toujours épineux en contexte colonial, ou sur leur parcours détaillé jusqu’aux réserves des musées. En décrivant très précisément les pratiques, stratégies et astuces d’enquête dans les réserves muséales et les archives, Claire Brizon déploie un savoir-faire incontestable grâce auquel nous accédons à des fonds peu connus, voire inédits. Une attention aigüe aux détails lui permet de démêler l’écheveau compliqué des réseaux de collecteurs, y compris lorsque ceux-ci, comme dans le cas d’Antoine Henri Louis Polier (1741-1795), se construisent hors des institutions européennes. Polier, engagé dans la Compagnie britannique des Indes, vit trente ans en Inde où il fonde une famille polygame, s’intègre à la vie locale sur la durée et rentre en Suisse avec des manuscrits orientaux et des peintures miniatures sans pour autant les donner à des institutions. C’est un exemple de collecte, impliquant les autochtones, qui n’enrichira qu’indirectement les musées suisses et dont Claire Brizon tente de retracer le parcours.
Une fois parvenues en Europe, le fruit des collectes joua un rôle politique et économique majeur, permettant de donner un aperçu des profits potentiels de tel ou tel territoire. Les lieux où les objets sont conservés et montrés, les cabinets d’histoire naturelle et bibliothèques notamment, visent à instruire mais aussi, implicitement, à renforcer le prestige social des collecteurs et à imposer de nouveaux codes sociaux fondés sur le vaste mouvement expansionniste de l’Occident du XVIIIe siècle. Celui-ci verra l’évolution des collectes dans un cadre plus clairement organisé, selon des typologies plus rigoureuses. L’ère des curiosités laisse place à une vision disciplinée des sciences.

Au-delà d’un inventaire critique des collections suisses, Claire Brizon invite en conclusion à « désinvibiliser les collections coloniales » et à opérer une remédiation muséale en faisant foisonner la pluralité des récits autour des collections, dans une approche résolument décoloniale. L’auteure donne un exemple précis, celui d’une hache d’apparat kanake, décrite par les sources européennes du XVIIIe siècle comme une arme des redoutables et sauvages guerriers de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de valoriser politiquement l’engagement militaire colonial évidemment civilisateur, puis, plus tard, de christianiser l’objet en le nommant « hache ostensoir ». Cette appropriation langagière prolonge la captation matérielle des objets autochtones par un processus culturel s’imposant jusqu’à nos jours dans les réserves des musées. Le travail mené avec Denis Pourawa, poète d’origine kanake, dans les réserves du musée cantonal de Lucens où est conservé l’objet, a abouti à l’attribution d’un nom vernaculaire, Nââkwéta, expression de l’imaginaire collectif évoquant la baie de Kouéta dont serait originaire l’objet d’après la parole coutumière locale. Selon Claire Brizon, cette reconnexion de l’objet à la culture kanake doit être envisagée, non comme un retour à une origine essentialisée, mais comme une nouvelle étape des échanges permanents entre les hommes, par le truchement d’« objets ambassadeurs ».
Ces objets, naturalia et artificialia aujourd’hui au musée, ont participé à la construction d’un imaginaire visuel de l’Autre et de l’Ailleurs ainsi qu’à « l’émergence du concept de “race” » dans la Suisse des Lumières. Se pose désormais la question des restitutions, dont l’auteure appelle à anticiper les demandes en retraçant les parcours. Elle souligne que, dès 1926, le musée d’ethnographie de Genève a restitué une chasuble au Paraguay. La Suisse pourrait jouer une partition singulière et prendre à bras-le-corps cette question que les grandes puissances coloniales comme la Grande-Bretagne et la France (entre autres) n’envisagent souvent qu’une fois mises au pied du mur.










![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)

