S’exposer au soleil pour guérir, se gorger de soleil pour bronzer et séduire : qu’il soit médical ou esthétique, le bain de soleil est un topos que l’on retrouve dans plusieurs chefs-d’œuvre littéraires du XXe siècle. L’exposé qui suit est à lire avec un tube d’écran total.

Pour le docteur Auguste Roullier, la « cure de soleil », surtout « combinée » à une « cure d’altitude » – il était suisse –, représentait le traitement idéal contre la tuberculose. Il n’en était pas l’inventeur, mais le praticien le plus systématique et le plus expérimenté, et dans La cure de soleil (1915), ouvrage mi-scientifique mi-vulgarisateur illustré de photos médicales ainsi que de celles des établissements de soin qu’il avait créés, il détaille les raisons et modalités de la thérapie, décrit le bon « protocole d’insolation » et insiste sur ses bienfaits hygiéniques et sociaux. Citant un proverbe italien, il affirme : « Dov’entra il sole, non entra il medico ».
Cette exposition curative au rayonnement solaire a fourni motifs et thèmes à de grands romans du début du XXe siècle (La montagne magique de Thomas Mann, Pabellón de reposo de Camilo José Cela, La mer de Blai Bonet…). Patients et médecins s’y croisent dans des cliniques de cure organisées autour d’espaces ouverts où le malade prend le soleil. Tout un imaginaire autour de ce que Katherine Mansfield – morte de la tuberculose – appelait humoristiquement le « bang de soleil » s’y déploie en schémas plus ou moins allégoriques de l’existence humaine.
Quant à l’aspect le plus superficiel mais le plus visible de l’exposition au soleil, il est alors vu par la médecine comme un signe de « régénérescence », avant d’être valorisé esthétiquement pour lui-même. Déjà dans son livre, le docteur Roullier se laisse aller à quelques émois esthétiques et sensuels le concernant : « La pigmentation […] donne à la peau une douceur, un velouté, une richesse de ton » sans pareils, confie-t-il, ajoutant que c’est un « spectacle charmant pour l’artiste comme pour le médecin » que de voir les petits malades « aux téguments bronzés, [en été] de vraies fleurs humaines en plein épanouissement qui se mêlent aux fleurs des champs, ou [en hiver] sillonnant en ski ou en luge, les pentes étincelantes de neige ».

Ce hâle séduisant quitte donc petit à petit le domaine strictement héliothérapeutique pour, dans les années 1920, envahir celui de la mode et de la distinction sociale. Symbole de modernité et privilège de la classe de loisir, il retient l’attention non seulement de l’industrie cosmétique mais du roman. De Scott Fitzgerald à Françoise Sagan, les écrivains familiers des édens sociaux chroniquent l’impératif de beauté qu’est la pigmentation ainsi que les rituels complexes mis en place pour l’obtenir. Ainsi l’un des personnages de Beaux et damnés (1922) détaille-t-elle par le menu « la sorte de hâle auquel elle souhaite parvenir pendant l’été et le degré de proximité par rapport à cet idéal qu’elle atteint en général ». Tendre est la nuit (1934), qui se déroule en partie au cap d’Antibes dans le milieu des riches expatriés américains, surenchérit dans la description non seulement des nuances du bronzage, mais des façons élégantes de les obtenir et de s’en servir dans le jeu érotique et social. Car, si elles marquent d’abord la différence entre le clan des gens chic et le troupeau vulgaire des « non bronzés », cantonnés à un coin de la plage, ces nuances permettent ensuite d’effectuer de subtils distinguos à l’intérieur du groupe privilégié entre personnes « vraiment » du sérail et nouveaux venus. Le comble de l’élégance désinvolte est incarné dans le roman par le personnage de Nicole Diver qui prend son bain de soleil avec son sautoir, offrant à tous le spectacle de « son dos bronzé suspendu à ses perles ».
Puis, dans toute une littérature de la deuxième moitié du XXe siècle, qu’elle se déroule sur la Côte d’Azur ou ailleurs, le bain de soleil représente un des éléments traditionnels de l’hédonisme estival qui, dans sa version la plus consumériste et ostentatoire, se compose de scotch and soda ou de martinis, de baignades, de yachts, de voitures décapotables, etc. En avant, l’existence dorée et décadente des Sagan, Tennessee Williams, Patricia Highsmith… ou de leurs personnages.
Existent aussi, parmi les écrivains, des amateurs et chroniqueurs d’un farniente beaucoup plus artisanal ou bohème. Le bain de soleil se fait chez eux sensuel, méditatif, jeu d’engourdissement ou d’éveil. L’une d’entre eux, Colette, décrit ainsi, dans « Bain de soleil » (1908), sa sieste sur une plage de la Somme, à côté de Poussette, la chienne : « Couchée sur le ventre, un linceul de sable me couvre à demi. Si je bouge, un fin ruisseau de poudre s’épanche au creux de mes jarrets, chatouille la plante de mes pieds […] Sous mon nez, sautent, paresseusement, trois puces de mer, au corps de transparente agate grise… Chaleur, chaleur… Bourdonnement lointain de la houle qui monte ou du sang dans mes oreilles ?… Mort délicieuse et passagère, où ma pensée se dilate, monte, tremble et s’évanouit avec la vapeur azurée qui vibre au-dessus des dunes… ».
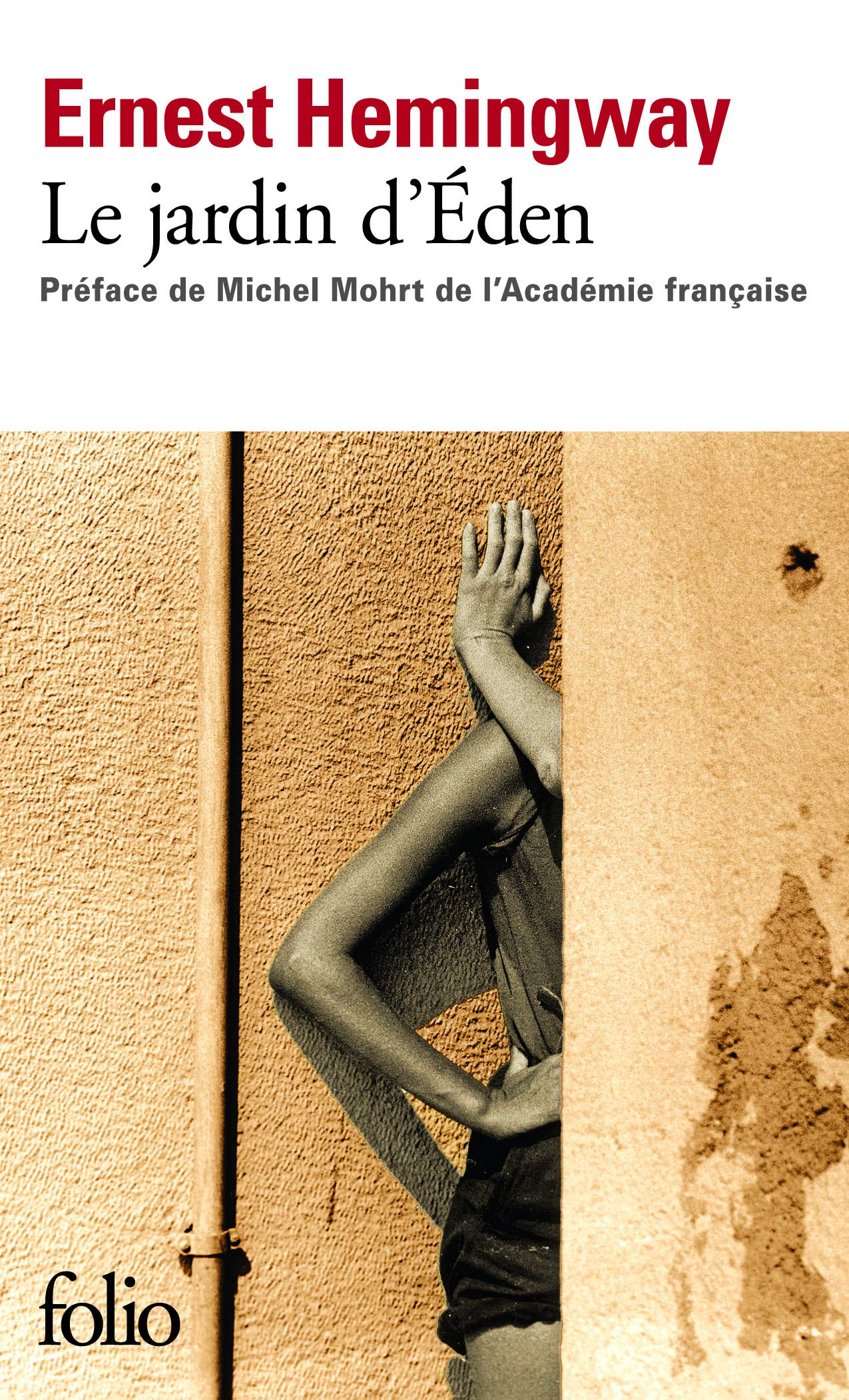
Chez certains écrivains, d’autres préoccupations thématiques personnelles, au-delà du bien être ou de la dissolution de soi, s’introduisent dans le motif du bain de soleil. Ernest Hemingway, dans Le jardin d’Éden (publié de manière posthume en 1986), poursuit un fantasme de changement radical lorsque son personnage, une Américaine qui passe sa lune de miel avec son mari dans le sud de la France, s’enorgueillit du résultat de ses efforts de sun tanning. Elle sait avoir atteint son but lorsqu’un compatriote admiratif lui dit qu’« elle est la fille blanche la plus noire qu’il ait jamais vue ». Joies du self-fashioning transgressif ! Mais Hemingway va plus loin ; sa jeune bronzée franchira une autre frontière en se coupant les cheveux, en portant des vêtements masculins, en se faisant appeler Peter par son mari, en adoptant des pratiques sexuelles agressives… Comme quoi le virilisme de Papa Hemingway n’était pas fait que de certitudes.
Pour les écrivains réticents au brouillage des sexes, l’exposition au soleil signifie autre chose. Ainsi, par exemple, dans l’imagination cosmique de D.H. Lawrence, le bain de soleil permet de faire l’expérience de la formidable puissance érotique de l’astre des cieux. Dans sa nouvelle « Soleil » (1926), l’héroïne américaine Juliette, qui se trouve en Italie sur la recommandation de son médecin pour tenter de recouvrer la santé, éprouvera, en s’exposant dehors nue dans la garrigue, des choses inouïes. En termes lawrenciens, elle sera « pénétrée », « connue » par le soleil et, inversement, un « flot » sortira d’elle pour aller vers lui, tandis que le désir d’une fécondation solaire lui viendra : « Ce n’était pas simplement un bain de soleil qu’elle prenait, c’était bien plus. Grâce à un mystérieux pouvoir en elle, plus profond que sa conscience et sa volonté, elle entrait en rapport avec le soleil et le flot coulait de lui-même, de ses entrailles à elle. Elle-même, personne consciente, était secondaire, presque simple spectatrice. La vraie Juliette était ce sombre flot venant du plus profond de son corps et allant vers le soleil ».
Pas étonnant qu’alors, « vague, mais animée d’un pouvoir plus grand qu’elle-même », elle ne puisse montrer que peu d’intérêt pour les étreintes de son « pâle » époux et renonce même aux roboratives promesses copulatoires offertes par un solide paysan local, moins sensible aux forces cosmiques qu’à sa nudité entraperçue. Tel est donc le rêve bizarre de Lawrence, également exprimé dans son poème « Les femmes du soleil », d’un monde où les femmes « n’appartiennent ni aux hommes ni à leurs enfants / ni à elles-mêmes / mais au soleil ». Mais pas sûr que l’utopie de cette nouvelle subordination ait été du goût des intéressées.
Enfin, avec l’arrivée du bain de soleil estival pour tous, modificateur de lieux autrefois réservés aux happy few, les plus grincheux des écrivains ont pu exprimer leur tristesse : c’en était fini du privilège de la solitude aquatique et solaire. Paul Morand l’a dit dans Bains de mer (1960), tandis que son ami Jacques Chardonne faisait part de sa révulsion devant ces rivages, jadis si beaux, qu’il voyait à présent « recouverts d’un enduit de chair humaine ».
Eh oui, cher ou haï bain de soleil, quand tu tiens les écrivains, quelles rêveries ou détestations ne leur inspires-tu pas !












