Les éditions La Baconnière poursuivent leur travail au long cours d’édition et de réédition de l’œuvre de Sergueï Dovlatov, né en 1941, ayant quitté l’URSS pour les États-Unis en 1978, mort en 1990, très populaire de nos jours en Russie. Dovlatov, c’est un style alerte et laconique, apte souvent à provoquer l’hilarité des lecteurs. Mais Dovlatov, c’est aussi La zone, livre marquant sur l’univers des camps de prisonniers de droit commun en URSS.

Sergueï Dovlatov est une figure atypique et talentueuse de la littérature russe souvent perçue confusément par les lecteurs francophones. Ses livres sont tous brefs et marqués par un style immédiatement reconnaissable, laconique et alerte. Dovlatov se réclame de la concision d’un Hemingway. Son écriture séduit par sa désinvolture, son goût de l’anecdote, du détour, du trait d’esprit, et même de la blague. Dovlatov a choisi de parsemer plusieurs de ses livres de notations sur le vif, qu’il nomme « solo pour underwood » du nom d’une marque de machine à écrire. Il rend hommage dans Le livre invisible aux improvisations du jazz, et à « l’art léger, immédiat, insaisissable comme l’ombre des flocons de neige » d’Oscar Peterson. L’écrivain a conscience d’occuper dans la littérature russe une place à part. Il l’affirme dans le bel entretien de 1988 avec John Glad donné à lire en annexe du Compromis : alors qu’en Russie « la littérature s’est chargée de l’interprétation intellectuelle du monde », lui se contente de raconter des histoires, et se veut modestement un « nouvelliste, un storyteller ». Il aura su toutefois se forger un style, ce qui n’est pas rien, et expérimenter avec la forme du livre…
Du point de vue esthétique, Dovlatov emploie dans le même entretien à propos de son œuvre le terme de « pseudo-documentalisme » : inspirés d’épisodes de sa propre existence, citant des documents dont le lecteur est en peine de déterminer la nature authentique ou factice, ses livres laissent tous une très large part à l’invention littéraire. Traçons quelques jalons d’une vie qui s’est déroulée en deux actes très différents, avant et après l’exil de 1978 en Amérique. Exclu de l’université de Leningrad en 1961 après avoir raté son examen d’allemand, le jeune Dovlatov fait son service militaire comme gardien d’un camp de prisonniers de doit commun, expérience qui sera la matrice de son premier manuscrit, La zone. Devenu journaliste, il parvient à faire publier ses articles, mais ses nouvelles sont refusées par toutes les revues. Dovlatov reviendra avec beaucoup d’humour sur ses mésaventures d’écrivain soviétique maudit dans Le livre invisible. En 1972, il part vivre en Estonie, où il travaille pour la presse soviétique locale. Un recueil de nouvelles doit enfin voir le jour, mais il est interdit à la dernière minute par le KGB. De retour à Leningrad, de plus en plus persécuté par les autorités, Dovlatov se résout en 1978 à émigrer aux États-Unis afin de bénéficier de la liberté de création à laquelle il aspire. Il y publie enfin son œuvre, à une cadence soutenue. Une douzaine de livres paraissent. Il s’agit tantôt de textes nouveaux, tantôt de textes anciens remaniés. L’auteur qui a su si bien mettre à nu les rouages du système social soviétique meurt, avec un certain sens de l’Histoire, en 1990. Il ne sera pas là pour assister à l’incroyable engouement que suscitera son œuvre dans la Russie post-soviétique, où il reste l’un des auteurs les plus populaires du vingtième siècle.

« [Dovlatov] ne sera pas là pour assister à l’incroyable engouement que suscitera son œuvre dans la Russie post-soviétique, où il reste l’un des auteurs les plus populaires du vingtième siècle. »
Le compromis est un recueil de nouvelles inspiré par la période estonienne de l’auteur. Le principe formel en est simple : on lit d’abord un article publié par le narrateur dans les journaux soviétiques russophones d’Estonie, puis le récit dévoile sa genèse peu reluisante, marquée par des méthodes indifférentes à la véracité des faits et le contrôle idéologique sourcilleux d’un rédacteur en chef. Il s’agit de montrer non seulement l’envers du décor du journalisme, mais aussi d’un discours imbibé de propagande qui cherche à tout peindre en beau. Le lecteur entre en connivence avec une forme de cynisme bon enfant assez caractéristique de l’œuvre dovlatovienne : pour aider une jeune fille sans le sou, le narrateur décide de l’interviewer en la faisant passer pour une touriste amatrice d’architecture gothique et férue des poèmes de Blok. La série des douze « compromis » va toutefois bien au-delà du simple jeu sarcastique. Dovlatov fait constamment allusion aux non-dits et aux tabous de la société soviétique : l’antisémitisme ordinaire (bien connu de l’auteur, qui a des origines juives du côté paternel), le racisme (quand le narrateur se voit chargé de faire un article sur le « 400 000e habitant de Tallinn », il est hors de question que le père du nouveau-né soit noir), la sexualité, et même la dimension impériale du pouvoir soviétique. Pour les témoins traumatisés du retour de l’impérialisme russe que nous sommes, il est rassurant de constater que Dovlatov ne semble pas considérer de haut la culture estonienne. Il énumère dans Le Livre invisible divers auteurs estoniens de talent, tout en rappelant que la question nationale reste bien évidemment un « tabou catégorique ». Dans l’un des « compromis », un ami du narrateur photographe répond ironiquement à une question sur ce qui l’a amené en Estonie : « j’ai fait la guerre par ici et je suis resté… Bref, je suis un occupant ». Le recueil se lit avec intérêt de nos jours, comme une constellation de récits sur une périphérie de l’empire soviétique au début des années 1970. Le dernier des « compromis » paraît presque visionnaire : le narrateur rédige un article ému sur un banquet annuel des rescapés des camps nazis, mais la suite laisse entendre qu’une bonne part d’entre eux est aussi passée par les camps soviétiques… Les chants sur la « guerre sacrée du peuple » font rire jaune, et le culte de la « grande guerre patriotique » va déjà bon train.
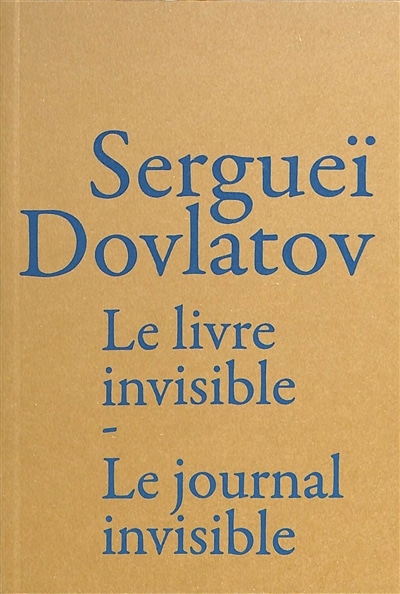
Parmi les petits volumes publiés par La Baconnière, celui des deux récits jumeaux Le livre invisible – Le journal invisible est le plus élégant grâce à une maquette remarquablement soignée. Dans Le Livre invisible, Dovlatov évoque de manière très réussie sa trajectoire d’écrivain soviétique impubliable, et dépeint à la fois les institutions littéraires officielles et les milieux non-conformistes. On y trouve notamment un beau portrait de Brodsky : « Brodsky a élaboré un modèle de conduite inédit. Il ne vit pas dans un État prolétarien, mais dans le monastère de son propre esprit. Il ne lutte pas contre le régime. Il ne le remarque pas ». Lors d’une soirée de lecture publique très fréquentée en 1968, la lecture par Brodsky de ses poèmes provoque « des rugissements d’extase ». Dovlatov revient aussi dans ce texte sur le choix, pleinement assumé, de ce gagne-pain qu’est pour lui le journalisme : « on dit souvent que le journalisme est un métier néfaste pour un écrivain. Je ne l’ai pas ressenti. Ce sont des parties différentes du cerveau qui sont mobilisées dans ces deux occupations. Quand j’écris pour un journal, mon écriture change ». Dovlatov évoque aussi avec humour son écart par rapport aux auteurs officiels : « je ne sais pas où les écrivains soviétiques trouvent leurs sujets. Rien autour de nous n’est publiable ». Il ne prend pas complètement la pose de l’écrivain dissident, malgré les persécutions et une authentique arrestation en 1978. « Je suis presque un dissident », énonce-t-il subtilement dans le Journal invisible. Tout Dovlatov est dans ce « presque ». « Et moi alors, avec ma quasi dissidence ? », écrit-il ailleurs. Tout aussi réussi que Le livre invisible, Le journal invisible évoque de manière cocasse les tentatives de l’exilé et de ses acolytes pour créer un journal russophone en Amérique. L’un des compagnons exaltés de cette aventure journalistique n’a qu’une phrase à la bouche : « notre devoir est de raconter au monde la vérité sur le totalitarisme ». Le texte est surtout l’occasion de brosser un tableau satirique du milieu des émigrés russes à New York. Les conflits entre émigrés de la « deuxième » et de la « troisième » vague se font jour ; ils dénotent des divergences idéologiques, ou stylistiques (un journal concurrent distille une version vieillotte et affadie de la langue russe) ; au même moment, l’écrivain a le bonheur de se voir traduit et publié en anglais. Texte plus secondaire sans doute du corpus dovlatovien, Le domaine Pouchkine s’inspire de l’expérience faite par l’écrivain en tant que guide touristique de la propriété du poète dans la région de Pskov. Le récit joue avec drôlerie sur la pouchkinolâtrie russe et l’institution des maisons-musées d’écrivains, incontournable en Russie, tout en évoquant une campagne profonde où l’ivrognerie est sans limite. Dovlatov profite aussi de ce texte pour narrer via son alter ego fictionnel Alikhanov l’épisode de son arrestation pour « parasitisme social ».

Dans l’œuvre de Dovlatov, le texte le plus riche est dans doute La zone. Souvenirs d’un gardien de camp. Le livre y occupe une place à la fois centrale et à part. Centrale, parce qu’il s’agit de l’acte de naissance de son œuvre, même s’il a fallu dix-sept ans pour que Dovlatov puisse enfin publier le texte, très remanié, notamment à partir de fragments photographiés sur microfilm avant son exil. Une place à part, car cette fois le ton diffère : l’humour est plus localisé, il concerne surtout l’épisode où des détenus de droit commun interprètent, dans un improbable spectacle, les rôles de Lénine et de Dzerjinski. En publiant son livre aux États-Unis, Dovlatov a fait le choix décisif d’alterner séquences narratives et lettres de l’auteur à son éditeur. Les lettres apportent une respiration au sein d’un texte dense, âpre, marqué par l’omniprésence de la violence ; elles introduisent aussi une dimension réflexive qui dément la réputation d’une œuvre dénuée de portée intellectuelle. Dovlatov affirme sa propre vision, se situant explicitement par rapport aux grands noms de la littérature carcérale que sont Soljenitsyne et Chalamov. Les différences sont patentes : Dovlatov ne décrit pas les camps de prisonniers politiques, mais ceux des détenus de droit commun ; il ne décrit pas les camps du point de vue des détenus, mais de celui des gardiens. Le livre énonce un constat moral central, celui de la ressemblance troublante entre gardiens et détenus : « nous étions semblables et même interchangeables. La plupart des détenus auraient pu s’acquitter du rôle de gardien. Et la plupart des gardiens auraient mérité la prison ». Tout en décrivant comment se propage la culture de la violence, l’écrivain dit, non sans provocation, sa fascination pour la langue des camps. « Le langage des camps est surtout un phénomène créatif, purement esthétique, de l’art pour l’art. La vie écœurante des camps confère à la langue une étonnante expressivité. La langue des camps est recherchée, savoureuse, ornementale et précieuse ».
« Dovlatov affirme sa propre vision, se situant explicitement par rapport aux grands noms de la littérature carcérale que sont Soljenitsyne et Chalamov. »
Diverses et mystérieuses sont les voies qui mènent à la littérature. Paradoxalement, c’est dans l’espace du camp que Dovlatov dit être né à l’écriture : « je me sentais mieux qu’on n’aurait pu le supposer. Ma personnalité se dédoublait. La vie se transformait en sujet littéraire. Je me souviens parfaitement de la façon dont tout a commencé. Ma conscience a quitté son enveloppe coutumière. J’ai commencé à me penser à la troisième personne. Pendant qu’on me tabassait près de la scierie de Roptcha ». Livre marquant et essentiel, La zone va au-delà de la verve satirique à laquelle on réduit généralement l’écrivain. Le laconisme du style, lui, est déjà présent, et restera une constante de l’œuvre.












