S’il est une expérience ténue et merveilleuse à la fois, c’est bien celle de la couleur. Pourquoi vivons-nous dans un monde coloré ? À quoi tient cette qualité de presque tout ce qui nous entoure ? Certains ont voulu la mesurer, d’autres l’ont chantée, d’autres encore en sont venus à décortiquer l’œil humain, etc. Il semble que chacun possède sa propre théorie de la couleur. En tout cas, il y en a plusieurs. Deux livres récents se sont engagés chacun à sa manière sur ce terrain. L’essai de Peter Sloterdijk se présente comme un ouvrage destiné à un grand public cultivé et déclare avoir trouvé la clé de tout : le gris. L’ouvrage d’Hervé Fischer s’apparente, lui, à une somme et insiste sur le rôle du mythe pour comprendre les couleurs.
L’essai de Peter Sloterdijk commence très mal, à la troisième ligne du prologue : « le phénomène du « gris » – comme couleur s’attachant à des choses ». On croit d’abord à une coquille invraisemblable, mais l’affirmation parcourt l’ensemble du livre : le gris est une couleur ! Las, j’en suis désolé, je suis contrit de devoir ici le rappeler : le gris n’est pas une couleur.

Si c’était le cas, il suffirait de désaturer une photographie en couleurs pour qu’elle disparaisse entièrement. Seulement, par désaturation on obtient une photographie en noir et blanc, où toute l’échelle des gris est présente. « Le gris n’est pas une couleur » n’est pas une affirmation subjective de ma part, c’est une réalité scientifique, physique, atomique et anatomique, prouvée et conceptualisée depuis des lustres sinon depuis des siècles. Le gris est un ton, pas une teinte. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs non plus. On les qualifie de couleurs par un abus de langage tout à fait commun mais fautif. On ne saurait trouver ainsi plus fragile fondation à un essai sur le gris, à moins de s’accorder d’avance la licence de raconter un peu n’importe quoi. Et c’est une liberté tout à fait légitime, à condition de se prétendre poète, pas philosophe.
Ainsi, la structure valorielle, constituée de tons (blanc, noir et toute l’échelle des gris), que doit posséder toute apparition pour être simplement perceptible par l’œil humain n’a rien à voir avec la structure chromatique, constituée de teintes (bleus, rouges, jaunes, violets, orangers, verts, etc.), que doit posséder toute apparition pour être perçue comme colorée par l’œil humain. La structure chromatique recouvre, double la structure valorielle de l’apparition, comme un manteau qui peut lui être retiré, car nous pourrions tout à fait vivre dans un monde sans couleur sans nous cogner aux tables. Et dans ce monde sans couleur nous serions parfaitement capables de retrouver un trombone sur un bureau en désordre. C’est à cette structure fondamentale du visible qu’appartient le gris, pas au costume de couleurs qui la recouvre.

Attention, loin de moi l’idée de minorer ou de mépriser l’importance de la couleur en soi et dans l’expérience perceptive, d’autant que, chaque couleur possédant une valeur, un ton propre intrinsèque (le bleu est nécessairement plus foncé que le jaune qui est plus clair que le rouge), ces deux structures sont intimement liées et personne ne s’est jamais mis en tête de les dissocier à la hache. Je voulais seulement élaborer ici rapidement pourquoi – à grands traits –, scientifiquement, et philosophiquement si l’on suit tous les phénoménologues consciencieux ou n’importe quelle étude scientifique décrivant les longueurs d’ondes propres à chaque couleur, le gris n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais, en rien, une couleur.
En logique, je crois que cela s’appelle « une prémisse erronée ». Je me suis laissé dire que c’était tout de même assez grave, quels que soient l’objet et le contexte de la réflexion.
« « Le gris n’est pas une couleur » n’est pas une affirmation subjective de ma part, c’est une réalité scientifique, physique, atomique et anatomique, prouvée et conceptualisée depuis des lustres sinon depuis des siècles. Le gris est un ton, pas une teinte. »
Mais concernant l’essai de Peter Sloterdijk, ce n’est pas grave du tout. Car il ne s’agit pas vraiment d’une réflexion mais davantage d’une divagation assumée sur le thème du gris. L’auteur m’a donné la sensation de pratiquer un genre de poésie précieuse et intellectualisante. Il ne s’embarrasse pas de science mais pas davantage d’un autre prisme, subjectif ou culturel. Il s’est libéré de la contrainte de produire un sens univoque ou simplement identifiable. Il écrit au fil de la plume, sautant d’une moitié de considération à une autre, relevant d’un autre domaine, puis il enchaîne avec une liste exotique de noms de disciplines auxquelles s’applique d’après lui ce qu’il vient de dire, qui ne rime souvent à rien, mais qu’importe.
La quatrième de couverture de l’éditeur décrit un livre « flamboyant », « qui contient en réalité toute l’histoire de la pensée, de l’art et du monde ». Rien que ça. Après ce livre, plus rien ne devrait donc être écrit. Il est vrai que Peter Sloterdijk couvre tout. Sa pensée fait le grand écart entre la politique, la métaphysique, la littérature, la science, tout est lié, tout est expliqué, tout est résolu par Peter Sloterdijk. Et le gris est la clé du monde.
Qu’importe si très régulièrement il utilise des expressions comme « gris-brun » en parlant du brun pour enchaîner sur un développement de dix pages sur le gris. Selon la même méthode, je pourrais commencer un essai sur les longues canines du toucan-tigre puis pondre cent pages sur l’émail des dents du toucan. Pourtant, je crois qu’un scrupule éthique me retiendrait dans ce projet.
De titres de chapitres lyriques : « Gris spectral / De la vieille souffrance de la lumière quand elle descend dans l’obscurité et de ses récents grands actes sur le sel et l’argent », en « Digressions » annoncées comme telles et numérotées mais ne digressant depuis aucun propos central, de l’abus ad nauseam d’expressions à préfixes pseudo-lacaniens du type « non-couleur », « entre-deux-espaces », « quasi-citoyens » à l’exercice de truffage qui consiste à semer du mot anglais, italien ou latin comme s’il était acquis qu’il suffisait d’importer un mot pour créer un concept, la texture même de cet « essai » prête parfois à rire mais le plus souvent à s’interroger sur le nombre d’arbres abattus pour imprimer certains volumes.

L’ouvrage d’Hervé Fischer, en revanche, ne triche pas, tandis qu’il traverse un champ de mines. Il traite de la couleur dans son ensemble, des couleurs, de toutes les couleurs. Le respect qu’inspire l’auteur tient aussi à ce qu’il prend en compte les théories existantes sur la couleur et qu’il tente de les articuler une à une à sa thèse. On parcourt ainsi avec lui, et avec méthode, malgré un fouillis de références aussi pénibles qu’utiles mais qui auraient gagné à figurer en note, l’ensemble du chemin qu’il a parcouru seul.
Si l’on est au début plutôt sceptique, la sensation que l’auteur est sur une piste ne cesse de se renforcer. Parce qu’il y a un parti pris : Hervé Fischer souhaite établir la possibilité d’une sociologie des couleurs. Tout l’intérêt de son entreprise tient à ce qu’il ne s’agit pas d’un livre psychologisant, qui s’arrêterait à une description ou à une analyse de la réception subjective des couleurs. Cela a déjà été fait, parfois avec brio. Et ces textes, pour les plus honnêtes, revendiquent le caractère peu scientifique de leur approche.
Il ne s’agit pas non plus d’un livre strictement culturaliste, alors même que c’est la matière de son étude. De la fête des couleurs en Inde à l’œil ensanglanté d’Horus, Hervé Fischer explique le rôle culturel, politique, psycho-social des couleurs au cours des siècles et dans différents pays, mais, si c’est la matière de son étude, ce n’est pas son but.
Ce n’est pas davantage une analyse strictement nominaliste, bien qu’il aborde la question du nommage des couleurs et insiste sur son importance.
Imitant Durkheim qui s’empara du phénomène du suicide et démontra qu’il était possible de l’aborder de façon « scientifique », puisqu’il était possible de prévoir le nombre de suicides à venir au sein d’une population donnée, fondant au passage la sociologie, Fischer tente d’établir un lien entre la codification plus ou moins grande des couleurs dans une société donnée, la réduction de leur nombre officiel, la rigueur de leur instrumentalisation sociale et le degré de régulation politique et sociale de ladite société.
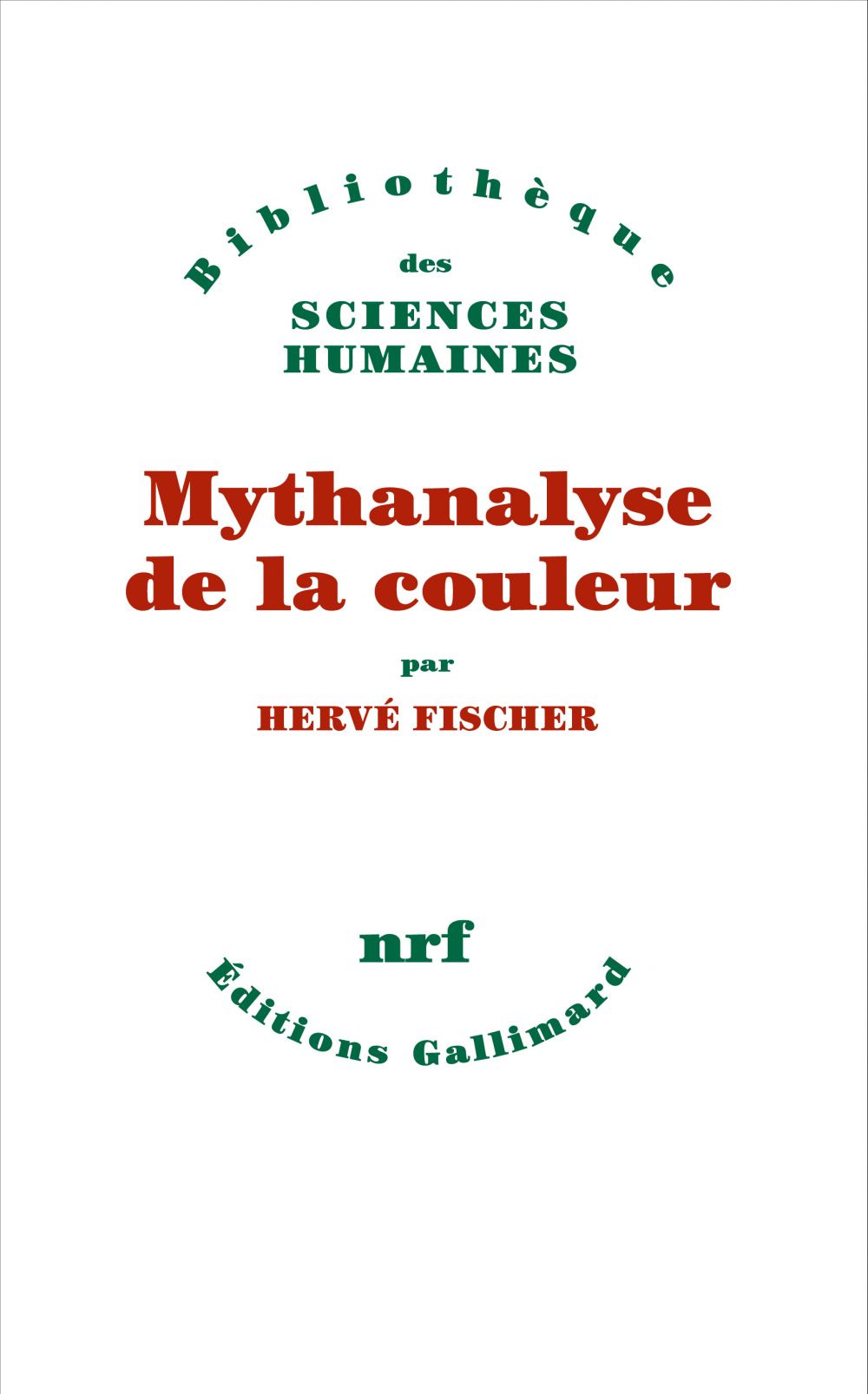
Plus l’usage des couleurs serait ouvert et désordonné, plus la société serait « libre » ; plus cet usage serait rigide, codifié et simplifié, plus la société serait, parfois à l’insu de ses participants, régulée, corsetée. La couleur serait à la fois le moyen et le symptôme d’un phénomène social total d’intégration et de contrôle. On n’est vraiment pas loin de la notion d’anomie durkheimienne transposée du suicide aux couleurs et, à le lire, on s’apprête assez vite à critiquer sur cette base son analyse. Mais il finit par être convaincant en déployant un maquis d’exemples dont le nombre finit par porter. Il a peut-être levé un lièvre, un énorme lièvre.
Ce qui mérite que l’on s’attarde sur cet ouvrage, c’est que le souci scientifique d’Hervé Fischer s’applique à ce qui semble échapper par nature à toute approche scientifique. Il ne choisit pas son camp entre les tenants d’une approche « réelle » de la couleur (colorimétristes, newtoniens, essentialistes, etc.) et ceux d’une approche « humaine » de la couleur (phénoménologues, psychologues, ethnologues, etc.). Il essaie de ramener dans le giron du positivisme tout ce qui pourrait sembler ne relever que de la fantaisie des imaginaires ou de l’arbitraire des cultures. En cela, il s’agit d’un véritable « essai », dans le sens expérimental du terme.
« Plus l’usage des couleurs serait ouvert et désordonné, plus la société serait « libre » ; plus cet usage serait rigide, codifié et simplifié, plus la société serait, parfois à l’insu de ses participants, régulée, corsetée. »
Contrairement à Peter Sloterdijk, Hervé Fischer a quelque chose à dire. Il pense que la couleur devrait constituer un champ à part entière de la sociologie et cherche à l’établir. Il proclame des « lois sociologiques de la couleur », évoque un « indicateur sociochomatique », bref, il tente le coup pour de bon. On pourra lui reprocher tout ce que l’on peut reprocher à la sociologie. En fait, tout ce que l’on peut reprocher aux « sciences humaines ». La liste est longue mais qui regrette qu’elles existent ?
Je tiens à ajouter qu’Hervé Fischer reste humble dans un texte qui témoigne d’une immense culture et d’un travail de recherche en amont impressionnant. Il dit sans ambages combien son entreprise est périlleuse, il ne cesse de rappeler combien la couleur subit, comme l’argent d’ailleurs, les soubresauts de l’irrationalité humaine. Il ne disqualifie pas les autres conceptions de la couleur pour appuyer la sienne, il essaie de leur donner un cadre global, dont il constate lui-même à quel point il est encore brouillon.
Je ne suis pas certain qu’il ait réussi, et beaucoup de ses analyses politiques ou culturelles héritent à mon sens trop de Marx et de Jung. De grands aînés polluent son propos. Mais ce qui est évident, c’est qu’il a essayé, avec audace et avec un authentique souci de méthode. Si ce livre se révélait à l’avenir avoir contenu le germe d’une nouvelle science, d’un nouveau savoir, je ne serais qu’à moitié surpris.
Marc Molk est peintre et écrivain. Dernier livre paru : Plein la vue. La peinture regardée autrement (Wildproject, 2014)







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)




![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)