Rééditer, en le retraduisant, le fameux Kantbuch de Heidegger, ou, selon son titre officiel, Kant et le problème de la métaphysique, soixante-dix ans après la traduction Biemel-de Waelhens, sans que le nouveau traducteur puisse justifier de la nécessité d’une retraduction, de ses différences avec celle de 1953, fait partie de la tératologie éditoriale, qui frappe souvent, mais particulièrement l’édition du corpus heideggérien.
L’éditeur allemand Klostermann, sans doute soutenu par les ayants-droit, interdit l’ajout de tout commentaire étranger à ceux publiés dans l’édition allemande, et on pensait que la prohibition touchait également les retraductions. Si sur ce dernier point l’étau se desserre, c’est tant mieux. Mais les deux précédents traducteurs, dont l’un devait assumer en collaboration également la première version de Sein und Zeit en français (paru aux éditions Gallimard en 1964), avaient pu introduire l’ouvrage par un long texte d’exégèse (il faut aussi souligner la qualité de la quatrième de couverture de l’édition de 1953), Marc de Launay, lui, remarquable connaisseur et traducteur de la philosophie allemande, notamment du néokantisme spécialement concerné par le Kantbuch, à qui nous devons, récemment, la direction de la Pléiade Nietzsche, ne disposera pas de cette opportunité et on ne peut que le regretter. Pourtant, le dossier de presse, document que le l’acheteur de librairie ne verra pas, comprend un embryon d’analyse : il y est précisé que cette nouvelle traduction s’appuie « sur les acquis en matière de traduction heideggérienne qui se sont sédimentés au cours de 70 ans » écoulés depuis la première édition française, qu’elle est conforme à la dernière édition allemande de 1991. Celle-ci reprend les appendices de la dernière édition du vivant de Heidegger (1973), le résumé de sa conférence à Davos en 1929 et le verbatim de la discussion sur le sens de la pensée kantienne qui s’ensuivit avec Cassirer. Les éditeurs ont ajouté les notes de l’exemplaire personnel du philosophe, son compte rendu, paru en 1928, de Philosophie des formes symboliques, t. 2, la pensée mythique (trad. fr. de Jean Lacoste, Minuit, 1972), ouvrage que Cassirer avait publié en 1925, les réponses aux critiques du Kantbuch, et notamment celles à la longue recension que Cassirer avait fait paraître dans les Kantstudien en 1931, et, enfin, un texte sur la chaire de philosophie de l’université de Marbourg. Du point de vue de l’importance du texte, le dossier de presse ajoute que la parution en 1953 de la première édition française avait fortement contribué à « dégager [la pensée de Heidegger] de sa lecture existentialiste qui avait d’abord prévalu dans l’ambiance sartrienne de la France de la Libération ».
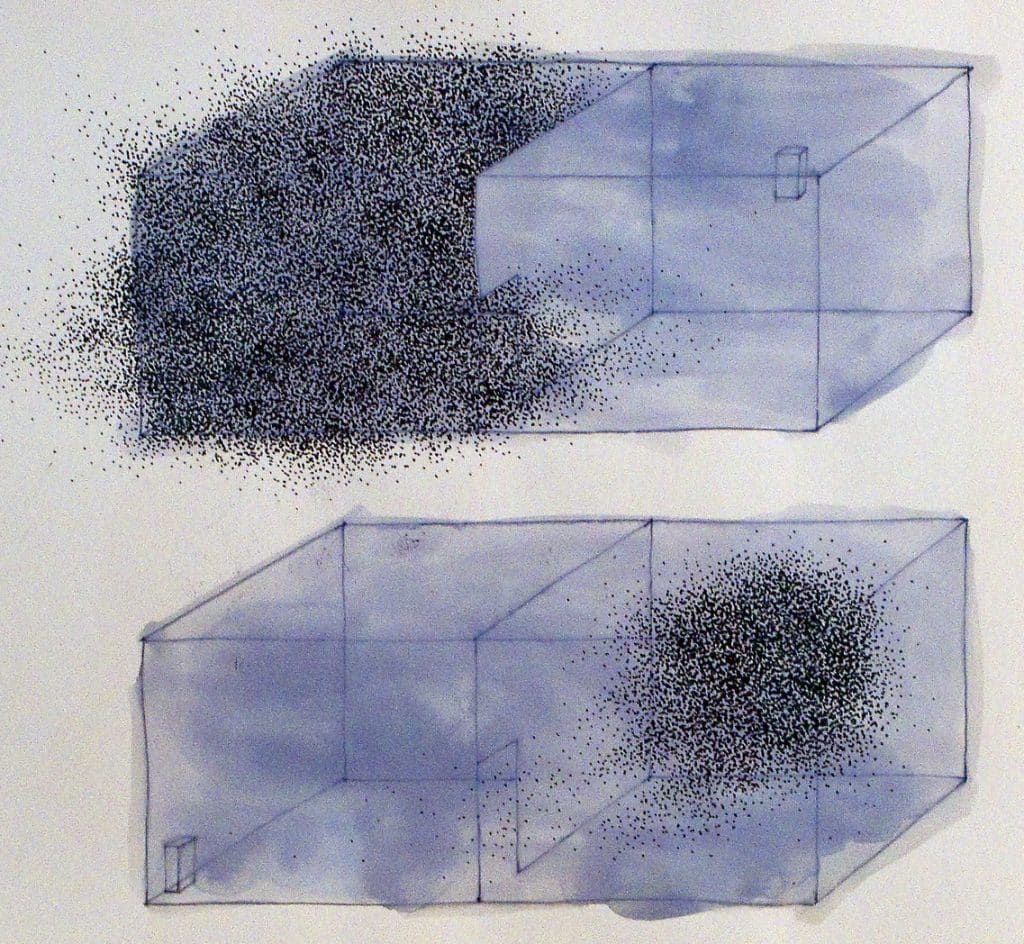
Quant à la quatrième de couverture de cette nouvelle édition, document lu par le lecteur-acheteur, elle contient une erreur manifestement introduite dans le souci d’en souligner la « valeur ajoutée ». « Les éléments de discussion avec Cassirer » ne sont pas publiés pour « la première fois en français ». On se rappelle la mémorable édition, dirigée par Pierre Aubenque, chez Beauchesne en 1972 de Débat sur Kant et la philosophie [1], qui rassemblait à peu près les mêmes textes, les conférences des deux protagonistes, leur débat et les recensions croisées des ouvrages respectifs des deux philosophes. Avant d’en venir au Kantbuch lui-même et de clore ce préambule historico-éditorial, Il est important d’insister pour dire que, là encore, il s’agit d’une retraduction qui se fonde sur des textes, en particulier le résumé de la conférence de Heidegger et le compte rendu de la discussion, relus par l’auteur lui-même et donc plus sûrs que ceux dont disposait l’édition Aubenque de 1972. Pour l’essentiel, il faut dire que Marc de Launay reste fidèle à la traduction Aubenque.
Sans s’amuser au jeu des comparaisons entre la traduction de 1953 et celle que nous propose aujourd’hui Marc de Launay, on peut, malgré tout, s’arrêter sur un paragraphe crucial, le 41, dans lequel apparaissent au moins deux des plus célèbres propositions philosophiques du XXe siècle : « Il n’y a d’être et il ne peut y en avoir que là où la finitude s’est faite existence » (1953) ; « Il n’y a et il ne doit y avoir quelque chose comme l’être qu’à partir du moment où la finitude est devenue existante » (2023). Proposition à laquelle il faut ajouter celle-ci : « Plus originelle que l’homme est en lui la finitude du Dasein » (1953) ; « La finitude du Dasein en l’homme est plus originaire que lui » (2023). La proximité des deux versions est un peu trompeuse car, pour l’essentiel, Biemel et de Waelhens, en 1953, ne disposaient pas du recul nécessaire par rapport à une œuvre toujours en train de se constituer ; notamment, ils ne pouvaient pas connaître des textes capitaux pour la compréhension de la longue explication de Heidegger avec Kant, qui commence dès 1927 avec le cours intitulé Interprétation phénoménologique de la Critique de la raison pure (trad. fr. E. Martineau, Gallimard, 1982), publié seulement en 1977, se poursuit avec Qu’est-ce qu’une chose ? (1962, trad. fr. 1971), et les Thèses de Kant sur l’Être (1963, trad. fr. 1968). Par sa situation chronologique, Marc de Launay possède cette vision d’ensemble sur le corpus kantien de Heidegger et, comme le souligne le dossier de presse, se trouve plus averti que ses prédécesseurs des contresens possibles à propos de la traduction des concepts centraux du philosophe de la Forêt-Noire.
Kant et le problème de la métaphysique, titre ambigu puisque, et Heidegger le souligne dans ses remarques préliminaires à la réédition de 1965, il faut le comprendre comme le problème pour la métaphysique devenant celui « de la métaphysique en tant que telle », représente une étape décisive dans le cheminement de son auteur. Conçu initialement dans le cadre de l’élaboration de la seconde partie de Sein und Zeit comme « document préparatoire », dans le sillage du cours sur Kant prononcé en 1927-1928, il en signe en quelque sorte l’échec définitif, puisqu’elle ne verra jamais le jour. C’est par « la violence de [ses] interprétations » (avant-propos de la seconde édition de 1950), par la « surinterprétation » (avant-propos de l’édition de 1973), que ce texte « refuge » (comme le traduit la version italienne, la française donnant « échappatoire ») relance la question de Sein und Zeit et arrache, tout en la lui révélant, Heidegger à l’histoire de la métaphysique, en particulier dans sa dernière posture allemande, le néokantisme. Ce dernier, malgré l’approbation de Cassirer concernant l’importance pour Kant du schématisme, ne manquera pas de protester contre ce coup de force interprétatif, légitime aux yeux de Heidegger, puisque exigé, non par une philologie scrupuleuse, mais par « un dialogue entre penseurs ».

Au-delà de l’interprétation de Kant, ce qui continue de fasciner aujourd’hui, c’est la manière dont Heidegger prend peu à peu la mesure de ce qu’il a accompli dans son œuvre-phare, à savoir une sorte de subversion totale de toute l’ontologie occidentale (§ 50 de Sein und Zeit). En pensant (de manière « inouïe », comme le souligne Jean-François Courtine) l’Être comme fini, comme il l’affirmera clairement dans Qu’est-ce que la métaphysique ? (1938), en même temps que la finitude du Dasein, tous deux réunis dans la proposition qui énonce qu’il n’y a d’Être que pour un étant fini (le Dasein) ‒ en clair, c’est parce que l’homme, pas celui de l’anthropologie philosophique mais le « être-le-Là », le Dasein, est mortel qu’il y a de l’Être ‒, il s’approche, sans encore en dégager tout le sens, ce qu’il fera dans les textes, publiés tardivement, de la fin des années 1930 en abandonnant progressivement la thématique de la finitude, de la pensée de l’Ereignis, comme ce qui « approprie » l’Être et le Dasein et ouvre l’histoire de leur désappropriation dans l’oubli du premier commencement de la philosophie, dans lequel l’Être est confondu avec l’ens commune ou avec ce qui est le plus être (l’esse subsistens), mais également la possibilité d’un nouveau commencement qui sera la grande affaire du philosophe après la Seconde Guerre mondiale.
Si ce point n’a pas été vu par les contemporains, comme en témoignent les notes de lecture de Husserl (trad. fr. Minuit, 1993), peut-on dire que Maurice Blanchot, dont Kimé publie opportunément les Notes sur Heidegger éditées par Étienne Pinat et qui s’intéresse à Heidegger dès la parution de Sein und Zeit grâce à son ami Emmanuel Levinas, l’ait aperçu ? Avant de répondre à la question, il faut dire un mot de l’édition Kimé. Elle s’inscrit dans une collection, « Corpus Blanchot », dirigée par Eric Hoppenot et destinée à promouvoir les archives Blanchot conservées à la Houghton Library de Harvard. Kimé abrite également une collection, « Archives Maurice Blanchot », qui compte déjà plusieurs volumes, alors que ne sont inscrits, pour l’instant, que deux volumes dans « Corpus » et le lecteur ne comprend pas bien pourquoi il existe deux collections, d’autant que dans son liminaire il est précisé que la collection publiera des dossiers d’archives, comme c’est le cas avec le dossier Blanchot, lecteur et traducteur de Heidegger, et des essais sur l’écrivain. Mais tout cela est sans importance au regard de la chance que nous avons de voir les archives Blanchot, désormais « américaines », exploitées éditorialement au profit de tous.
Ces archives révèlent donc que, non seulement Blanchot était un grand lecteur de Heidegger, ce que nous savions tant le rapprochement d’abord puis l’éloignement d’avec le Souabe rythment l’évolution de sa pensée, mais aussi qu’il en a été un traducteur. Le « choc » qu’il dit avoir ressenti à la lecture de Sein und Zeit ne portera tous ses fruits que dans les années 1950 (la « décennie heideggérienne » [2] de Blanchot, écrit Pinat), durant lesquelles, sans cesser de lire les commentateurs du philosophe, il bataille avec les textes et la pensée de Heidegger à travers la traduction. L’édition Pinat de Kimé nous fait entrer en quelque sorte dans l’œuvre ésotérique du critique-écrivain, dans son atelier. Il tisse de ses propres commentaires la traduction des passages qui l’intéressent dans l’œuvre, quelquefois une phrase, d’autres fois un bout de paragraphe, s’appuyant ou non (et pour cause) sur les traductions existantes. Il fait de même avec les commentateurs, aussi bien Jean Wahl que les auteurs allemands non traduits. Ce dossier nous livre les soubassements, son intelligence de l’œuvre, à partir desquels Blanchot va se détacher des analyses heideggériennes, et, sous l’influence grandissante de Levinas, s’émanciper de l’Être pour privilégier le « neutre ».
Quel est le Heidegger de Blanchot, pour reprendre la question posée plus haut ? Du Kantbuch, qui nous concerne de près ici et qui va nous servir de fil rouge, il ne traduit des extraits, en s’appuyant sur la version de 1953, que de la quatrième et dernière section qui contient nos fameuses propositions sur la finitude du Dasein. Mais il ne semble pas faire grand cas de cette voie empruntée par Heidegger, car, quand il s’attache à traduire les extraits qui retiennent son intérêt de Qu’est-ce que la métaphysique ? (1929), il concentre son attention sur la postface ajoutée en 1949, en passant à côté de la non moins fameuse proposition : « l’Être lui-même est fini dans son essence et ne se révèle que dans la transcendance du Dasein qui se tient dehors à partir du néant » (trad. Corbin modifiée). Ce qui rejaillit sur la grande attention qu’il prête aux analyses de l’angoisse dans Sein und Zeit. Il semblerait que, comme l’explique Pinat dans son article de Philosophie, découvrant le « Rien » avec Heidegger, il s’y maintienne, alors que celui-ci le ramène de quelque façon à l’Être, c’est-à-dire au positif, à la « possibilité » et, par là, à la maîtrise du Dasein.
Après les années 1950, Blanchot ne suit plus de près l’évolution de la pensée de Heidegger. A la fin de la décennie, dans une lettre à un correspondant inconnu, déjà publiée dans Philosophie et insérée à la fin du volume Kimé, il ne paraît retenir que la dimension d’« écrivain » d’un auteur dont il est difficile de dire, en reprenant la formule qu’il emprunte à Karl Löwith, s’il est un « poète pensant ou un philosophe poétisant ».
[1] Cette publication a connu des vicissitudes dans sa diffusion, puisque Heidegger allait publier l’année suivante, en 1973, la quatrième édition du Kantbuch contenant précisément le « dossier Davos ».
[2] Dans le numéro de la revue Philosophie (Minuit) de septembre 2021 consacré à Maurice Blanchot, Étienne Pinat parle de « décennie phénoménologique ».












