Il y a trente-cinq ans, Claude Burgelin faisait paraître l’une des premières études sur l’œuvre de Georges Perec (1988). Depuis, ce spécialiste des écritures de soi n’a eu de cesse d’explorer l’œuvre de l’auteur de W ou le souvenir d’enfance. Après avoir dirigé un Cahier de l’Herne consacré à Perec (2016) et participé à l’édition de ses œuvres dans la Pléiade, il a signé l’album Perec dans la même collection (2017). Avec Georges Perec, Claude Burgelin signe un essai biographique passionnant dans la prestigieuse collection « Biographies-NRF » (Gallimard). Moins biographie d’un homme que d’une œuvre, ce livre, fraîchement récompensé par le prix Goncourt de la biographie, déploie avec une érudition jamais ennuyeuse les multiples plis dans lesquels Perec a su envelopper les secrets de son histoire. Une lecture indispensable pour les perecquiens les plus aguerris, comme pour toutes celles et ceux qui veulent aller au-delà des idées toutes faites sur Perec et son œuvre, d’une inépuisable profondeur. Alexis Buffet s’est entretenu avec Claude Burgelin.

Dans votre prologue, vous écrivez que Perec est cerné par « le visage qu’il s’est fabriqué au fil des années » mais aussi par la masse des propos qui l’entourent, voire des clichés (dans les deux sens du terme) qui tendent à le figer dans la posture de l’auteur léger, amusant, oulipien. Le choix de la photographie de la couverture de votre livre est à ce titre éloquent : on y découvre un Perec plus jeune, aux cheveux courts, sans collier de barbe, jouant nerveusement avec ses doigts. On est loin de l’image du Perec au chat sur l’épaule devant laquelle, écrivez-vous non sans ironie, les lecteurs « ronronnent d’aise ». « Perec, dites-vous encore, est maintenant biographié, pensé et classé. » Ma première question est donc celle-ci : quelles sont les raisons qui vous ont poussé à entreprendre cette biographie ?
La raison est une commande. Il se trouve que j’ai fait l’album Perec de la Pléiade et Ran Halévi, qui dirige la collection « Biographies-NRF » chez Gallimard, a souhaité me connaître. J’y suis allé en me disant, s’il me demande une biographie, je dis non. S’il me propose un essai biographique, on verra… Et ses premiers mots ont été de me proposer un essai biographique. Donc j’ai dit oui. J’ai dit oui, d’autant plus que j’ai écrit un bouquin sur Perec il y a déjà quarante ans et que la connaissance de Perec a incroyablement crû ces dernières années. On connaît à présent beaucoup de textes que j’ignorais à l’époque. Et puis j’ai toujours le sentiment d’une dette à l’égard de Perec, le sentiment que j’avais à être son témoin, son introducteur…

Au début de votre ouvrage, vous rapportez votre première rencontre avec le para Perec. Vous avez été relativement proche de lui, vous avez été membre de la revue – ou, plus exactement, du projet de revue – La Ligne générale, vous n’avez jamais perdu contact avec lui, et pourtant vous vous interrogez sur votre légitimité à parler de Perec et de son œuvre. Pourquoi cette crainte ?
Légitimité, autant qu’un autre, mais vraiment pas plus qu’un autre : c’est cela que j’ai voulu dire. J’ai commis le même contresens que les amis de Proust ont commis à son égard, trouvant que l’auteur de la Recherche était un lettré fin et charmant sans voir de quelle entreprise il allait être porteur. Dès que Perec parlait, c’étaient quarante jeux de mots à la minute. Il faisait rire délicieusement. Mais c’était aussi un masque et j’ai mis du temps à voir de quoi était fait ce masque. Et d’autre part, j’ai été un peu surpris par la suite de ses livres : le premier que j’ai lu, jadis, c’était Le Condottiere. En le lisant, je me suis demandé : qu’est-ce qu’il cherche avec cette histoire de faussaire ? C’est ça la première chose dont il a besoin de parler ? Ensuite, j’ai lu des livres qui me paraissaient très originaux et stimulants, mais je ne discernais pas comment l’empilement de ces textes commençait à constituer une œuvre. Il y avait une dimension d’énigme : où voulait-il en venir ? C’est devenu clair pour moi à partir de W ou le souvenir d’enfance, c’est-à-dire qu’il m’a fallu du temps, une dizaine d’années, pour entrevoir les tenants et aboutissants de son œuvre.
Jean-Pierre Salgas avait judicieusement baptisé Perec le « contemporain capital posthume ». Or, vous dites qu’il n’a jamais manifesté un sens aigu de la stratégie littéraire. Pourtant, cette absence de stratégie a contribué à façonner son image. Comment l’expliquez-vous ?
Sans doute avait-il conscience et du champ littéraire et de ce qui s’y joue. Mais au début, il a éprouvé le besoin de ne pas jouer le jeu, de ne pas être repérable, de ne pas être assigné – à une place, un rôle, une fonction, comme celle du romancier réaliste après Les choses. Certainement, il a été attristé que W n’ait pas été compris. Le roman a eu un honnête succès d’estime mais c’est tout, alors qu’il y disait des choses essentielles de sa vie. Le succès n’est venu qu’avec La vie mode d’emploi (1978), et encore, il n’a eu le prix Médicis qu’au huitième tour avec une seule voix de majorité. Et il l’a obtenu avec l’appui paradoxal de Robbe-Grillet…
On le voit tout de même, dans ses moments de déprime, tracassé par le manque d’audience, ou par la réussite d’autres écrivains : « Je ne suis qu’un pitre. Je n’ai pas le droit de me réclamer de Roussel et de Queneau etc. etc. / Je ne serai jamais Leiris. Leiris ne me lira jamais etc. etc. […] Je suis envieux je suis méchant : la gloire de Sollers (ou de Le Clézio) m’empêche de dormir / Je suis un con […] Je ne supporte pas d’être méprisé ou ignoré ».
Il avait un rapport compliqué aux médias. Au fond, il était beaucoup plus à l’aise avec le tout-venant du public des ateliers de l’Oulipo : c’était un merveilleux pédagogue, souriant, gentil, aimant expliquer son travail, ce qu’il faisait. Il se présentait comme un artisan des lettres, non comme un « Artiste ». Je ne suis pas sûr qu’il ait utilisé le mot « œuvre », encore moins qu’il ait dit « mon œuvre ». Il voulait à la fois « rester caché » et « être découvert ». Mais pas découvert comme avec les médias et leurs généralisations hâtives.

La trajectoire éditoriale de Perec est aussi marquée par sa rencontre avec deux grands éditeurs qui le soutiennent dans ses projets parfois un peu fous : Maurice Nadeau et Paul Otchakovsky-Laurens. Quel rapport entretenait-il avec eux ?
Maurice Nadeau, c’était le bourru bienfaisant. Pas toujours convaincu par les projets de Perec. En même temps, il avait un coup d’œil amical, amusé sur lui. Mais les expérimentations de l’Oulipo, l’ont-elles vraiment intéressé ? Paul Otchakovsky, c’est un peu l’inverse. Il y avait une vraie ferveur, une attention aiguë de sa part. Otchakovsky a été pour Perec un véritable éditeur, avec de vraies qualités d’amitié, sans compter que sa vie avait des consonances avec celle de Perec.
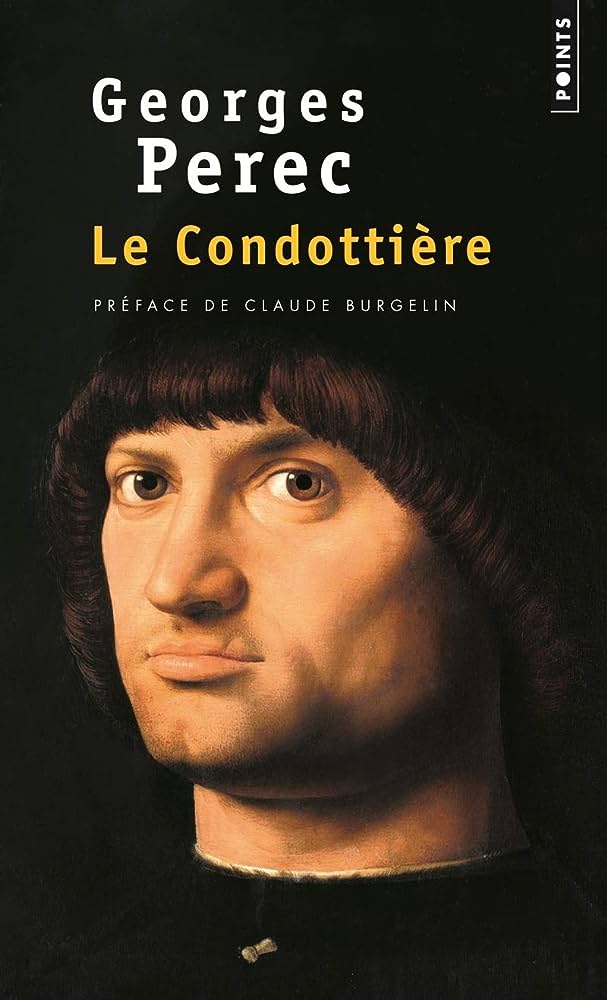
L’œuvre de Perec est remarquablement diverse. Elle frappe par la mobilité de son inspiration, de son écriture, de sa langue. Elle laisse entendre une multitude de voix. Et néanmoins, vous faites émerger des lignes de force au premier rang desquelles : la distance ironique (y compris vis-à-vis de soi, de sa langue), mais aussi, précisément, sa « kleptomanie verbale » qui tient autant du « chapardage » que de la « piété », kleptomanie mise en récit dans un de ses derniers textes, Le voyage d’hiver. Pourquoi toujours cette mise à distance de soi dans l’écriture, cette volonté d’être là où on ne l’attend pas ?
Parce que je crois qu’il avait une inhibition très grande à parler de lui. Aujourd’hui, on peut comprendre pourquoi le premier roman achevé vraiment, Le Condottiere, raconte une histoire de faussaire. Il savait qu’il avait besoin du faux, qu’il s’éprouvait lui-même comme faux. Faux enfant de Belleville, faux enfant d’Auteuil, on peut choisir… Et en même temps, derrière cette kleptomanie verbale, il y a peut-être une figure archaïque, très ancienne, celle du chiffonnier juif qui va ramasser çà et là un bout de tissu. Perec nous dit : « Cherchez moi ! Je suis caché, et en même temps j’exprime quelque chose de ce que je suis. » En écrivant ce roman sur la condition de faussaire qu’est Le Condottiere, il laisse entendre qu’il ne parviendra jamais à incarner véritablement des personnages, qu’il ne sera jamais l’auteur de Madame Bovary. Il y a en lui comme un évidement intérieur qui le lui interdit. Un bon romancier est capable de créer des personnages avec une densité charnelle. Perec sait qu’il ne sera pas celui-là, mais que l’intérêt romanesque viendra de la façon dont il ajointera lettres, pièces de puzzle, structures diversement complexes.
Vous évoquez la métaphore du fabricateur de puzzles (Perec) et du poseur de puzzles (son exégète, son biographe, ou tout simplement son lectorat). Perec n’a-t-il pas été, tout compte fait, l’un et l’autre ? La fabrication de ses puzzles narratifs n’était-elle pas déjà une tentative de résoudre l’énigme de son existence ?
Absolument. J’ai été très frappé par la réaction d’une dame qui m’a dit avoir pleuré à la lecture de W à cause de la « fragmentation » vécue par cet enfant. J’ai été surpris, je ne m’attendais pas à ce mot. De fait, on a affaire à une vie totalement fragmentée. Dessiner son enfance à partir de l’image du puzzle, c’est donner la place principale à la cassure et à la difficulté à ajointer ces fragments brisés.

Dans Un homme qui dort, le narrateur écrit : « Tu préfères être la pièce manquante du puzzle. » Il faut donc y entendre la voix de Perec ?
Oui, c’est Perec. Et ce qui frappe par-dessus tout, c’est ce tu préfères être dans l’absence. Néanmoins, il a su tirer parti de ce désastre. Il en a fait un moteur de construction narrative de façon éblouissante. Faire du manque et du faux les instruments avec lesquels construire, l’idée était géniale. Ce qui me saisit toujours chez Perec, c’est l’extraordinaire acuité de son intelligence.
Son écriture, foncièrement littéraire, ne cesse de regarder vers d’autres disciplines : la sociologie, la rhétorique, la sémiotique, ou encore la psychanalyse. Pourtant, elle se tient à distance, n’y adhère jamais pleinement. Pourquoi cet écart ?
Je crois que c’est l’écart-même de l’intelligence et de la liberté. Perec ne pouvait se reconnaître dans les procédures et le lexique des sciences sociales. Il n’a pas eu, par exemple, besoin de lire beaucoup Foucault pour comprendre où il veut en venir, alors même que l’obsède la question des limites et démarcations.
Comment expliquer que l’Histoire, dans ses grands remuements, soit autant tenue à distance par Perec ? Elle n’est certes pas absente, mais toujours en sourdine, allusive, presque anecdotique, c’est vrai dans Quel petit vélo…, dans La vie mode d’emploi ou dans Je me souviens.
C’est étonnant, en effet. Il appartient à cette génération qui a commencé à se défier de l’Histoire avec ses fils narratifs trop bien tissés. Au fond, la problématique des lieux a remplacé chez lui la problématique du temps. Les lieux sont fragmentés, certes, mais on peut avoir, comme le fait vivre Espèces d’espaces, une expérience concrète, sensorielle, de chaque lieu. Et cette expérience est verbalisable, et non dogmatique. Parler des lieux suppose qu’on accepte la notion de coupe et de fracture. Or, l’Histoire des historiens propose un trop-plein de sutures et de rationalisations. Le grand roman historique du XIXe siècle prend assise sur l’Histoire. L’Histoire y devient matériau narratif. Perec était très admiratif de cela… mais il était ailleurs.
Vous citez à plusieurs reprises les écrivains que Perec aime, aime lire, aime relire. Parmi eux, Flaubert, Kafka, Melville, et plus proches : Roussel, Antelme, Queneau dont l’influence est évidente, mais aussi Michel Leiris. Et je vous avoue que ce dernier nom m’a interpellé : Leiris, c’est la prise de risque du dévoilement intégral, sans censure. Quand on voit comment Perec enfouit le substrat autobiographique sous des fictions, quand on voit son rapport beaucoup plus sinueux, oblique (pour reprendre un terme qu’il affectionne) à l’autobiographie, le nom de Leiris brandi régulièrement comme référence peut surprendre. Qu’est-ce qui fascinait tant Perec chez Leiris ?
D’une certaine façon, Perec aurait-il voulu être Leiris, c’est-à-dire prendre le risque du dévoilement, de parler de sa sexualité sur laquelle il a mis d’évidentes feuilles de vigne, de dire sa sensualité alors qu’il ne la dit que rarement ? Par ailleurs, il admirait chez Leiris cette passion des mots – Glossaire j’y serre mes gloses –, cette façon de les décortiquer. Perec lui-même passait son temps à désassembler les mots, à jouer avec leurs lettres, à les anagrammatiser, à les paragrammatiser, à réaliser des palindromes… Et il admirait que Leiris se dévoile tout en restant un homme secret et discret.

Vous soulignez la double polarité qui aimante l’écriture de Perec : « netteté élémentaire, trajectoires secrètes ». Le labyrinthisme y côtoie la simplicité. La cryptomanie de Perec – si jamais le terme convient – apparaît comme la résultante d’une sorte de cache-cache avec soi, d’un refoulement, ou d’un blocage. Elle est à la fois un jeu et le signe de ce centre vide où se noue la tragédie intime de l’auteur. Vous avez à ce propos une formule saisissante : vous parlez de ses livres comme de « son porte-parole et son porte-silence ». La tentation ludique, le rire de Perec n’étaient-ils que des masques ? Comment a-t-on pu, si longtemps, ignorer, ou en tout cas sous-estimer, la teneur tragique de ses livres ?
C’étaient et ce n’étaient pas des masques, parce que, effectivement, Perec adorait rire. Il appréciait l’amitié, la chaleur humaine, les bons restaurants où l’on mange des nourritures gratifiantes. Il y avait une propension au bonheur évidente chez lui. Il rendait heureux son entourage. Et en même temps, il a été souvent désespéré et il y a de la tragédie dans son destin et dans sa mort prématurée. Pour prendre la mesure de cette dimension tragique, il a fallu connaître tous ces textes publiés post mortem. Que l’on connaisse avec précision ce que fut la Shoah, comment furent vécues les persécutions nazies. Un des points sur lesquels j’ai insisté dans cet essai biographique, c’est la façon dont Perec a médité sur sa judéité. Il dit que rien ne lui a été transmis des traditions et de la culture juive. Mais, si on les cherche, on en retrouve les traces dans presque chacun de ses livres. Il ne laisse jamais oublier que le destin juif est fait d’histoires de destructions, d’exils, de terres et de liens perdus.
Quant à la cryptomanie, c’est une conduite de protection mais aussi une délectation. Ses façons de révéler et d’encrypter font souvent penser à celles de Modiano. Ses encryptages font aujourd’hui le bonheur (ou le désespoir…) de qui l’étudie. Sa cryptomanie est devenue une des marques de son identité d’écrivain. Perec jubilait à l’idée qu’un train puisse en cacher un autre. D’où la frénésie d’exégèses que ses textes suscitent. En n’oubliant jamais que chez Perec il y a toujours l’enfant qui joue.
« C’est avec comme base arrière quelques-unes des données fondatrices du judaïsme et le règne de la mort qu’a signifié la Shoah que Perec pense et écrit. » On a l’impression à vous lire que l’œuvre de Perec chemine, de façon sinueuse mais de façon inéluctable vers l’Histoire et sa propre histoire. Et pourtant, il ne cesse de la maintenir à distance, n’y donnant accès qu’à travers le mythe, de W à Récits d’Ellis Island. Partout, Perec fabrique du mythe. Et je me suis demandé, en vous lisant, si on ne pouvait lui appliquer le terme forgé par Claude Louis-Combet d’« automythobiographie » qu’il définit ainsi : « C’est une mise à distance, comme si je n’étais pas un être biographique. » Perec ne s’est-il pas pensé comme un être non biographique ?
Ce que vous dites me paraît d’une très grande justesse. D’une certaine façon, comment parler de la Shoah ? On ne peut raconter ce qu’ont éprouvé les déportés, l’asphyxie dans la chambre à gaz. Et on ne peut nommer, pour l’enfant survivant, ce que signifie la tragédie d’une telle disparition. Peut-être la seule façon d’en rendre compte est-elle d’avoir recours à la mythographie. Ce n’est pas un hasard si Daniel Mendelsohn, dans Les disparus (2006), a eu recours à la grande mythographie originelle de la genèse et de l’exode. Perec a su intuitivement assez vite qu’il ne pouvait relier son histoire à celle de l’extermination des juifs qu’en passant par le mythe, ici, l’île W.
Perec s’est abstenu d’une certaine façon d’avoir une biographie. Il parle de ses habitudes d’écrivain – et laisse verrouillé le reste. L’esprit de censure, le besoin de taire sont constitutifs de lui-même.
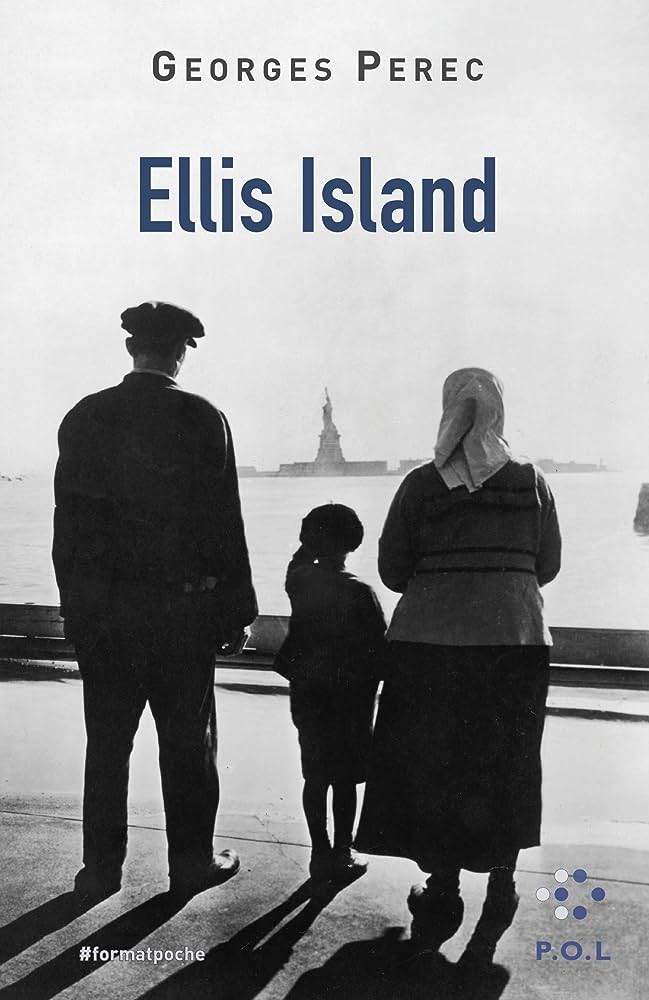
Vous montrez comment l’œuvre de Perec s’est élaborée autour d’un vide, d’une absence, d’un manque dont vous rappelez qu’il joue un rôle crucial dans le judaïsme. Or Perec entretient un rapport pour le moins compliqué à sa judéité. Il manifeste moins un refus qu’une colère. Même dans Récits d’Ellis Island, Perec dit sa différence : « Quelque part, je suis “différent”, mais non pas différent des autres, différent des “miens”. » Mettant ses pas dans ceux du juif errant (encore un mythe) « il est désormais juif de ne pouvoir l’être, exilé de la judéité ». Diriez-vous que Perec s’est finalement réconcilié avec sa judéité ?
Je crois que oui. Mais ce n’est pas tant la judéité au sens de la loi judaïque, la synagogue, etc. que le fait d’être juif. Peu à peu un verrou s’est desserré. Le fait que Perec ait voyagé en Pologne à la fin de sa vie à la recherche des traces des siens, qu’il n’a pas trouvées d’ailleurs, qu’il soit allé à Ellis Island, cela indique une forme de réconciliation. C’est à travers le destin de ces millions d’exilés que Perec a pu dire le sien propre. Philippe Zard, qui a écrit De Shylock à Cinoc (2018), parle de la « rejudéïsation » de Perec. La formule est peut-être excessive, Perec n’aurait pas aimé, je crois, être caractérisé par un terme comme celui-là, mais sur le fond, oui, il a eu peu à peu un autre regard sur sa judéité.
À la fin de votre ouvrage, vous mettez en évidence la très riche postérité littéraire et critique de l’œuvre de Perec, qui semble aujourd’hui nourrir les disciplines dont elle s’était inspirée : géographie, histoire, sociologie… Comment expliquez-vous cette incroyable fortune ?
Perec a été un formidable archer, mettant la flèche dans la cible en très peu de phrases, avec des formules faciles à retenir. Il est allé à l’essentiel en très peu de mots. Et il reste une figure tutélaire peu encombrante, avec laquelle on peut avoir les rapports les plus légers. Il a été un touche-à-tout génial, un peu comme l’a été Diderot, avec un côté facétieux et vif, sans jamais faire le dogmatique.
Il avait un côté encyclopédiste ?
Il a joué avec l’encyclopédisme. Mais c’est un faux encyclopédiste. L’encyclopédisme, les dictionnaires, ont été pour lui un terrain de jeux, de recherches hétéroclites, une façon d’inventer des réseaux.
Vous êtes l’un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre de Perec, cela fait fort longtemps que vous naviguez dans le « fatras » perecquien, que vous croisez dans cette « brume insensée », et je me demandais si vous aviez découvert encore des choses lors de ce travail ? Êtes-vous encore surpris à la lecture de Perec ?
Oui. Je vais vous dire quelque chose que je n’ai pas dit dans le livre parce que ça ne m’était pas encore venu : c’est son rapport à la magie. Il y a chez lui comme une nostalgie de la magie, le désir que les mots aient du pouvoir, qu’en les décortiquant, qu’en cherchant les formules parfaites, on puisse arriver à quelque chose qui ait le pouvoir des formules magiques.
N’y a-t-il pas aussi une nostalgie de la clarté ? d’une histoire claire, d’un langage clair ?
Oui, je crois. Et en même temps, une délectation à énoncer les voies et trajets de la complexité. C’est ce qui rend sa lecture si passionnante.












