Il faut lire Lorine Niedecker. Parce qu’elle l’une des grandes poètes états-uniens évidemment. Parce qu’elle permet aussi, au gré de la lecture consistante des textes réunis par Martin Richet dans Cette condenserie, de penser des grands mouvements qui ont animé la poésie du siècle dernier et de redécouvrir une autrice dont le but est la simplicité et que caractérisent le dépouillement et une forme de mysticisme sauvage.
Que l’espace soit une donnée fondamentale de la sensibilité américaine mais que son appréhension s’effectue sur le mode du localisme et de l’intimité n’est paradoxal qu’en apparence. Gertrude Stein l’avait déjà bien fait entendre dans son étonnant livre A Geographical History of the United States paru en 1936, proposant un cadre de réflexions quasi philosophiques sur le sujet. D’entre tous les genres littéraires, c’est la poésie qui se sera montrée la plus sensible à cet état de fait. Ainsi, Walt Whitman, considéré à juste titre comme le plus expansionniste de tous les poètes américains, se sera exclusivement concentré sur le périmètre de Long Island et de Manhattan, les deux îles constitutives de son espace new-yorkais. De même, sa contemporaine Emily Dickinson, œuvrant discrètement telle une recluse au cœur des forêts du Massachusetts, à Amherst, n’aura voyagé sur toute la longueur de son existence que du jardin de son père à celui de son frère, distants l’un de l’autre d’une petite centaine de mètres. Il en va pareillement à l’époque moderne pour le médecin gynécologue de la banlieue de New York, à Rutherford, William Carlos Williams choisissant la ville voisine de Paterson pour les six tomes de son grand poème. Dernier exemple notable, celui de Charles Olson, posant l’atelier de ses Maximus Poems dans le port de pêche de Gloucester sur la côte du Massachusetts.
Or, dans les années 1950, les poètes Beatnik n’ont-ils pas justement voulu rompre avec cette tradition de localisme et de sédentarité ? N’ont-ils pas cherché de toutes leurs forces à remettre en marche la machine du dynamisme américain, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Oui, certes, on en conviendra, mais dans une certaine mesure seulement. Ce que Ginsberg, Corso, Snyder et autres Ferlinghetti célébrèrent alors à leur façon, ce fut le dynamisme d’un autre lieu d’émergence poétique, rival et symétrique de New York sur la côte Ouest, centré autour de San Francisco. L’espace du Pacifique, pour ainsi dire ouvert et découvert à lui-même par l’industrie du film hollywoodien mais aussi par le tout récent conflit contre le Japon, offrait aux poètes un nouveau choix des sédentarités. De même pourra-t-on faire référence aux « language poets » d’il y a quelques années et parler à leur propos d’une offre de « sédentarité » universitaire sous forme d’ateliers d’écriture (« workshops ») ou de résidences favorisant l’apparition de modernes « chambres de rhétorique ». Défini comme tel par nous, ce cadre traditionnel poétique américain permet, quoi qu’il en soit, d’apprécier certaines connexions étonnantes comme celle liant l’improbable couple de « sédentaires » Lorine Niedecker et Louis Zukofsky aux deux extrémités du pays.

En son temps, Emily Dickinson n’avait bénéficié d’aucun relais ni reconnaissance d’aucune sorte par aucun éditeur. Le Wisconsin, où Lorine passera toute son existence dans un environnement encore plus sauvage que les forêts d’Amherst, sur les bords géologiquement striés de la Rock River à l’endroit où elle se jette dans le Lac Kokoshkong avant d’en ressortir et rejoindre le Mississippi, semblait devoir sceller une opacité encore plus définitive. L’État du Wisconsin est frontalier des Grands Lacs, en particulier du lac Supérieur, plus grande étendue d’eau des États-Unis, dont Lorine la « sédentaire » n’entreprendra l’exploration qu’à la toute fin de son existence. Chacun des poèmes qu’elle compose alors ressemble un peu à un message radio perdu au milieu de l’immense paysage d’eau et de vase (Je suis sortie de la vase des marais, / algue, prêle, saules / vert chéri, grenouilles / et oiseaux criards). Comment eût-il pu en être autrement ? Son père, homme original d’ascendance allemande, lui avait légué pour seul héritage quelques cabanes de location à Black Hawk Island sur le bord de la Rock River (Il rêvait pour sa fille unique / d’un travail à la banque // mais il lui avait donné une source / pour subsister / Une parole de chiendent, / un acompte de marais). Ayant commencé par un bref emploi d’assistante à la bibliothèque de Fort Atkinson, Lorine finira, dans les années 1950, par faire des ménages à l’hôpital de la même ville et par épouser un peintre en bâtiment qu’elle suivra à Milwaukee sur le lac Michigan (Guère naturel mon mariage imminent. On en fait des folies, à soixante ans. J’espère être heureuse ! Il me lie à la vie. Lettre à Cid Corman, 13 Mai 1963).
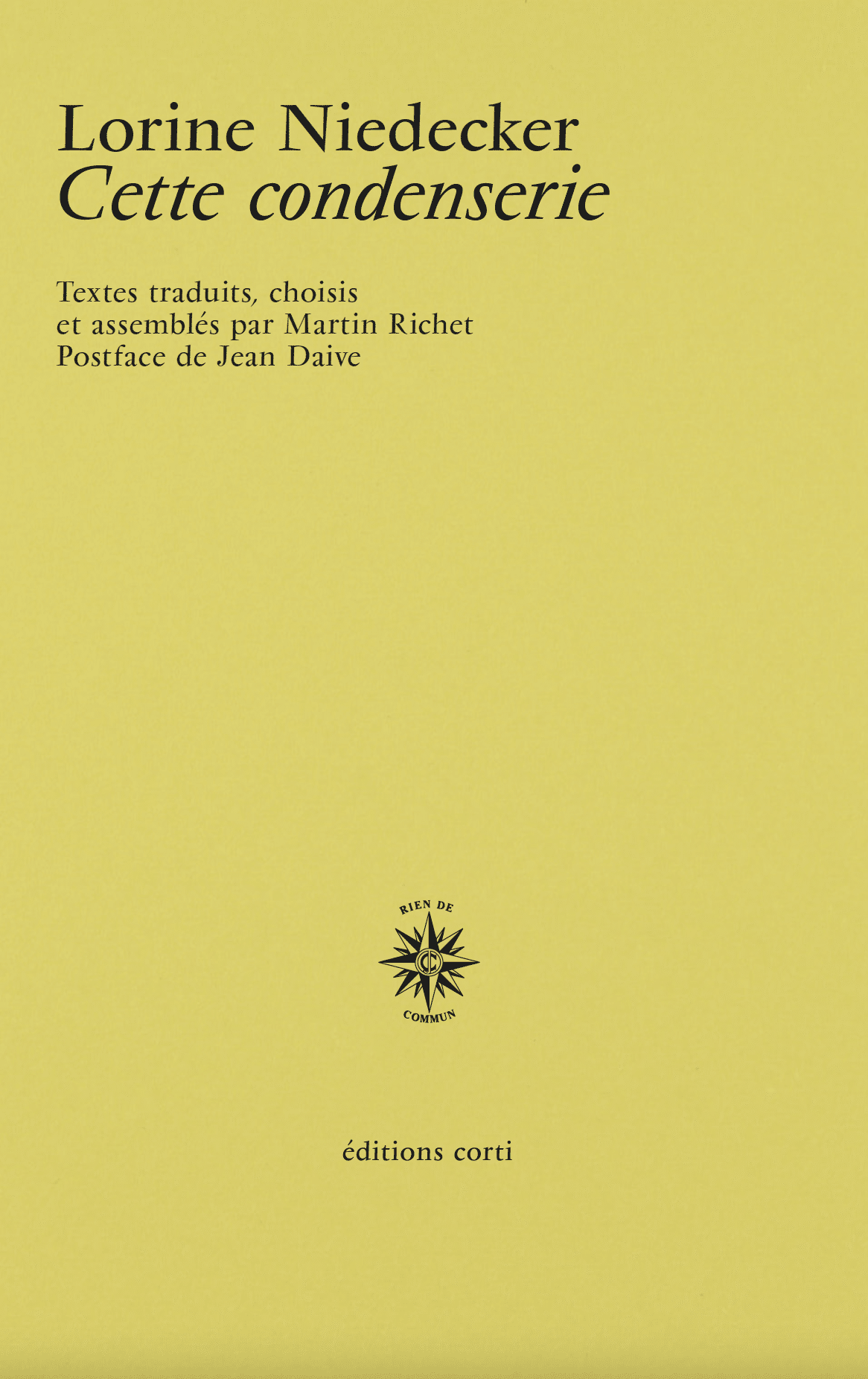
Comment la poésie put-elle bien s’immiscer dans ce quotidien d’extrême sobriété, inépuisablement menacé par l’eau des rivières en crue et la vase des marais ? C’est ici qu’intervient le numéro spécial de la revue Poetry confié en février 1931 par Ezra Pound à deux de ses disciples, Louis Zukofsky et Basil Bunting, lançant le mouvement de l’objectivisme. Tombé entre les mains de la jeune bibliothécaire, le numéro l’incita à correspondre avec Louis, le poète new-yorkais, qu’elle partit rencontrer à New York, dont elle tomba manifestement amoureuse pour le reste de son existence, ainsi qu’en témoigne la continuité de leur correspondance. Ayant entretemps épousé Célia, une pianiste, qui donna naissance à leur fils unique, Paul, lequel deviendrait un violoniste très célèbre, Louis se referma progressivement sur son « trio » familial, refermant du même coup son propre poème sur la musique et dressant une barrière d’obstacles entre Lorine et lui. Leurs deux « sédentarités » se figeraient pour ainsi dire, l’une par rétraction au cœur de la cité, l’autre par dissémination dans l’exubérance de la nature. À sa manière, ce couple rejouerait le rôle tenu par le couple Whitman/Dickinson du siècle précédent. Il est donc à la fois fortuit et passionnant que des textes de l’un et l’autre poète aient récemment paru en traduction française, d’une part le poème en 24 chants A de Zukofsky (traduction de François Dominique et Serge Gavronsky, Nous, 2020) et Louange du lieu et autres poèmes de Lorine Niedecker (traduction d’Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, Corti, 2012) mais aussi Cette condenserie.
Si le relais de Zukofsky fut à l’évidence décisif pour l’accès à la notoriété du poète des Grands Lacs Lorine Niedecker sur la scène poétique américaine, il n’est toutefois pas du tout certain que la référence à l’objectivisme suffise à expliquer sa poésie. Tel est sans doute le postulat que voudrait voir retenu la logique de réception française, mais à dire vrai la lecture de l’essai consacré en 1956 par Lorine elle-même à « la poésie de Louis Zukofsky » donne plutôt le sentiment d’un exercice laborieux de citations et de paraphrases reliées entre elles par des considérations du genre : « Le plus grand des talents de Zukofsky consiste à transmuer les événements en poésie ». On ne peut pas dire que l’hermétisme croissant du New-Yorkais en sorte illuminé. Infiniment plus vivante et vraie est l’affinité qui d’emblée lia Lorine à Cid Corman, l’éditeur de la revue Origin exilé au Japon, à Kyoto, dont la poésie est tellement proche de celle de sa correspondante. « Corman est le poète du silence », énonce-t-elle à l’entrée du bref essai qu’elle lui consacre, et l’on se dit qu’elle a forcément en tête sa propre poésie. D’ailleurs ses références sont tout de suite plus claires, moins sophistiquées. « Le lecteur pensera au Red Wheelbarrow de Williams. » Oui, en effet, Lorine Niedecker, s’avère très proche de Williams dans tout ce qu’elle écrit et cela depuis les brefs poèmes du début jusqu’aux longs poèmes de la fin dans lesquels elle intègre l’histoire de la conquête des Lacs, tribus indiennes et explorateurs européens – Audubon, Marquette, Joliet… –, comme fait Williams dans son Paterson. Plus encore que vers la « condensation », Lorine s’avance alors vers le dépouillement, une forme de mysticisme sauvage (Rien ni personne / ne m’a jamais donné / plus belle chose // que le temps / sinon la lumière / et le silence // qui s’il est intense / s’entend). La simplicité est ici son but. Elle laisse la complexité au brouillard sonore des villes.











