S’il est vrai qu’une grande œuvre ne se sépare pas des commentaires qui ouvrent devant elle les perspectives les plus diverses et parfois les plus opposées, et s’il est vrai qu’un auteur est indissociable des lectures que l’on peut en faire, d’ailleurs assez dispersées, c’est bien le cas de l’auteur de L’homme sans qualités et des Désarrois de l’élève Törless. L’homme sans qualités [LHSQ], en particulier, a par soi-même des contours indéfinis et toute lecture qui tente de s’en emparer prend le risque de s’y perdre ou de ne pouvoir pratiquer que l’exérèse de quelques axes dans un ensemble d’autres qui auraient pu être choisis en un filtrage qui, s’il est pertinent, deviendra presque aussi important que l’œuvre même, tant elle se présente, même quand son auteur est mort depuis longtemps, toujours en extension, dans un travail symbolique indéfiniment ouvert.
Les personnages, surtout féminins, déjà très nombreux, même si Ulrich occupe, avec Agathe, une place centrale dans LHSQ, pourraient se multiplier indéfiniment, un peu à la façon de ce qui se passe chez Dostoïevski et chez Tolstoï. Ulrich est un homme intelligent qui pense toutes ses expériences et c’est un « homme à femmes », dont la collection des séductions est inépuisable et qui ne laisse émerger de façon notoire de la liste de ses « conquêtes » que des cas très particuliers, jusqu’à la rencontre scabreuse qui, lors de la mort du père, conduira le frère et la sœur, longuement oubliée, à une relation incestueuse à laquelle les deux protagonistes veulent goûter, avant de mourir, comme à une sorte de fondement de l’amour, et dont ils ne seront tirés du suicide, l’un et l’autre, que par accident. Le pouvoir de séduction d’Ulrich se transmet jusqu’aux lectrices et lecteurs de Musil, et c’est à travers le kaléidoscope de ses amours qu’Ulrich comprend ou peut-être seulement vit quelque chose d’un soi précaire, de même que ses partenaires saisissent, au prix d’illusions et d’équivoques, quelque chose d’elles-mêmes à travers lui.

Chaque événement est tel que, s’il est, il aurait pu aussi bien, quoique peut-être pas avec la même probabilité, ne pas être. On se trouve d’emblée dans un cadre probabiliste, tel qu’il est offert par la théorie des jeux par exemple. Si les personnages sont saisis à partir d’éléments épars de l’œuvre et ressaisis, comme par une galerie de portraits, par Marie-Anne Lescourret, c’est pourtant à partir des événements contingents qu’ils traversent, qui les traversent et les constituent, sans qu’ils aient aucune substance, comme un ensemble ouvert de relations qui ne trouveront peut-être leurs liaisons entre elles qu’après coup. Ce qui n’a pas été choisi ou ce qui ne s’est pas produit, ce qui ne se produit pas et ne se produira pas, est aussi important que ce qui s’est produit, se produit ou se produira. Ne pas se produire est encore un mode d’existence des productions elles-mêmes. On est autant structuré par ses manques que par ses pleins. Il y a là toute une éthique conséquente, très anti-kantienne, parce qu’elle est d’emblée très anti-newtonienne dans sa conception de la loi. Ulrich et son créateur se montrent volontiers « bayesiens » dans leur façon de se conduire ou de ne pas se conduire d’ailleurs, car leur bayesianisme n’est pas forcément – même si c’est assez contradictoire – au service de décisions.
L’agnosticisme d’Ulrich est lié au fait que, vivant un certain ordre des choses, il aperçoit et vit aussi le contraire selon un certain mode, en contrechant. Pour un signifiant donné, un signifié n’est pas sans signifié contraire, un traitement n’est pas sans son placebo qui est presque aussi efficace ; un acte sans ses contre-actes. N’est-il pas curieux d’ailleurs que ce qui détermine un acte s’appelle un contrat ? Même quand Ulrich et sa sœur décideront, chacun pour soi, de se suicider, ni l’un ni l’autre ne se suicideront au bout du compte. Rien n’arrive selon le simple vœu des personnages, même pas la volonté de se soustraire une fois pour toutes au jeu de la chance. Ce jeu du réel et de l’irréel est partout ; et l’on voit l’irréel jouer à sa façon un rôle réel. Les perdants ne sont jamais complètement perdants, ni les gagnants complètement gagnants. Ce sont peut être ce ni… ni et cette incomplétude qui constituent ce qu’on appelle le réel ; mais ce n’est pas une seule détermination ou un seul faisceau de déterminations, isolés d’une totalité dont le reste serait irréel et comme s’il n’était pas, qui constitue le réel. Cette conception façonne l’éthique, la politique, les passions des uns et des autres en un système qui ne ferme ni ne s’emboîte jamais vraiment ou dont la fermeture ou l’emboîtement ne brille qu’un instant. On ne choisit jamais une option sans faire, à la fois, un sort à ce qui nie notre option. Les probabilités jouent de ces variations ; les degrés supérieurs n’occultent pas les degrés inférieurs. Le fonctionnement du parti L’action parallèle ressemble à celui de tous les partis depuis longtemps : des machines qui produisent des options probables et improbables, lesquelles s’entredétruisent de telle sorte qu’elles permettent surtout à un groupe de gens de se reconnaître entre eux, qu’ils soient ou qu’ils ne soient pas au gouvernement, qu’ils y songent ou qu’ils n’y songent pas d’ailleurs.
Marie-Anne Lescourret s’attache particulièrement à la science de l’amour qui transparaît dans LHSQ, après en avoir examiné, à travers ses personnages, et dans un jeu permanent entre le Journal de Musil et les œuvres de son auteur, une multitude d’options possibles. Platon est à l’arrière-fond de cette science – comment le personnage de Diotime et comment le thème de la réparation de l’être scindé n’y feraient-ils pas penser ? Le freudisme aussi, quand bien même il ne s’agirait nullement de quelque « retour à Freud » mais plutôt de contestation plus vive que celle des doctrines du Banquet. Lescourret met l’accent sur les relations hommes/femmes, généralement plutôt adultères, avec ou sans culpabilité, avec ou sans complicité des conjoint(e)s. Assez étrangement, ces relations amoureuses, voire simplement sexuelles, ne font pas perdre le contact avec les probabilités et leur calcul. Il semble que chacun soit, par les chemins de l’amour, à la recherche d’un complément de soi. Rien de très original dans cette inspection des dessous, parfois violents, et de l’envers du clinquant de la Vienne bourgeoise et aristocratique.
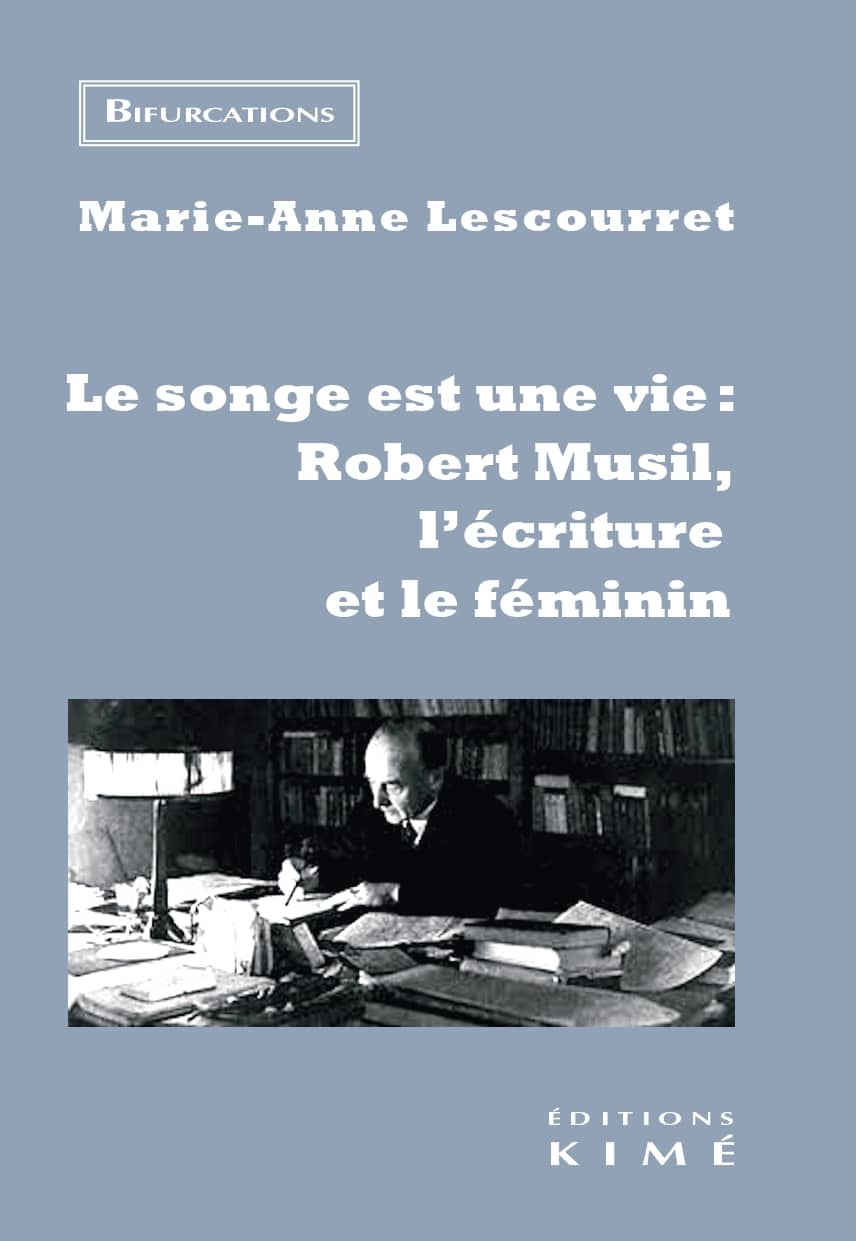
Peut-être le calcul des probabilités contribue-t-il à chercher des catégories qui soient moins celles d’une philosophie de la connaissance – puisqu’elle a tendance à les brouiller – que celles d’une philosophie de l’existence, celle-là même dont Kierkegaard s’enorgueillissait de l’avoir mieux qu’esquissée ; et l’on voit alors cette chose étonnante : le jeu des romans et des journaux de Musil est mis au service par Marie-Anne Lescourret d’un complément, sinon d’un achèvement, d’une catégorisation commencée dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Par le biais de la portraitisation qui unifie l’extrême individualisation et la généralisation : la courtisane, la femme de lettres qui choisit ses amants, l’égérie, la médiatrice, l’ambassadrice, la gourde – peut-être eût-il mieux valu parler de la potiche –, l’intellectuelle (introvertie ou exaltée), la débauchée ; et puis, peut-être, rarissime, celle qui, comme Agathe, fait rêver de lever, en raison de la relation de sororité, le voile du labyrinthe d’exister, sans qu’il s’agisse à aucun moment de religion, même si le geste y ressemble. Si la figure du père est scandaleusement présente – Agathe ne glisse-t-elle pas sa jarretière dans le cercueil de son père ? –, la figure de la mère est à peu près absente de tout le roman, sans pouvoir évidemment être complètement éludée de l’approche musilienne de la femme. Il y a, conjointement, dans l’ouverture des mathématiques qui font que ce qui est aurait pu ne pas être, quelque chose par quoi elles s’apparentent à la musique et, par-delà la musique, à l’existence elle-même, celle des rencontres – surtout des rencontres amoureuses ; sans que l’on ait à crier au miracle ou au surnaturel. Marie-Anne Lescourret commence son travail là où Jacques Bouveresse l’a laissé en quelque sorte. Grande « écouteuse » et déchiffreuse de musique autant qu’analyste experte des relations amoureuses, elle distribue des portraits selon des lignes mélodiques où viennent s’entremêler le jeu de la politique et celui des vêtements, des habillages et des déshabillages.
Ce n’est pas qu’il soit explicitement et directement question, dans cet ouvrage comme dans les ouvrages qu’il commente d’ailleurs, de Mozart, de Haydn, de Beethoven, de Schubert, de Strauss ou de Mahler, mais, si l’on accepte que la musique est une intelligence non conceptuelle du réel auquel nous nous rapportons de façon immanente, le livre participe de cette intelligence, ne disant rien lui non plus explicitement de la musique – ou seulement par de très rares et délicieuses petites touches –, faisant affleurer les mots par les personnages et leurs relations, à partir d’elle. Les discours ne peuvent que s’enraciner dans la musique ; ils ne sauraient ni en rendre compte, ni se retourner aisément sur elle de telle sorte qu’ils deviennent le fondement de la musique. Ils font partie de son mystère en ce sens qu’ils ne retiennent d’elle que quelques éclats dont ils ne parviennent pas à rendre raison. Ainsi, la musique – la grande absente des livres de psychanalyse –, de concert avec la méthode des probabilités, met en position d’aller un peu plus loin que les mots ; elle donne l’impression que l’on dépasse par elle ce qu’on peut atteindre par les mots, pour exprimer l’amour porté par chaque femme aux hommes qu’elle aime ou qu’elle a aimés, ou l’amour porté par chaque homme à chaque femme qu’il aime ou qu’il a aimée ; elle donne aussi parfois l’impression de donner les clés qui permettent de transformer les simples phénomènes en signes qui sont à lire et de pousser une porte qui va un peu plus loin. Avec une ironie sceptique qui ressemble fort à celle de Jankélévitch quand il perd son enthousiasme à l’égard de la musique, par exemple.
Ainsi Marie-Anne Lescourret suit-elle, sur les pas de Musil, le chemin même qu’il a tracé à travers la philosophie allemande, mais imprégnée de scepticisme, ce qui lui permet de confronter une pluralité d’options et de directions. Avec le même esprit critique que Musil, et en le prolongeant, elle analyse les idées contenues dans LHSQ, le rapport de ces idées avec les personnages qui les développaient déjà pour leur compte ou avec l’auteur qui les développait à leur égard dans ses Journaux. La tâche est digne de Pénélope, défaisant les fils bien tissés pour expertiser le tissage (de l’homme au pouvoir, du politique sans pouvoir, du couple amoureux, du couple sans amour, etc.). On sent, dans le livre de l’auteure, ses voyages dans les États situés dans les entrailles de l’Europe centrale, et les musiques qu’elle a écoutées lors d’inoubliables concerts qui hantent un ouvrage dont le concept n’est pas le tout et qui fait peut-être des « restes » quelque chose de plus important que ce qu’il a structuré.












