La capacité de la littérature à modifier le réel est plus que jamais mise en doute, en partie à cause de la part modeste, pour ne pas dire dérisoire, qu’elle occupe dans l’espace et le débat publics. Mais quiconque a eu affaire à de jeunes lecteurs sait que la première de leurs réactions n’est pas de s’interroger sur le style, sur tel ou tel procédé d’écriture, mais de s’insurger contre tel propos, de prendre à partie l’un ou l’autre des personnages, de se demander pourquoi un tel agit de telle façon alors qu’il aurait mieux valu, etc. Cela est déroutant et salutaire : la frontière entre ce qui est raconté et ce que nous vivons vacille, et la littérature se rappelle alors à nous pour ce qu’elle est – ou devrait toujours être : une expérience en même temps que le lieu d’un questionnement éthique ou politique. Parus ces derniers mois, deux essais de Frédérique Leichter-Flack, un autre d’Emmanuelle Loyer et un récit de Justine Augier remettent, pour ainsi dire, la littérature au centre du village et de nos consciences en affirmant avec force son caractère essentiellement existentiel.

Dans Le laboratoire des cas de conscience, paru pour la première fois en 2012 et réédité dans une version revue et augmentée dans la collection « Champs essais », Frédérique Leichter-Flack se propose de penser les dilemmes moraux et éthiques à partir de textes célèbres de la littérature, et, de façon plus marginale, de quelques fictions télévisuelles ou cinématographiques. Quelques exemples parmi d’autres : le délicat arbitrage entre la responsabilité du violent et les circonstances atténuantes se trouve interrogé à l’aune de la nouvelle Billy Bud de Melville. Or, de la mutinerie de l’USS Somers en 1842, dont s’inspira l’écrivain américain pour écrire son récit, au coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du monde en 2006, il n’y a qu’un pas à faire – particulièrement jouissif au demeurant. La situation des mères porteuses est pensée à la lueur, fort éclairante, de la parabole du jugement de Salomon à laquelle l’autrice rend toute sa complexité. Le talent de l’essayiste réside dans la façon qu’elle a de tirer le fil de la bobine jusqu’à son terme. Alors que l’on pensait que la démonstration touchait au but, que notre opinion était faite pour de bon, voilà que l’autrice nous conduit un peu plus loin, effectue un pas de côté qui, soudain, relance l’interprétation et fait vaciller nos certitudes. Prodigieuse machine à douter, à nous réveiller, à nous provoquer : telle nous apparaît la littérature. Et l’on finit par trouver tout naturel de penser le débat sur la fin de vie à partir de La métamorphose de Kafka, quand Le manteau de Gogol devient, pour sa part, un instrument redoutable pour questionner la responsabilité de la société à l’égard de ses membres les plus vulnérables.

À propos de l’anecdote autour de laquelle se construit la nouvelle de l’écrivain russe, l’essayiste écrit : « Pareille mésaventure est peut-être arrivée à un homme, sans que l’on ait moyen de le savoir, puisqu’il n’y a justement que la littérature qui puisse accorder un peu d’attention à une affaire qui, sans elle, n’aurait pas d’existence publique. » Dans ces quelques lignes, l’autrice cerne sans aucun doute ce qui fait la grandeur de la littérature, mais plus encore celle de la fiction. Il ne s’agit plus de voir dans la nouvelle ou le roman l’illustration d’un fait social, mais leur capacité à mettre en évidence, à révéler et faire exister quelque chose qui, sans eux, serait demeuré un angle mort de la conscience collective. Si Frédérique Leichter-Flack s’intéresse de façon privilégiée à des fictions, c’est précisément que le jugement moral des personnages, et à travers eux des lecteurs et lectrices, trouve à s’y exercer. La fiction permet le déploiement des points de vue, leur affrontement sensible, et appelle des choix éthiques dont la responsabilité échoit à celles et ceux qui lisent. En cela, elle ne peut manquer d’intéresser la chose publique, dévoilant au passage sa nature non seulement éthique mais aussi politique.
Dans Pourquoi le mal frappe les gens bien, l’autrice adopte la même approche pour traiter d’une question maintes fois abordée par la philosophie et la théologie et qui ne peut manquer, chaque fois qu’elle est posée, de susciter une certaine sidération. Moins problème à résoudre ou devinette intellectuelle sur laquelle exercer nos arguties, le mal – « ce qui ne devrait pas exister et qui existe pourtant » – apparaît comme un enjeu existentiel. La littérature affronte la question avec ses propres armes : le récit, la narration, la confrontation des points de vue… L’autrice se tient aux côtés des personnages, et, avec eux, aux côtés, pourrait-on dire, de la littérature. Elle pense avec elle, à partir d’elle.
Du livre de Job à sa réécriture par Philip Roth dans son roman Némésis, en passant par Les frères Karamazov, Tess d’Uberville, La plaisanterie ou L’œuvre au noir, l’essayiste trace un cheminement stimulant qui nous mène de la question prétexte : pourquoi le mal frappe-t-il les innocents ? à celle, plus vertigineuse, de l’aléa. Pas de réponses en vue, bien entendu, mais la conviction que la littérature nous permet de considérer cette absence de sens que revêt parfois le malheur. Qui, au moment du dénouement du Roi Lear, ne ressent l’outrage et le scandale d’une mort injuste ? Qui peut affirmer que la lecture de la pièce de Shakespeare – et a fortiori sa représentation sur scène – ne constitue pas une expérience émotionnelle, morale et pour tout dire existentielle du mal ? Dès lors, cette lecture constitue une réserve d’expériences qui nous permet d’appréhender différemment le réel quand le mal s’invite dans nos vies, sous la forme de l’injuste ou de la malchance (ce « surplus de mal contre lequel on ne peut rien »). Le risque serait grand alors de céder à la confusion, de mettre tous les œufs du mal dans le même panier ; Frédérique Leichter-Flack réintroduit le politique à bon escient, distinguant le caractère inéluctable de la malchance et celui réversible des injustices systémiques.
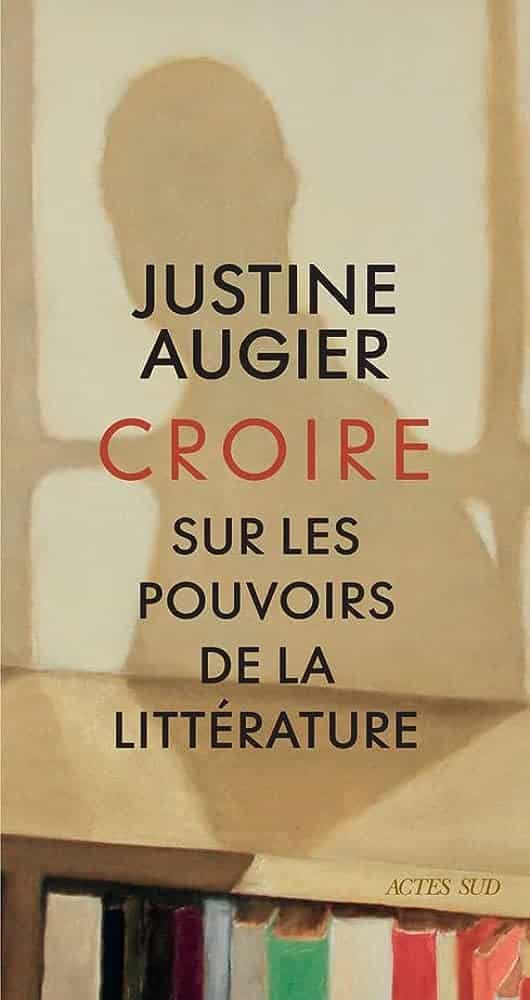
« Mille fois je me suis posé la question : comment traverser le mal sans ajouter au mal dans le monde, surtout aujourd’hui quand il prend des dimensions cosmiques ? » C’est en ces termes d’une frappante lucidité que la Prix Nobel Svetlana Alexievitch pose la question de la responsabilité de l’écrivain face à son sujet dans Les cercueils de zinc (2006). Et Justine Augier de lui emboîter le pas, en évoquant la voix tremblante de sa mère, la députée Marielle de Sarnez, lors d’une prise de parole : « Il me semble que cette crainte devrait être la norme, que l’on devrait toujours être impressionné en prenant la parole, en s’adressant à d’autres qui écoutent, que jamais cela ne devrait devenir anodin. » Ce tremblement de la voix, c’est la conscience d’une responsabilité, le signe d’une inquiétude éthique. Et c’est ce tremblement-là que l’on se plaît à retrouver dans certains livres dont on sait qu’ils vont modifier notre rapport au réel. Croire est un récit de filiation, un livre de deuil, une égo-histoire politique et une méditation inspirée sur la littérature et la langue. Dans ce récit mince, mais d’une densité telle qu’on aimerait pouvoir le citer en entier, Justine Augier décrit avec une infinie sensibilité le cheminement de sa foi dans les pouvoirs de la littérature, les doutes qui s’emparent d’elle, en passant par quelques rehauts suscités par le confinement dû à l’épidémie de covid, puis par la maladie de sa mère. La réflexion sur la littérature n’est pas désincarnée, abstraite ou théorique. Elle s’ancre au contraire dans une expérience vécue, dans l’intime, dans une certaine expérience du mal qui prend la forme de l’aléa – celui-là même que Philip Roth met en scène dans Némésis à travers l’épidémie de polio sévissant à Newark en 1944 et que commente brillamment Frédérique Leichter-Flack dans Pourquoi le mal frappe les gens bien ? Le récit de Justine Augier décrit avec subtilité la façon dont les relations entre la mère et la fille sont tissées de lectures et de livres, lus, proposés, rejetés, relus, interrompus… Relations faites de silences, de mots pesés, pudiques. « J’ignorais à quel point la maladie était affaire de mots, de langue à trouver, de délicatesse à réinventer. »
C’est à la fois dans cette attention fébrile à la langue et aux mots et dans l’expérience du mal que l’intime et le politique se nouent. Car Croire est aussi un livre politique. L’autrice consacre de nombreuses et puissantes pages à la résistance intellectuelle en Syrie à travers quelques figures remarquables : la journaliste Razan Zaitounech disparue depuis 2013 et qui avait entrepris de documenter les crimes du régime de Bachar el-Assad ; Yassin Al Haj Saleh, ou encore Mustafa Khalifé, auteur de La coquille, récit dans lequel il évoque le rôle des « mémoriseurs » dans la prison de Palmyre dont la tâche est de se souvenir du nom des prisonniers, de leur ville ou village, de la date de leur incarcération, et de ce qu’il est advenu d’eux, certains étant capables de retenir de 2 000 à 3 000 noms. Vertige… La mémoire comme résistance et la littérature comme lieu de conversation avec les fantômes.
Exprimant d’abord ses doutes sur la capacité de la littérature à changer le réel, Justine Augier finit par affirmer sa foi dans la langue, à condition de la réarmer, de ne pas la laisser se déliter dans l’insipide, le cliché, la certitude, mais plutôt de faire place au doute, au vacillement, au tremblement. Cela passe par une attention accrue aux mots, à leur adéquation, mais aussi aux mots des autres. Savoir faire silence. « Le silence auquel éduque la lecture est poésie. Il est aussi politique, source d’une langue imprégnée d’écoute et d’altérité, […] une langue attentive mais armée. » La profession de foi se concrétise par le caractère accueillant de la prose de Justine Augier, nourrie, tressée devrait-on dire, d’autres voix que la sienne. Les citations sont nombreuses. Ce n’est jamais pour l’esbroufe. Elles font de grandes trouées de lumière dans le texte et la conscience du lecteur. En cela, Croire est un formidable plaidoyer pour une littérature en conscience, dont la nature profondément éthique réside dans sa recherche d’une langue juste, dans tous les sens du terme.
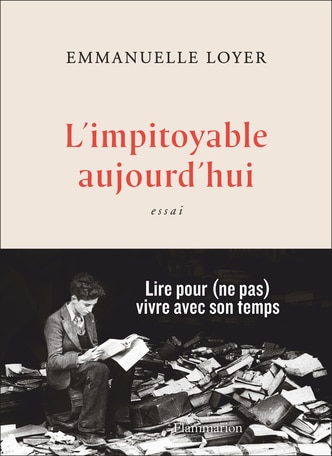
Dans un essai intitulé L’impitoyable aujourd’hui, expression empruntée à l’écrivain Jean Guéhenno à l’heure où l’avènement du nazisme lui imposait de reconsidérer ses engagements pacifistes, l’historienne Emmanuelle Loyer propose un riche parcours de lectrice, parcours buissonnier et subjectif dont l’enjeu est de penser différentes manières d’habiter le temps à partir d’un corpus de textes empruntés tant aux sciences sociales qu’à la littérature. Ainsi perpétue-t-elle le dialogue salvateur entre les disciplines historique et littéraire pour réfléchir sur notre rapport affectif au temps. L’autrice explore différents régimes et imaginaires de la temporalité, rendant sensible par là même la dialectique propre à la lecture : cette dernière nous extrait du monde et nous le restitue de manière plus riche, plus nuancée, mais parfois aussi de façon clarifiée. Elle nous abstrait du présent, moins pour le nier que pour dégager ce qui en fait la spécificité. Lire pour être – ou ne pas être – contemporain de son époque, tel est le credo de cet essai stimulant. On retiendra en particulier les très belles pages consacrées aux mondes finissants de Fenimore Cooper, de Vladimir Arseniev et de Claude Lévi-Strauss dont Emmanuelle Loyer a écrit une remarquable biographie, celles sur le roman gothique ou sur Julien Gracq. Si l’on peut regretter certaines approximations, erreurs d’attribution ou schématisations, l’ouvrage d’Emmanuelle Loyer, écrit à sauts et à gambades, nous touche. C’est qu’il porte en lui quelque chose de vibrant et de secret : au-delà de l’autoportrait en creux d’une lectrice avide et enthousiaste, il semble être le fruit d’une quête intime, à la fois mélancolique et angoissée, le fruit de la recherche éperdue, pour elle et les siens, d’un rapport pacifié à l’« impitoyable aujourd’hui ».
On sort de ces différents ouvrages avec la conviction renforcée que la littérature a charge d’âmes, que sa nature est d’être essentiellement existentielle. Ou, pour le dire autrement, qu’avec ses moyens spécifiques la littérature nous aide à vivre. Face aux différents périls qui nous menacent, la littérature fait front, avec sa morale de l’imagination – sans laquelle elle n’est rien –, force active, éthique et politique, aux mécanismes parfois mystérieux mais suffisamment puissants pour faire trembler le réel.












![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)