On ne peut que se réjouir de voir, dans un contexte de relations franco-algériennes erratiques où le revivalisme de rentes mémorielles obscurcit l’Histoire, se multiplier ces dernières années un nombre important d’ouvrages sur l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie. Qui plus est, ces travaux revisitent d’une manière tout à fait nouvelle des questions qui ont fait jusque-là l’objet de publications amples, plutôt généralistes, ayant abordé généralement cette histoire par le haut. Trois ouvrages très différents en témoignent aujourd’hui.
Une nouvelle génération d’historiens, sans remettre fondamentalement en cause les approches de ses grands prédécesseurs, est en train d’opérer un basculement de la perspective des connaissances, du haut vers le bas, dans une démarche de saisie de cette histoire au plus près des terrains et de ceux qui ont en été les acteurs ; elle ne se contente pas de développer une micro-histoire sociale des situations et des contextes, qui va jusqu’au détail ethnographique ; elle procède également à des enquêtes situées, dans lesquelles certains auteurs cherchent à retrouver, mesurer et objectiver, par-delà les nouveaux éclairages, les traces et les effets de longue durée de ces processus.
Préfacé par un historien britannique reconnu, Neil MacMaster, dont les travaux sur l’Ouarsenis ont dynamisé cette approche par le bas — et co-auteur avec Jim House de l’enquête de référence sur le massacre du 17 octobre 1961 —, le livre de Guignard marque à n’en pas douter une date dans l’historiographie française de la colonisation de l’Algérie. Se distanciant, sans totalement rompre avec elle, d’une approche macro – qui serait selon lui à « tonalité dénonciatrice » – des réglementations et applications du séquestre, il propose de les contextualiser dans leurs différentes échelles et modalités d’application, durant une période déterminée et dans un territoire situé, la région des Issers en Kabylie.
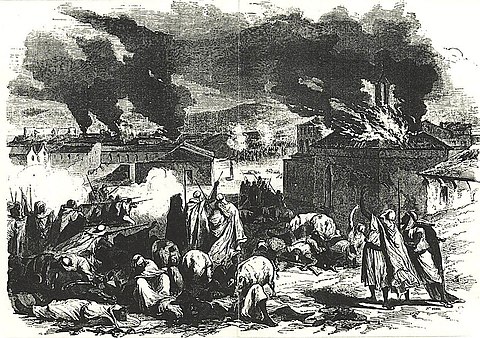
Ce déplacement du point de vue est né d’un questionnement sur le statut d’un document d’archive, qui a interrogé l’auteur, à partir de ce qu’il relève comme une « anatomie de l’instant », qui pouvait déboucher sur « une tentation du déterminisme en situation coloniale » ; il va s’employer alors à retrouver – à partir d’une enquête de terrain, qui mobilisera des outils de « carottage », les archives du séquestre et de nombreuses autres, plus ponctuelles, l’observation in situ et des entretiens ciblés – les continuités, les « résiliences » et les ruptures de l’histoire longue de la paysannerie algérienne. Il inscrit cette enquête dans le cadre d’une histoire sociale, à partir d’une situation locale, à travers une coupe (dans un double sens métaphorique, coupe claire, coupe sombre, en arboriculture), ici dans le corps social, révélatrice de la complexité de situations qui continuent de produire leurs effets jusqu’à aujourd’hui. Sans qu’il en fasse un échantillon représentatif, le local qu’il étudie, qu’il cartographie de manière détaillée, n’en est pas moins révélateur de caractéristiques générales, puisqu’il représente 11 % des terres confisquées et une densité de population bien plus forte que celle de l’ensemble du territoire. La région des Issers, région agricole riche, « première région reconquise et première sanctionnée, après l’insurrection de 1871, va servir ainsi de laboratoire au dispositif d’expropriation ».
De fait, et l’ouvrage remonte jusqu’aux débuts de la colonisation, l’expropriation foncière a été très tôt une arme, de punition, de guerre coloniale. La sentence de Cavaignac est, de ce point de vue, emblématique du projet colonial : « La colonisation ne s’étendra que par la guerre ; il n’y aura pas de mélange possible entre les deux parties ; la France, étant obligée de soutenir ses colons, sera poussée au refoulement et, par conséquent, à la destruction de la race indigène car le désert ne peut les nourrir ». Comme le confirme Bugeaud d’une manière aussi directe que claire, dans sa harangue à la Chambre, « en Afrique, il n’y a qu’un intérêt : l’intérêt agricole […] je n’ai pu saisir d’intérêt saisissable, je n’ai pu découvrir d’autre moyen de soumettre le pays que de saisir cet intérêt » (cité par François Maspero en 1993 dans L’honneur de Saint-Arnaud). C’est donc la terre qui subit les premiers outrages à travers différentes formes d’expropriation : séquestre, refoulement, cantonnement. Le droit colonial est mis au service d’une entreprise de dépossession systématique qui fait fi de la spécificité de la propriété foncière indigène. Le mérite de l’auteur est d’en montrer et d’en expliciter les formes, les contradictions, et de restituer dans le même mouvement la nature sociale de la propriété foncière autochtone, celle de droits fonciers « adaptés à l’écologie des lieux ».

La confiscation en acte, après 1871, que décrit l’auteur est d’abord militaire ; après la répression, les premiers actes de séquestre qui concernent la vallée tombent très rapidement, « avec une volonté de frapper vite et fort », et s’élargissent sous la double pression des colons et d’Alger. Cette façon de faire, note le préfacier, « est proprement glaçante ». « Les sanctions sont distribuées à l’aveugle », accentuant un processus dévastateur pour la population « indigène », sans que le processus d’appropriation se déroule comme prévu, installant les uns, enracinés localement, face aux autres, nouveaux venus, dans une situation où les rancœurs font le lit de la haine. Le titre d’un chapitre de l’ouvrage, « La traversée de l’épreuve », résume bien les multiples formes de résistance des Algériens, allant du « mauvais vouloir d’évacuer les lieux », aux suppliques répétées, en passant par des attentes de dédommagement illusoires, jusqu’au retour à proximité.
Dans un chapitre conclusif, Guignard souhaite saisir ce qui reste de ce moment dans la mémoire collective. On lui sait gré, avec les distances méthodologiques et théoriques qu’il prend, de périodiciser les différentes expressions de la mémoire du séquestre, en distinguant ce qui a pu être intégré dans la mémoire nationaliste des réactions du moment, en soulignant également la difficulté de saisir « les fils ténus et changeants de la transmission ». Il retient deux moments, deux dates, 1890 et 1930, l’une marquée par un fait divers révélateur, qu’il analyse dans ses effets et représentations, l’autre marquée par les transformations induites dans la société. L’auteur, disséquant les effets de l’attaque d’une ferme et de l’exécution de ses auteurs au moyen d’une guillotine transportée sur la place du village, montre, à travers les détails socio-ethnographiques de la vie locale dans les années qui suivirent 1871, le poids toujours présent du traumatisme du séquestre dans les rapports entre les communautés. Les transformations socio-économiques des années 1930, dans un contexte où la viticulture génère des bénéfices énormes, et « où la reconquête des terres confisquées se fait de plus en plus pressante à la marge », approfondissent les inégalités d’accès à l’emploi et de rémunération des « indigènes ». Les années 1870, conclut l’auteur, « peuvent toujours parler aux enfants et petits-enfants des victimes du séquestre ».
L’ouvrage majeur de Didier Guignard rompt ainsi avec une Histoire qu’on n’a, le plus souvent, regardée que d’en haut – dénonciation, répression versus valorisation, civilisation, en faisant vivre les acteurs sur un territoire cartographié, « scanné » dans ses transformations morphologiques, démographiques et économiques. En cela, l’auteur fait œuvre, plus que d’historien, de géographe, d’anthropologue, de sociologue ; il remet le métier d’historien au cœur d’une interdisciplinarité bien comprise. Son livre ne dit pas seulement le passé, ses pages sur la région revisitée au début de son enquête mettent le passé au cœur du présent. Les nouveaux occupants, « indus-occupants », « dynasties ouvrières, s’accrochent à cette exploitation […] toujours propriété de l’État […] en dépit de chocs successifs », observe l’auteur. Il redonne ainsi une place centrale à la paysannerie dans ses luttes aussi bien passées que présentes, surtout dans ses capacités de résilience. Il produit là un travail informé et rigoureux qui met au jour les conflictualités nées du choc colonial, saisies autrement que par des traits culturels ou des identités figées, en situant les protagonistes dans leur cadre historique et leur évolution sur la longue durée.
L’ouvrage de Marius Loris Rodionoff, Désobéir en guerre d’Algérie, conjugue également approches macro et micro. Il inscrit sa démarche dans un cadre classique d’évolution de « l’histoire de la relation hiérarchique dans l’armée » ; et dans le même mouvement, opérant par études de cas et de situations, il développe, à partir d’archives et de trajectoires, une analyse plus fine des faits précis de désobéissance dans différentes situations, particulièrement dans la période clé de la guerre d’Algérie.
Partant de l’appel du 18 Juin du général de Gaulle, moment fondateur du questionnement de la légitimité de l’autorité à laquelle il faut obéir – en temps de crise, de défaite, dans le moment –, il interroge dans une perspective de moyenne durée les déterminants de la désobéissance/versus obéissance, dans le contexte nouveau de la décolonisation.
Il distingue à cet égard trois grandes phases, celle qui suit la défaite de 1940, puis celle de la décolonisation, avec la guerre d’Indochine, où il observe une première mutation des conditions de l’exercice de l’autorité, et un deuxième moment central, celui de la guerre d’Algérie, qui va transformer profondément la nature de cette relation ; il relève que si cette période, a connu, tout au long du conflit, des « contre-conduites », faites de résistances, de transgressions, plus généralement d’attitudes ambivalentes, à l’égard de l’autorité, on peut néanmoins y repérer cinq moments de transformations décisives : ce sera d’abord en 1955, avec le mouvement de rappelés au début de la guerre, puis en 1958, quand l’armée participera au retour du général de Gaulle au pouvoir, ensuite en 1960 au moment des barricades, suivi très vite, en avril 1961, du putsch des généraux qui a fait vaciller le pouvoir central, et enfin à la fin de la guerre, avec les mutineries de soldats contre le service militaire ; ces moments sont analysés, comme autant de situations de crise aiguë, qui vont manifester de manière plus tranchée des remises en cause de l’autorité et plus largement un changement qualitatif de la relation hiérarchique au sein de l’armée, et ce jusqu’en 1966, où une nouvelle doctrine referme en principe la période des interrogations et des crises nées de l’après-guerre.
Dans cette évolution, l’auteur montre, sans s’appesantir sur le moment de sortie de la Seconde Guerre mondiale, comment la réorganisation des rapports d’autorité dans l’armée, et plus globalement la réorganisation de celle-ci, oscillent entre une vision managériale (général Revers) et une vision privilégiant les hommes, les cadres et leur formation (général de Lattre). C’est bien cette dernière conception, appuyée sur la valorisation des jeunes cadres, sur le primat du contact humain entre chefs et soldats, marquée par une relative diminution du poids de la relation hiérarchique, qui va prévaloir dans une guerre de forme nouvelle, au moment de la nomination de de Lattre, comme haut-commissaire en Indochine en 1950. C’est dans l’induration de la guerre d’Indochine que le basculement vers une autre forme de relations dans l’armée s’opère. C’est avec « la formation de compagnonnage » et de réseaux de fidélité, d’esprit de clan, appuyés sur des figures charismatiques, « que se forme une armée dans l’armée, difficile à contrôler », écrit l’auteur. Face à un Vietminh conquérant, mû par une idéologie politique mobilisatrice, s’introduit l’idée que « l’armée a perdu la bataille parce qu’elle ne faisait pas de politique ». Aux fondements politiques de l’action révolutionnaire va alors répondre une conviction non moins politique, articulant action de communication tous azimuts, psychologique, de propagande et de justifications politiques « du bien-fondé de la guerre ».
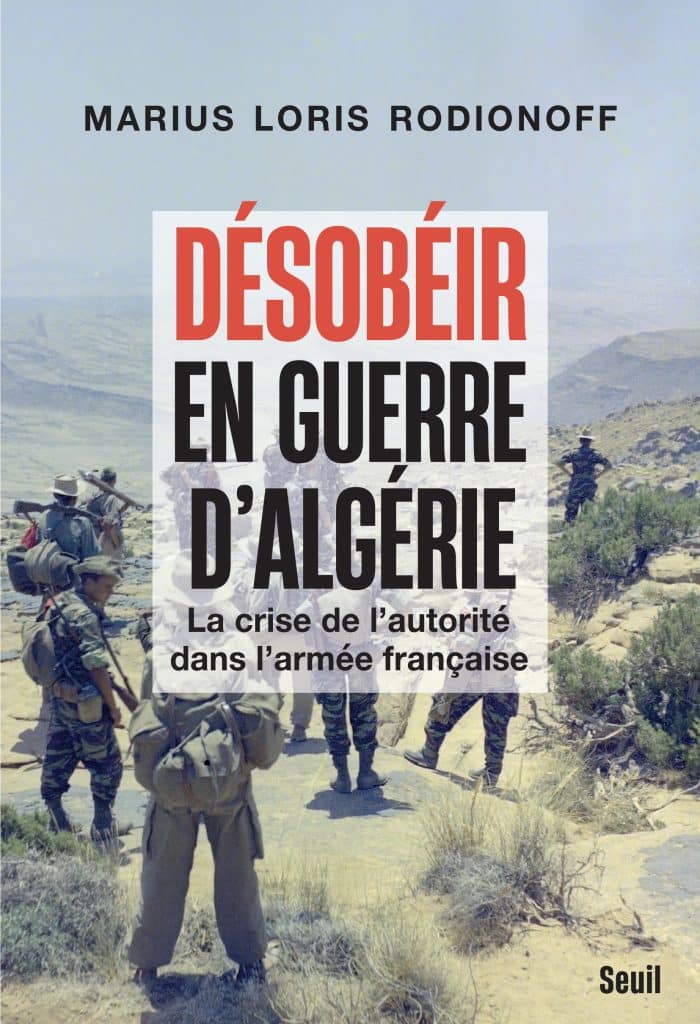
Se formalise et s’institutionnalise alors ce qui va se déployer tout au long de la guerre d’Algérie, une théorie en pratique de la guerre contre-révolutionnaire, qui sera plus tard reprise comme modèle dans les répressions, les mouvements de libération des dominations impérialistes. Les relations et frontières entre politiques et armée vont devenir de plus en plus poreuses. Les chefs militaires les plus emblématiques rentrés d’Indochine vont, à travers la mise en place d’institutions de formation dédiées (bureaux d’action psychologique, école d’Arzew du 5e bureau, école Jeanne-d’Arc, LSHA – Laboratoire des sciences humaines appliquées) et l’ouverture vers des connaissances plus larges de la société en guerre (en convoquant les sciences sociales, l’anthropologie, la sociologie et la psychologie sociale), viser à produire des chefs qui ne maitrisent pas seulement l’art de la guerre, mais qui, armés des outils de l’action psychologique et politique, « ont la foi, la conviction et l’ardeur nécessaire » pour agir sur les populations civiles, enjeu central de la « nouvelle » forme de guerre. Cela accélère l’interpénétration armée et politique et achève de politiser la relation d’autorité, d’autant plus que certains chefs de l’armée sont eux-mêmes issus de la colonie.
Dans une guerre asymétrique qui va engager du côté colonial une « armée de masse » présente sur le terrain algérien, avec quelque cinq cent mille hommes, au moment le plus dur de la répression en 1959, lors de l’opération Challe, c’est d’abord au niveau des groupes de base, les sections au plus près du terrain, que la question de l’autorité se manifeste au quotidien. Ce sont d’abord les « petits chefs » qui sont « difficilement contrôlables », non sanctionnés, le plus généralement impunis, surtout dans les cas de tortures et de corvées de bois. De manière générale, l’auteur recense au niveau de la base, celle des appelés, un ensemble de faits relevant « de critiques, de résistances discrètes […] De révoltes invisibles » qui lui semblent plutôt relever « d’une soupape pour mieux accepter l’obéissance ». Il reste cependant que les atteintes à l’autorité, qu’elles soient marquées par la distance sociale ou le refus plus ou moins déguisé de s’impliquer, sont importantes dans le cours des interactions quotidiennes entre les chefs et leurs hommes Le mythe résistancialiste d’un contingent anti-guerre paraît à l’auteur exagéré, alors même que, reprenant les formes les plus caractéristiques de l’opposition à la guerre, comme la désertion, l’insoumission, et l’objection de conscience, il tente de déconstruire l’idée selon laquelle ces formes auraient été principalement individuelles.
L’auteur se tourne alors vers les statistiques pour en mesurer l’importance. C’est essentiellement chez les Algériens appelés, engagés et supplétifs de l’armée française et chez les légionnaires que l’auteur va au fond de l’approche statistique de ce qu’il caractérise comme procédant « de la principale menace pour l’armée française ». S’il relève l’importance des désertions des Algériens qui avoisinent selon lui 6 % des effectifs (soit 9 355 déserteurs pendant toute la guerre) des différentes catégories d’Algériens constitutives de l’armée française, l’auteur y agrège aussi bien les effectifs de l’armée régulière (6 085) que les effectifs des supplétifs (3 270), chiffres qui ne sont pas autrement précisés par rapport aux périodes de désertion (n’est citée de manière comparatiste que l’année 1962, où les désertions ont été nombreuses : en mars, 1 065 Algériens ont déserté et 2448 en avril ; parmi ces derniers on comptait 1 971 FSNA et 517 harkis, soit un total de 3 513 dans les deux mois qui ont suivi le cessez-le-feu, selon les sources de l’état-major interarmées, 1er bureau, « Pertes en Algérie », cités par Tramor Quemeneur) ni par rapport aux catégories concernées (sinon sous la forme de l’hypothèse selon laquelle les supplétifs auraient moins largement déserté parce qu’ils pouvaient rompre leur contrat sans courir le risque d’être jugés pour désertion), ni par rapport aux grades (officiers, sous-officiers et soldats de base). Les légionnaires, quant à eux, représentent 61 % des déserteurs au début de la guerre ; ils sont plus nombreux que les Algériens à déserter. Si leur nombre diminue à la fin de la guerre, leur désertion ne découle pas de leur engagement idéologique, puisqu’ils se partagent équitablement entre ceux qui sont proches du FLN et sont exfiltrés par ses réseaux, et ceux qui sont Algérie-française et qui désertent au moment du putsch des généraux. Si les désertions de soldats français s’élèvent à environ 1 250 hommes sur toute la période de la guerre, et l’insoumission à un peu moins d’un millier, l’auteur observe que le contingent français « désobéit dans des proportions plus importantes [que les Algériens ou les légionnaires], mais pour des crimes de désobéissance moins graves que la désertion ».
Refuser l’obéissance revêt ainsi plusieurs formes, qui vont du refus d’obtempérer à l’outrage, insultes et voies de fait contre les supérieurs, en passant par le refus de prendre sa faction de sentinelle, ou même le vol. L’auteur relève par ailleurs que l’insoumission n’est pas très élevée, et c’est sans doute sa tentation quotidienne dans le contexte d’une guerre qui ne dit pas son nom qui la met au-devant du débat public avec l’appel des 121. Ces nombreuses transgressions disent plus sur une atmosphère, un climat général, d’une guerre déclarée officiellement « évènements » ou opération de maintien de l’ordre, qui met en porte-à-faux toute une jeunesse, réticente à l’égard d’un combat obscur et douteux, qui lui paraît ne pas être le sien. Ce n’est pas le cas cependant de toutes les composantes de l’armée d’Algérie : il en va autrement, notamment, des cadres, « qui se sentent, eux, trahis » par les politiques.
S’appuyant alors sur les travaux d’historiens reconnus et sur des témoignages d’acteurs de terrain, l’auteur revient, dans une troisième partie, à une analyse par le haut, en se focalisant sur les interrelations, les interférences, entre la crise politique et la crise de l’autorité dans l’armée aux moments clés, où celle-ci intervient directement dans le champ politique : en 1958, en 1960 et 1961. Le 13 mai 1958 marque ainsi, selon l’auteur, la fin de l’obéissance traditionnelle, caractéristique dominante jusque-là de la « grande muette ». L’auteur relève le paradoxe qui veut que ceux qui vont être derrière la politisation de l’armée et sa mobilisation en vue de la prise du pouvoir, les gaullistes, s’inscrivent en porte-à faux par rapport à la vision de leur mentor qui, lui, est fidèle à une conception traditionnelle de l’obéissance. La semaine des barricades approfondit les fractures au sein de l’armée et entre celle-ci et le pouvoir politique. Ce sont les troupes régulières et leur encadrement qui se radicalisent politiquement, alors que le contingent et sa base d’appelés restent globalement légitimistes. L’opposition du contingent au putsch des généraux d’avril 1961, relève à cet égard un appelé cité par l’auteur, devrait s’inscrire « comme une fête [….] comme la fête des appelés ».
Le putsch qui a fait vaciller l’État est ainsi l’aboutissement d’un processus de politisation de l’armée de métier, engagé à la fin de la guerre d’Indochine. Le contexte algérien en a accentué la radicalisation ; celle-ci va déboucher sur de nouvelles fractures, entre vieux commandements et jeunes « centurions », qui ont acquis, à l’épreuve du terrain, une plus grande autonomie de répression et la reconnaissance de la population européenne, devenue plus proche et complice. Le désarroi dans l’armée est complet en cette fin de guerre ; il procède selon l‘auteur « d’une déliquescence de la discipline dans l’armée ». Ce délitement va s’affirmer à la fois dans le dévoiement d’une partie de l’armée dans l’organisation criminelle de l’OAS, dans la dissolution de nombreuses unités impliquées dans le putsch, dans la radiation et la démission de nombreux cadres (autour d’un millier de radiations entre officiers et sous-officiers et 2 300 officiers démissionnaires entre janvier 1960 et décembre 1962), dans le jugement de nombreux autres, le contingent, quelque peu atone, « n’obéissant que pour finir la guerre ». La sortie de guerre va être chaotique et la reprise en main ne se fera pas sans nouvelles résistances. Aussi peut-on, en considérant l’état de l’armée à la sortie de la guerre, tel que le décrit l’auteur, s’interroger sur la réalité de ce qui a été souvent revendiqué, par certains chefs militaires et leaders politiques, voire même certains historiens, comme une victoire militaire sur ce qui était considéré comme une « rébellion ».
Cette crise de l’armée sera relancée en 1962-1963, au moment du désengagement, à travers une multiplication des grèves des soldats qui concerneront autour de 5 % des effectifs des appelés. Cela touchera principalement les unités du transport chargées du déménagement des forces françaises. Ce seront également les grèves de la faim à caractère « antimilitariste ? », qui rappellent celles des objecteurs de conscience, grèves qui s’élargiront aux forces stationnées en Allemagne. Ces mouvements appellent alors à « de nouveaux compromis entre le contingent et l’armée » et ouvrent, selon l’auteur, la voie à une transformation du service militaire, avec les lois de 1965 et 1966 ; lois qui parachèvent la sortie de la guerre d’Algérie, avec « une nouvelle définition du lien entre les citoyens et la nation ».
L’ouvrage de Marius Loris Rodionoff est exhaustif dans sa description et son analyse de l’évolution des rapports hiérarchiques au sein de l’armée française, particulièrement de la discipline, de l’autorité, de l’obéissance, dans le contexte de la guerre d’Algérie. L’auteur met au service de son hypothèse centrale – le moment de la guerre d’indépendance algérienne, qui correspond à une crise majeure dans l’armée, marque un basculement d’une conception traditionnelle de l’autorité vers une conception politique du rôle de l’armée – des faits généralement connus, repris de travaux d’historiens qui ont traité de manière plus ciblée et plus ponctuelle la question de la désobéissance, des autobiographies et des témoignages de seconde main d’acteurs. L’ouvrage donne ainsi à lire une synthèse tout à fait probante et éclairante des moments clés de cette transition. L’auteur, cependant, est bien conscient, dans la variabilité de la manifestation des faits de résistance qu’il décrit, qu’il n’a saisi là que les causes, allant des plus générales aux plus contextuelles, et que lui ont échappé les motivations profondes des différents acteurs. Il reste en effet à expliquer les ressorts profonds qui font basculer certains acteurs de la confrontation, à l’exemple de l’emblématique général Pâris de Bollardière et de certains autres officiers, sous-officiers et hommes de troupe, vers le refus de la « destruction » de l’autre, des pratiques de l’innommable, torture, viol, corvée de bois, et plus largement la transgression des ordres qui ne correspondaient pas à leur conception de l’humain.

Le troisième ouvrage est une publication qui tranche sur les travaux consacrés aux mémoires de la guerre d’Algérie. Il s’agit ici de la première étape d’un projet éditorial porté par un collectif de jeunes, issus de l’immigration coloniale, qui vise à donner la parole aux « aînés » afin de restituer ce qui a longtemps été refoulé et tu, après la fin d’une guerre qui a revêtu par moments la forme d’une guerre civile. Nombre de travaux en effet se sont interrogés sur les silences des principaux acteurs de la confrontation ; ce qui est nouveau ici, c’est que les questionnements viennent des jeunes générations, petites-filles et petits-fils des protagonistes de la confrontation, qui ont été sevrés de cette histoire ; et qui se trouvent souvent en porte-à-faux par rapport à des assignations par le haut ; par rapport à une reconstruction politico-nationale lissée, par des politiques et des élites, qui gomment l’histoire propre de ces populations qui ont fait partie de l’histoire de la France; comme si on avait affaire à des familles sans « histoire » , « marsiennes », venues de nulle part, sommées de se taire et de ne se faire voir qu’à l’occasion du travail.
La coordinatrice du projet, la jeune Farah Khodja, le dit d’emblée, dans la présentation de l’entretien qu’elle a avec son grand-père : elle n’a pas eu accès à cette histoire. Elle a été davantage encouragée par son grand-père « à réussir ses études, qu’à parler de la guerre ». Elle subodore, à juste titre, que son grand-père n’a pas souhaité parler de la guerre pour la préserver de cette histoire douloureuse. Elle souhaite, de plus, trouver des réponses au paradoxe, à la contradiction qui a fait que son grand-père a réalisé sa vie dans le pays qu’il a combattu. Elle est ainsi représentative de nombres de jeunes issus de l’immigration coloniale qui, quelque peu suspendus dans le vide, ne trouvent de réponses à leurs questionnements, à leur « malaise » identitaire, ni dans les institutions de la République ni dans leurs familles. Les travaux de recherche (voir notre ouvrage, Aissa Kadri et Fabienne. Rio, Enseignants issus des immigrations : l’effet génération, Sudel, 2006) et les points de vue de spécialistes et d’associatifs en charge de ces catégories de jeunes sont unanimes pour relever, sinon une absence, du moins une prise en compte édulcorée, lissée, dans les institutions éducatives, et plus largement culturelles, aussi bien de l’histoire de l’immigration coloniale à travers sa participation à la construction de la France, que de l’histoire de la guerre d’Algérie, souvent étudiée à la marge ou évoquée et débattue dans l’espace public, dans la confrontation et le déni de l‘exclusion et de la répression de ceux qui n’étaient pas des citoyens mais des sujets. L’ouvrage est de ce point de vue tout à fait bienvenu : on y lit deux histoires qui s’entrecroisent et s’éclairent l’une l’autre, celle des mémoires de la guerre d’indépendance algérienne et celle de l’immigration coloniale.
Les tragédies, les drames qui remontent à la surface ne provoquent ici aucun ressentiment ni aucune stigmatisation à l’égard des ennemis d’hier, souvent des voisins et connaissances. Il s’agit plutôt d’une volonté d’expliquer, de comprendre, de rationaliser, de faire le deuil des disparitions, de trouver des réponses à ce qui a procédé d’un affrontement qui les dépassait ; de ce qui a participé, jusque-là, de l’indicible, les viols, la torture, les exécutions sommaires, les disparitions, toutes pratiques que l’on a vécues dans sa chair ou que l’on a côtoyées et refoulées. Au-delà, la vingtaine d’entretiens – dont de nombreuses femmes que jusque-là on entendait peu – réunis ici témoignent de plus de proximité que de distance entre les acteurs de la confrontation, militaires appelés et indépendantistes algériens. Proximités, pour certaines, fondées sur des liens du sang, comme le découvre le pied-noir « d’origine maltaise », Jacki Mallea, soldat dans les Aurès, qui apprend à la fin de la guerre « que sa mère biologique […] après huit ans de vie avec son père s’est remariée avec un Algérien [et qu’il se retrouve] à 37 ans avec deux demi-sœurs et un demi-frère algériens ».
Mais également proximité dans l’incompréhension du maelstrom qui les emportait et des évènements qu’ils subissaient ; incompréhension, du côté des militaires français, confrontés à une guerre, alors qu’on leur parle d’évènements, comme le souligne Georges Gariè, appelé en Kabylie « j’ai la croix de la valeur militaire […] je ne la porterai pas […] donc si ce n’était pas une guerre, il n’y a aucune raison que j’aie une croix de guerre ». Côté militants algériens, également une incompréhension de l’extrême violence de la répression, dans le même moment où on leur parlait de réformes et d’égalité, comme le relève une grand-mère , à propos de la réaction de son mari, défendant son enfant arrêté : « moi j’ai envoyé mon fils travailler ici en France et vous, vous le mettez en prison », ajoutant, parlant des militaires, qu’ils ont été tout de même attentifs quand il a dit : « moi la France je me suis battu pour elle lors de la Première Guerre mondiale, et c’est comme ça que la France me remercie, en mettant mon fils en prison ».
Conçus comme un projet de transmission intergénérationnelle de mémoires d’une guerre « sans nom », les récits d’Algérie réussissent, à leur échelle, à réconcilier les générations avec elles-mêmes et entre elles. La catharsis des protagonistes de l’affrontement, qu’on peut saisir à travers certains témoignages, leur permet de s’engager dans de nouveaux combats qui confinent à des formes de « rédemption ?» (voir les engagements de la 4ACG dont parlent ici certains appelés, ou les poèmes, peintures et écritures autobiographiques que livrent d’autres), au moment où les nouvelles générations trouvent dans ces dévoilements certaines réponses qui les rendent « fiers » et les aident à assumer leur identité plurielle. Cependant, la vivacité des blessures, toujours ouvertes, témoigne encore d’un contentieux mémoriel toujours là, d’un passé qui ne passe pas. Un eemple emblématique en est la confrontation entre deux petits-fils des acteurs de la confrontation, celui d’un maire colon, Félix Vallat, engagé dans la défense de l’Algérie française, assassiné avec son épouse le 8 avril 1958, qui a eu des obsèques nationales, et celui d’un « indigène » instituteur, Mokhtar Boucif, directeur d’école, arrêté par les militaires le 16 avril 1958 et disparu à jamais, parce que soupçonné d’être le commanditaire de l’assassinat du maire. Hasard extraordinaire, ces deux petits-enfants se retrouvent à l’occasion de la réunion du comité Audin, enfermés chacun dans sa souffrance, dans sa « vérité » historique irréconciliable. Aussi bien cette voie de libération de la parole que poursuit le projet éditorial de ces jeunes doit-il trouver une réponse au niveau politique le plus haut, par un acte autre que des réponses au coup par coup, fonctionnant au gré de ce qui est entrevu par le politique comme « un marché de la souffrance ».
Récits d’Algérie procède d’une démarche assumée comme subjective, et les encadrés historiques assez généraux ne sont donnés que pour situer les contextes. Émouvants, parfois durs à lire, dévoilant des espaces intimes et des interrogations de conscience, ces témoignages, accompagnés de productions iconographiques et textuelles personnelles, disent autant du présent que du passé. Ils montrent que ces trajectoires, ces histoires familiales et personnelles, dans leur entremêlement, sont bien consubstantielles, non pas seulement d’une histoire franco-algérienne, tumultueuse et dramatique, mais bien d’une histoire de France, que la France n’assume pas totalement. Il y a là un outil pédagogique pour une large partie de la société française qui, si elle n’occulte pas cette histoire, n’en fait pas un déterminant de la crise identitaire de ces catégories sociales, et pour les institutions de socialisation – enseignants en premier lieu – de la jeunesse d’aujourd’hui. Il appelle à ce que l’école se saisisse de cette histoire autant dans les programmes que dans les pratiques.










![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)

