Les deux premiers romans de Kevin Lambert, Tu aimeras ce que tu as tué et Querelle, réjouissaient : on y cassait tout, dans une fièvre révolutionnaire, érotique, adolescente. Son troisième, Que notre joie demeure, s’éloigne de ces rives enflammées. Le jeune auteur est un peu moins jeune, mais il gagne en densité et en précision. Kevin Lambert semble avoir gentrifié son style, de même que ses personnages gentrifient les villes.
Kevin Lambert est un passionnant confectionneur de personnages contemporains. Cela ne fait pas tout, mais son tour de main impressionne. Ici, il dresse le portrait d’une femme, starchitecte à la tête d’une fortune colossale, cheffe d’entreprise impitoyable autant qu’artiste tourmentée… Se mêlent là Anna Wintour, Jean Nouvel, Zaha Hadid. De renommée internationale, la soixantaine, elle veut construire un immense immeuble dans sa ville natale de Montréal. Le projet suscite l’hostilité des pauvres hères expropriés, jusqu’à un scandale aux airs de chute. Rapports de classe, de race, de genre, occupation de l’espace urbain, luttes chez les ultras-riches, l’ensemble a du coffre.

Tout le ton du livre traduit ce refus de prendre parti, l’auteur préférant montrer une caste de puissants, sans gommer fragilités, désirs, complexités, passions. Humanité ? La peinture des puissants évoque, en négatif, Éric Vuillard. Si le Français ne laisse aucune chance à ses grands fauves, Lambert ne déduit rien, en termes psychologiques, des statuts et fonctions. Retour à Jean Renoir, en somme, et à son « ce qui est terrible sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons ». L’architecte et son bras droit gentrifient un quartier populaire, ils marchent main dans la main avec leurs financiers et l’État. Mais elle est aussi une fille du peuple qui a lutté pour parvenir, et son second un gay d’origine haïtienne. La transfuge de classe dut batailler pour s’en sortir, et lui se retrouve en butte aux discriminations. Alors, sont-ils dominants, dominés, ou les deux ? Le récit interdit de les juger en bloc, déjouant une éventuelle condamnation politique. À force de subtils jeux d’équilibre, le propos frôle la complaisance.
Lambert montre pourtant qu’il peut faire œuvre solide, remplaçant la verve et l’imaginaire débridé habituels par une fermeté narrative toute neuve. Par un effet de mimétisme, le livre déploie une solide architecture, soutenue par une trame bien balancée, notamment par deux scènes de fêtes, introductive et conclusive. Cette composition, au risque d’employer un poncif de la critique, signale un roman de la maturité. La chose frappe d’autant plus que les deux précédents plaisaient pour des raisons toutes différentes. Une certaine inconscience les caractérisait, ou tout du moins un refus de considérer les conséquences. Les révolutions, paraît-il, sont le fait de tout jeunes gens car ils ne mesurent pas le danger. Lambert écrivait ainsi, comme d’autres montent sur des barricades. Ce temps-là n’est plus et l’on s’en rend compte dès la première page dans le rythme de la phrase, dans la volonté de prendre le temps, d’en finir avec la saccade, la survolte exaspérée. Le premier quart du livre, scène unique et virtuose, s’attarde, approfondit, impose la maitrise d’un plan-séquence. La chose est forte, et se reproduit ailleurs.
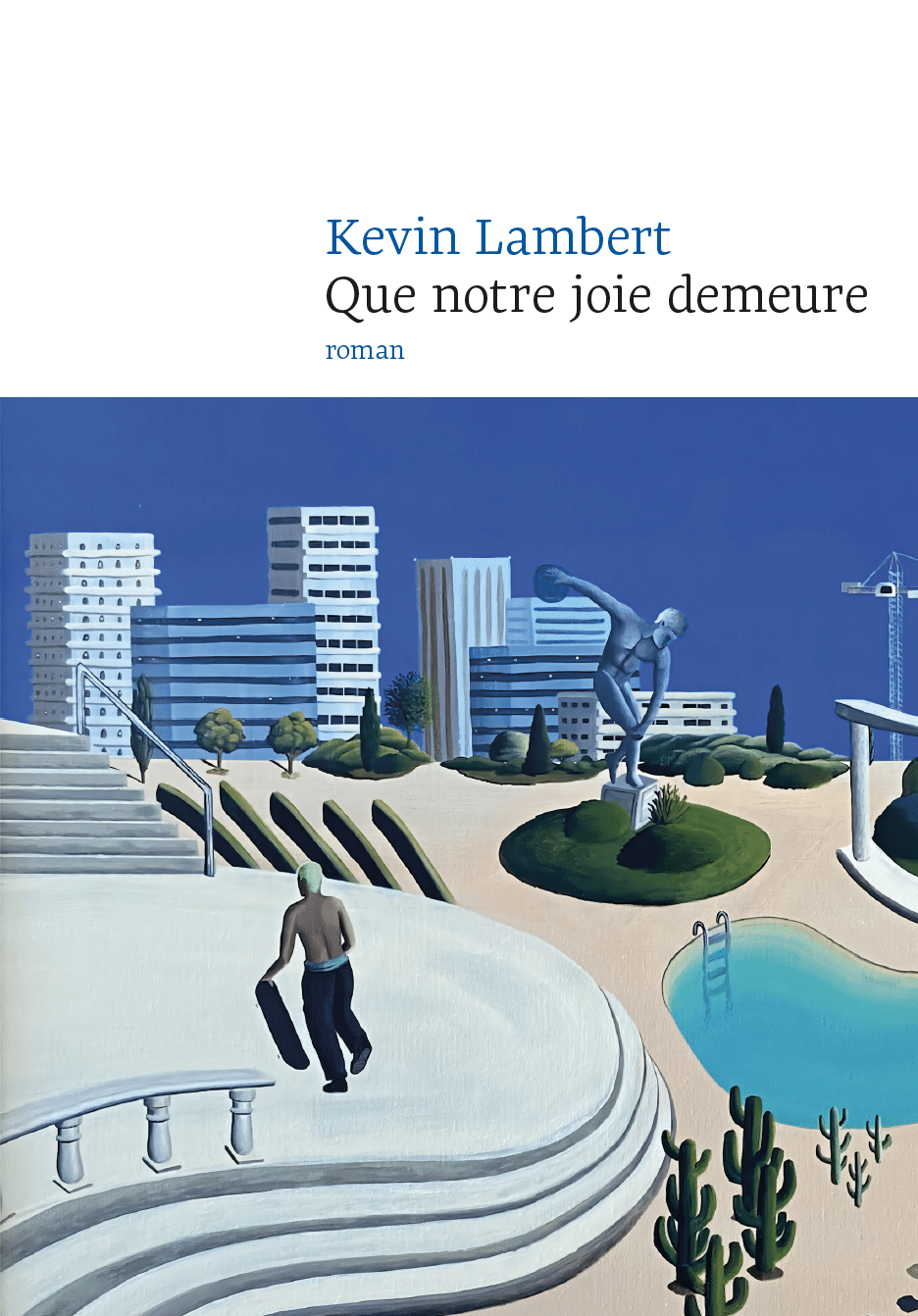
Comme dans les quartiers gentrifiés, il y a un plaisir coupable à fréquenter l’espace mis en ordre, surtout lorsqu’il ménage artistement une petite place au désordre. La phrase est plus moelleuse, les personnages moins bruts de décoffrage. La saleté a disparu. L’écriture s’est faite plus nette, plus sûre de ses effets. Par moments, tout en admirant la maîtrise et le chemin parcouru, on regrette les premiers élans punks. Cette écriture est aussi plus acceptable. La preuve, voilà Lambert sur la liste du Goncourt.
L’autre source de cet effet de poli pourrait être l’appel aux fameux sensitivity readers dénoncés à grands cris dans la presse française. La question n’a guère de sens : Lambert a fait appel à eux comme Zola prenait des notes. Est-ce révolutionnaire ? La confusion provient de l’idée que, puisqu’il y a eu appel à des personnes noires pour lire le livre et faire part de remarques à l’auteur, alors tous les personnages noirs seront nécessairement positifs. Lambert est trop écrivain, trop lecteur de Genet, pour laisser des questions extra-romanesques commander son récit. Plusieurs scènes font apparaître sous un jour déplaisant ses personnages, qu’ils soient noirs, femmes ou gays. Allons même plus loin : Lambert ne recherche le crédible que pour être plus cruel avec eux. De là l’étonnante justesse de son roman.
Selon l’angle, le lecteur trouvera attachants ou impardonnables ces constructeurs, pieds dans la boue des chantiers, mais tout à leur fausse conscience. Convaincu.e.s d’être des artistes, plutôt de gauche, qui œuvreraient au bien commun, ce sont aussi des démolisseurs, prompts à se réfugier dans le monde des idées quand les pauvres viennent taper à leur porte. Grands déverseurs de béton, ces belles âmes jouent plusieurs jeux. Celui des puissants et celui des victimes, sautant d’un camp à l’autre en fonction du contexte. Appartenant à plusieurs mondes de par leur histoire, ils peuvent s’abstraire des rapports sociaux avec aisance. Le livre les montre prompts à se réinventer, à quitter une peau pour une autre. Comme si ces gens qui rendaient la terre moins légère se révélaient aériens, liquides, laissant l’enracinement aux autres. Ce n’est pas le moindre des jeux de ce beau texte.



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)








