Dans un contexte où les données économiques saturent le débat public sur les inégalités, l’ouvrage de Nicolas Duvoux offre une perspective originale et salutaire : il vient utilement rappeler que les différences sociales ne sauraient se réduire à des écarts de rémunération ou de patrimoine mais qu’elles engagent plus fondamentalement diverses capacités de se projeter dans le temps et de s’approprier l’avenir.
Le pari de cet ouvrage important et ambitieux est de considérer le rapport à l’avenir comme une dimension majeure des différences sociales, à la fois comme capacité à élaborer des stratégies et comme critère d’inscription dans la société. Après avoir longtemps travaillé sur la pauvreté et la précarité, Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l’université de Paris 8, propose ici une théorie générale des inégalités accordant une place centrale à la subjectivité et à la temporalité.
Dépassant le débat classique entre des économistes arcboutés sur la variable du revenu et des sociologues s’en tenant souvent à la catégorie socioprofessionnelle, l’auteur souligne d’emblée l’importance qu’il entend accorder à la façon dont les individus perçoivent subjectivement leur position. L’enjeu est de placer la subjectivité au centre de l’analyse, tout en tenant compte des rapports de force et des structures sociales. L’autre critère central dans la production des inégalités est celui du rapport à la temporalité. Ayant l’ambition de prolonger et de renouveler les travaux de Thomas Piketty, Nicolas Duvoux souligne la nécessité de tenir compte des inégalités patrimoniales, pas seulement pour affiner la mesure du capital économique, mais aussi pour injecter de la temporalité dans la description de la structure sociale et pour mieux rendre compte du sens vécu par les individus. À la hiérarchie objective des ressources économiques et des places dans la division du travail se superpose une échelle subjective des représentations et des espérances : l’explicitation de cette double dimension conduit l’auteur à forger le concept de « synthèse projective », un indicateur qui permettrait de mesurer le rapport à l’avenir et de mieux saisir l’individualisation des inégalités. L’espace social se dévoile ainsi à travers deux polarités : d’un côté, un monde populaire qui se trouve dépossédé des possibilités de se projeter dans l’avenir et, à l’autre extrémité de l’espace social, des classes supérieures caractérisées par leur capacité à maîtriser l’avenir.
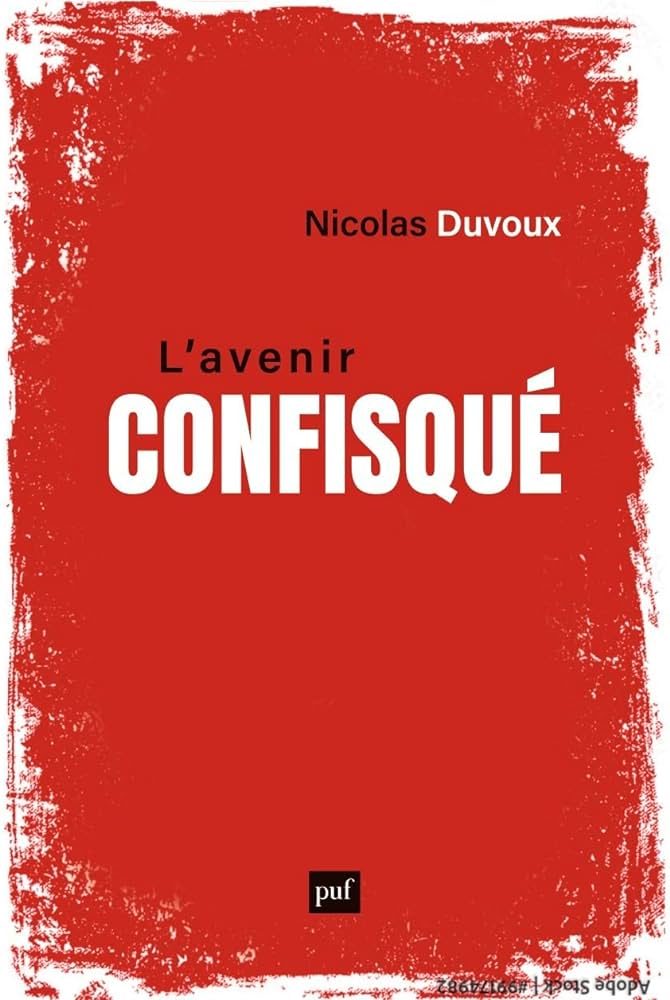
Pour étayer sa démarche, Nicolas Duvoux propose une lecture constructive et généreuse de textes injustement méconnus de Pierre Bourdieu, notamment Travail et travailleurs en Algérie (1963) et Algérie 60 (1977) dans lesquels le jeune philosophe devenu anthropologue souligne l’étroite relation entre conditions précaires d’existence et rapport incertain à l’avenir. Pour les plus stables, l’augmentation du niveau de revenu se traduit par le franchissement de « paliers de sécurité » induisant une transformation progressive puis généralisée des conduites. Les stratégies des individus ne découlent donc pas mécaniquement de leur classe sociale mais d’un rapport à l’avenir qui se déduit de leur position à un instant donné au sein d’un groupe et de la pente de la trajectoire collective de ce même groupe.
La période des trente glorieuses apparaît ainsi comme un moment de renforcement du sentiment général de sécurité, notamment pour la petite bourgeoisie qui n’a alors plus éprouvé le besoin d’être malthusienne pour espérer une ascension sociale. La relecture des travaux de Robert Castel permet de compléter la profondeur historique du propos : en jugulant l’insécurité économique des classes moyennes et populaires, l’État social leur a permis de se projeter positivement dans l’avenir. Dans cette revisite des auteurs classiques, Nicolas Duvoux impressionne par sa rigueur et sa précision qui lui permettent de prolonger ces analyses jusqu’à la période actuelle : l’effritement de cet État social accompagné d’une montée de l’insécurité économique fait naître une « peur de perdre » qui dépasse largement la catégorie des pauvres telle que la définit l’INSEE : elle gagne tous les groupes se sentant menacés de déclassement et se traduit politiquement par un retrait dans l’abstention on un soutien à l’extrême droite.
Sur le plan des principes, les propositions théoriques de Nicolas Duvoux apparaissent aussi convaincantes que stimulantes. Néanmoins, la notion de subjectivité qu’il place au centre de son analyse n’est pas exempte d’ambiguïtés : s’agit-il d’un ressenti individuel concernant des agrégats objectifs – comme par exemple la façon de concevoir son rapport à la propriété ou le sens accordé à sa trajectoire sociale – ou de représentations symboliques partagées par des groupes d’individus – le prestige d’un diplôme délivré par tel établissement supérieur plutôt que tel autre ou encore le sentiment de sécurité dont disposent les personnes ayant un patrimoine ?
Dans le premier cas, la méthode pour explorer les tréfonds de la subjectivité passe par des entretiens biographiques approfondis venant compléter éventuellement des données statistiques de cadrage, tandis que, dans le second cas, la subjectivité renvoie à un ensemble de représentations pouvant, tout comme les variables objectives, faire l’objet d’une mesure quantitative. Tout au long de l’ouvrage, c’est la deuxième acception de la subjectivité qui semble l’emporter, comme en témoigne la comparaison avec l’importance grandissante accordée à la température ressentie ou aux dimensions subjectives de la santé : pour les météorologistes et les épidémiologistes, l’enjeu n’est pas de mesurer une expérience subjective mais de se doter d’indicateurs statistiques permettant d’évaluer les conditions propices à certains ressentis. Revendiquant l’apport de ces approches, l’auteur s’en inspire pour creuser la notion de « statut social subjectif », sans préciser les questions et les indicateurs susceptibles de mesurer les représentations qui lui sont associées. L’exploitation par l’auteur d’une des rares sources à enregistrer des données sur le patrimoine ne doit pas faire oublier que la plupart des enquêtes statistiques ne mesurent pas ce que possèdent les individus (si ce n’est, parfois, par le biais d’une question sur la possession de la résidence principale). On peut se demander en outre si le genre, l’origine, l’âge ou encore l’état de santé ne contribuent pas également, à des degrés sans doute différents de ce qui se passe pour les ressources économiques et sociales, à structurer le rapport à l’avenir.
Dans le dernier chapitre, l’auteur glisse vers une autre acception de la subjectivité, celle qui renvoie aux perceptions personnelles et aux expériences singulières. On s’abstrait alors de toute enquête quantitative pour se plonger dans des entretiens qualitatifs permettant de comprendre le sens de la philanthropie pour les plus riches. Cette manière particulière de convertir du capital économique en capital symbolique s’avère être un bon révélateur d’un certain rapport à l’État, mais cette pratique, qui reste relativement marginale en France, ne suffit sans doute pas à éclairer la grande diversité des stratégies de reproduction des classes dominantes. On referme néanmoins l’ouvrage avec le sentiment d’avoir beaucoup appris sur les différentes pistes à creuser pour renouveler notre compréhension du sens des inégalités.
Alexis Spire est sociologue au CNRS. Il est notamment l’auteur de Résistances à l’impôt, attachement à l’État (Seuil, 2018).











![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)
