Paul Virilio (1932-2018) ne fut pas seulement philosophe mais aussi peintre, maître verrier et urbaniste. L’ensemble des essais qu’il a publiés entre 1976 et 2010 sont rassemblés en un volume impressionnant, qui permet de voir son apport majeur à la pensée de la destruction et de la vitesse, c’est-à-dire de notre modernité.
Il y a bientôt trente ans, Paul Virilio avait été violemment pris à partie par Alan Sokal et Jean Bricmont dans leur livre Les impostures intellectuelles (Odile Jacob, 1997), qui lui reprochait de jouer avec des liens métaphoriques entre physique, mathématique et urbanisme. Certes, quelquefois le penseur de la vitesse va trop vite, son art d’écrire, que l’urbaniste Jean Richer rapproche de l’art du vitrail, est déroutant : il n’introduit jamais dans ses livres son propos, il semble « fractaliser » chaque chapitre, tant, à différentes échelles, le lecteur retrouve les mêmes structures, une proposition, assemblant des éléments hétérogènes sertis dans le discours, comme le remarque Jean Richer, accompagnée d’anecdotes prises dans l’actualité.
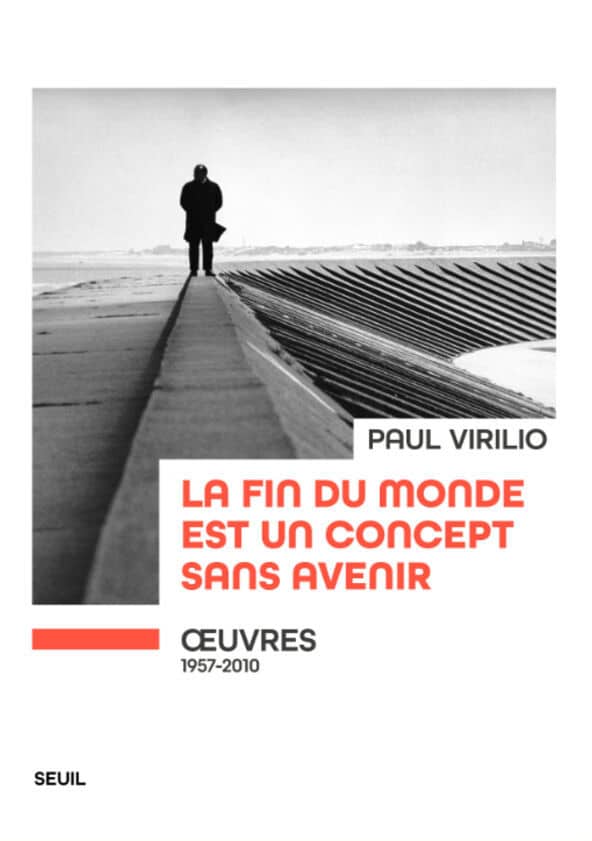
Tout se passe comme si, dans sa presse pour cause d’urgence, il fallait accélérer la démonstration (ou plutôt la monstration), quitte à laisser dans le sillage de la fulgurance de l’écriture des imprécisions, des erreurs. C’est embarrassant pour qui a le temps de la minutie académique, Paul Virilio croyait ne pas l’avoir, car ce qui lui apparaissait comme essentiel à la vie de l’humanité, le temps et l’espace, lui semblait très affecté. Et les historiens nous ont appris qu’une société humaine (on hésite à employer le mot de « civilisation » à cause des instrumentations politiques suspectes de ces derniers temps) ne peut vivre sans formalisation d’un « accordement », au sens musical du terme, des deux dimensions ; si le temps dévore l’espace, ou inversement, des déséquilibres importants se font jour. Dans ces conditions, où la catastrophe, la possibilité de « l’accident intégral », grandit en même temps que le progrès (Virilio aimait bien rappeler ce quasi-axiome arendtien), mieux vaut le marteau sur la cloche d’alarme que les notes de bas de page justificatrices.
Paul Virilio, qui nous a quittés en 2018, voulait exercer dans une situation de destruction généralisée une « résistance architectonique ». Les éditions du Seuil, sa fille Sophie et ses disciples l’ont pris au mot de manière posthume en proposant aujourd’hui un « bunker » éditorial (pour lui qui a écrit une Bunker archéologie chez Galilée en 2008). Ce volume doit se lire, selon les éditeurs, comme une fresque. La disparition du philosophe avait avant cela donné naissance à plusieurs sites. Mentionnons en particulier le site du musée de l’accident et celui qui donne accès à la revue Dromologie.
On sait que le professeur à l’École spéciale d’architecture avait été très marqué dans son adolescence, durant la Seconde Guerre mondiale (il est né en 1932), par les bombardements de Nantes où il vivait alors avec sa famille, fuyant la capitale occupée. Non seulement cette expérience lui avait fait prendre la conscience, décisive pour son œuvre ultérieure, de « l’avènement du ciel dans l’histoire », de la perspective du « dessus », mais elle le rendra sensible aux formes architectoniques susceptibles de résister à « ce qui arrive » d’effroyable. C’est ainsi qu’il se passionnera pour le réseau de bunkers installé par les Allemands sur la côte Atlantique, que, plus tard, il donnera à l’église Sainte-Bernadette de Nevers, conçue avec Claude Parent, la forme d’un blockhaus, qui, de figure même de la suffocation, devient résistance et protection, comme le souligne Eyal Weizman dans sa préface, et qu’il lancera ensuite, toujours avec Claude Parent, le mouvement « Architecture oblique » (fin de l’horizontalité et de la verticalité au profit de l’oblique et de la diagonale).
Par son grand format, par sa composition intérieure en double colonne, ce volume, s’il rend hommage à son auteur, n’épargne pas le lecteur qui peine à le manipuler. Un peu d’« oblique » dans ce rectangle n’aurait pas nui, même si l’on ne voit pas bien ce que cela pourrait donner dans le cas de la forme livre. On doit regretter également que les éditeurs n’aient pas éprouvé le besoin de justifier le choix du titre général : pourquoi cette citation de l’auteur plutôt qu’une autre ? Pour montrer le caractère optimiste de sa pensée ? Mais Virilio ne se situait pas dans l’opposition optimisme/pessimisme. Quoi qu’il en soit, nous avons là, non les œuvres complètes de Paul Virilio ‒ ou, vaudrait-il mieux dire, les « ateliers » complets, selon le beau texte de Sophie Virilio ‒, mais l’ensemble de ses essais sur près de cinquante ans, auxquels s’ajoutent des extraits des carnets, lesquels mériteraient sans doute publication. Tenus depuis 1955, ils sont enchâssés dans une étude magistrale signée Jean Richer.
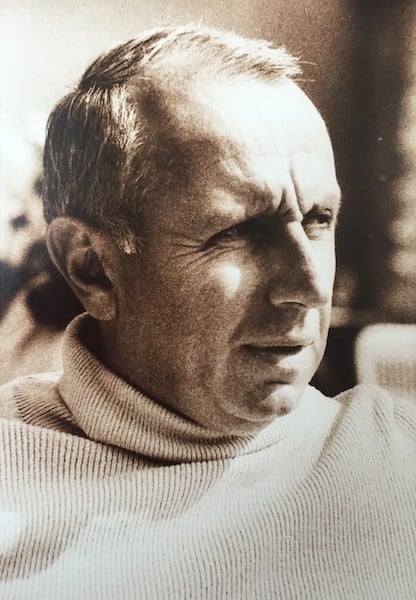
On a touché à l’espace, aurait pu dire Paul Virilio en paraphrasant Mallarmé, mais également au temps. La distance temps-espace est abolie au profit d’un « espace-vitesse ». Tout le travail critique va consister à tirer toutes les conséquences de ce phénomène pour l’habitation terrestre. En 1984, le philosophe publiait L’espace critique (primitivement un rapport pour le ministère de l’Urbanisme), qui était aussi le titre de la collection qu’il dirigeait aux éditions Galilée et dans laquelle il a promu Baudrillard et le très célèbre Espèces d’espaces de Perec. Dans ce livre, qui avec celui qui l’a précédé, Essai sur l’insécurité du territoire (1976), reste la matrice de l’œuvre, le mot « critique » était à entendre au sens de l’expression « masse critique », l’espace est dans une situation critique, il est au point où tout bascule. Il faut donc une critique de l’espace dans un espace (éditorial) critique (toutes ces nuances jouaient ensemble dans le titre).
Non que l’humanité entre au XXe siècle dans l’ère du « télé », l’anthropologie philosophique allemande, et notamment Blumenberg, a montré qu’une des caractéristiques de l’homme est l’action à distance, qu’il faut comprendre aussi bien comme agir à distance que comme mise à distance, mise en distance, littéralement dimensionner, c’est-à-dire, non pas seulement mesurer, mais habiter dans « l’entier », ce que les Grecs appelaient le « lieu », espace sensible (perceptif et affectif). C’est la notion même de dimension qui est « perdue », qui est en crise, l’espace ne l’est plus, il devient « surface » et même « interface » : « cette toute nouvelle surface » qui annule la séparation classique de position, d’instant ou d’objet, ainsi que la traditionnelle partition de l’espace en dimensions physiques, au profit d’une configuration instantanée, ou presque, où l’observateur et l’observé sont brusquement couplés, confondus et enchaînés par un langage codé », et dans laquelle « l’écart se creuse entre le sensible et intelligible ». Mais elle abolit également les extases temporelles que sont le passé, le présent et le futur, au profit de l’immédiateté et de l’instantanéité, au point de susciter une « insécurité de l’Histoire », se surajoutant à celle du territoire.
Et l’écologie ? Paul Virilio lui fait le reproche d’être trop « verte » et pas assez « grise », autrement dit de ne pas prêter assez attention aux phénomènes de pollutions mentales, auxquelles appartiennent la pollution de l’espace et celle du temps. Dans ce contexte de dimension perdue, le plus grave est la perte de la dimension des dimensions, à savoir celle de la Terre, devenue « le membre fantôme de l’humanité ». Elle n’existe plus comme « sol ». L’être du « trajet d’ici à là », l’entre-deux, l’intervalle, disparaissent. Plus de départ, tout « arrive », l’accident général. L’habitat n’est plus qu’un habit trop petit dans lequel « l’homme-planète » souffre de claustrophobie (la Terre comme bunker asphyxiant) et vit mal son confinement, rendant insupportable cet autre confinement, celui des limites de la planète, condition de son habitabilité, et sur lequel Bruno Latour a tant insisté. Ce qui excite « la propagande pour une émancipation extraterrestre et exobiologique ».
À quoi aura servi la pensée de « reconnaissance », comme il y a des avions du même nom (image dont use Paul Virilio pour désigner ses carnets), de Paul Virilio, qu’Eyal Weizman compare au Virgile de Dante nous accompagnant dans notre « enfer contemporain » ? Ici, la vue du « dessus » de la reconnaissance ne précède pas le bombardement ni le soutien au repérage du danger. Outre le fait qu’il rejoint pour toujours la cohorte des « avertisseurs d’incendie » que sont Anders, Ellul, son cher Walter Benjamin et tant d’autres, la « reconnaissance » virilienne (le mot « vir » latin, l’homme de courage, vient d’une racine indo-européenne qui se réfère au guerrier, au héros) est un acte non violent de combat, et d’abord, et avant tout résultat exploitable, un effort presque surhumain, dont seul un artiste pouvait avoir la force, pour poser les conditions d’une culture, qui reste à naître, capable d’affronter le risque de la perte, non plus seulement de la dimension, mais du monde.












