Avec Des choses qui arrivent du romancier algérien Salah Badis et Les carnets d’El-Razi du Tunisien Aymen Daboussi, se lance « Khamsa », une nouvelle collection en partenariat entre les éditions algériennes Barzakh et l’éditeur français Philippe Rey, consacrée à la traduction en français des fictions arabophones du Maghreb. En attendant Nadeau a rencontré Sofiane Hadjadj, cofondateur avec Selma Hellal de Barzakh en 2000, pour parler de la littérature maghrébine arabophone et francophone, des problèmes de traduction rencontrés et de la façon dont il conçoit son rôle d’éditeur.
Une question de traduction, pour commencer. En arabe, le nom de votre maison, « barzakh », signifie « obstacle », mais aussi « une étape ou un lieu entre la mort et la résurrection ». Vous, comment le traduisez-vous ? Et pourquoi avoir choisi ce nom pour votre maison d’édition ?
Il y a vingt-trois ans, quand on a choisi ce mot, qui n’est pas d’origine arabe mais dont on trouve plusieurs occurrences dans le Coran, la situation politique en Algérie était assez claire. Le pays sortait de ce qu’on appelle la décennie noire, celle du terrorisme, dix ans d’une guerre assez dure qui laissait deux cent mille morts et une situation économique catastrophique. « Barzakh » est un mot qui désigne littéralement l’isthme, c’est-à-dire l’endroit où un fleuve se jette dans la mer, l’endroit où se crée une barrière invisible avant que les eaux douces et les eaux salées se mélangent. Métaphysiquement parlant – surtout chez les mystiques, car ce sont eux qui ont développé le concept –, c’est à la fois une temporalité et un lieu, c’est le moment et le lieu après la vie et avant la mort. Dans une terminologie française, on pourrait rapprocher cela des limbes, un lieu intermédiaire où l’âme a déjà été arrachée au corps mais n’a pas encore rejoint l’au-delà.
Quand Selma Hellal et moi-même avons créé la maison d’édition en 2000, l’Algérie était coincée entre deux types de discours (pour faire bref) : le discours religieux islamiste, radical et dogmatique, et un discours politique, celui de l’État en lutte, pour lequel la ligne était assez claire : il y a les bons et les méchants, et il faut sauver le pays des malfaisants. Mais on avait l’impression d’être pris en otage entre ces deux postures, et pour nous, éditer des livres, éditer de la littérature surtout, c’était porter une voix qui raconterait autre chose, et notamment ce que devrait raconter la littérature : l’ambiguïté et la complexité des choses.

Quelle ligne éditoriale aviez-vous en tête à l’époque, et comment a-t-elle évolué (ou pas) en vingt-trois ans ?
On s’est jetés à l’eau sans aucune expérience, sans la moindre idée préconçue sur le métier d’éditeur, sinon que nous étions lecteurs de littérature. C’est un moment où l’Algérie était totalement isolée. La plupart des écrivains et écrivaines étaient en exil au Liban, au Maroc ou en France, et commençaient à se faire éditer plutôt à l’étranger, en arabe ou en français. Le paysage éditorial algérien était un champ de ruines, mais il y avait des jeunes et des gens qui vivaient, qui continuaient à vivre. D’une certaine manière, c’était une phase de renaissance. On recevait beaucoup de propositions de texte et, sans trop savoir comment, on a publié deux premiers romans en arabe et deux premiers romans en français dès la première année. Ils étaient très mal édités, très mal imprimés, très mal distribués, très mal tout ! En revanche, les quatre auteurs qu’on a publiés cette année-là sont de bons auteurs qu’on a continué de publier, et notamment Mustapha Benfodil, qui est toujours chez nous vingt-trois ans plus tard et qui a maintenant une vraie œuvre, reprise en français.
On n’avait pas de ligne éditoriale. Si on devait filer la métaphore, on avait une canne à pêche, on a jeté la ligne et puis on a regardé ce qu’on ramassait sans idées préconçues, sinon que justement on n’avait pas d’idées préconçues. Comme le dirait Milan Kundera, et je crois que c’est très important : la littérature, c’est le lieu où se suspend le jugement moral. Nous n’avions pas de morale à poser sur la situation politique du moment, ni contre, ni pour, ni anti, ni je ne sais quoi.
Les livres qu’on éditait n’étaient pas là pour dénoncer une situation ou signifier un engagement, on essayait seulement de faire de bons livres. Je sais toujours pas ce que c’est un bon livre, mais on voulait travailler avec des auteurs qui avaient des choses à raconter, qui les racontaient de manière singulière. Vingt-trois ans après, on a envie de continuer sur cette voie-là.
La langue est au cœur de la collection Khamsa, puisqu’il s’agit d’y publier des traductions de textes littéraires depuis l’arabe. C’est une démarche qui remet en question le rapport de l’arabe au français, étant donné qu’historiquement les traductions ont plutôt été faites dans l’autre sens. Comment vous situez-vous dans ce rapport entre les langues ?
Historiquement, les pays du Maghreb sont sortis de la page tragique de la colonisation au début des années 1960, et il est évident qu’à ce moment-là le français était encore très présent au Maghreb, et surtout en Algérie, puisque c’est le pays qui a été le lieu d’une colonisation de peuplement. Toujours est-il qu’une histoire intellectuelle, une histoire culturelle et une histoire littéraire francophone s’étaient construites dans ces pays. De grands livres ont paru dès les années 1920/1930/1940, en français, d’auteurs qui ont fondé la littérature maghrébine – au Maroc, Driss Chraïbi ; en Algérie, Mohammed Dib, Kateb Yacine, Taos Amrouche, Jean Sénac ; en Tunisie, Albert Memmi… Ces grands noms ont inventé des outils littéraires, d’autres manières de raconter des histoires, de mettre en scène des personnages, et ils ont créé une façon d’écrire, une façon de regarder le monde essentiellement en opposition à la colonisation.
À l’indépendance, ces élites politiques et culturelles étaient encore francophones, puis au fil des décennies tous ces pays ont engagé des politiques d’arabisation. L’arabe, qui était la langue vernaculaire, la langue du peuple, la langue du quotidien, a commencé à combler son fossé culturel. Mais il a quand même fallu attendre 1971, soit presque une décennie après l’indépendance, pour que soit publié en Algérie le premier roman de langue arabe : Le vent du sud, d’Abdelhamid Benhedouga. Depuis, des auteurs en langue arabe ont commencé à émerger et sont devenus des référents, et aujourd’hui un auteur de langue arabe peut faire son éducation et construire sa culture littéraire totalement en arabe, mais il aura quand même cette grande montagne francophone derrière lui. Un auteur algérien ne peut faire fi de la lecture de Mohammed Dib, ou bien il risque de se couper d’une partie de son histoire. On est donc dans un moment très intéressant, très fructueux et très riche du point de vue de la création littéraire.
Mais il y a aussi le rapport de l’arabe vernaculaire maghrébin à l’arabe littéraire, car, en publiant ces textes, vous donnez de facto au premier un statut de langue littéraire à part entière, non ?
Encore une fois, l’Algérie a été colonisée très longtemps, et dans ce pays la langue arabe a été masquée, effacée, éradiquée, écrasée par la colonisation. On n’a pas bénéficié de l’évolution de la langue arabe qui, au Liban ou en Égypte, par exemple, a intégré dès le XIXe siècle les sciences, la philosophie, la musique, et a permis à ces pays de développer toute une littérature au cours de la Nahda, la renaissance culturelle arabe moderne. Il y a eu de grands mouvements de traduction et les Libanais ou les Égyptiens ont pu lire Balzac, Zola ou Maupassant dès cette époque. Rien de tel en Algérie. À l’indépendance, 90 % des Algériens étaient analphabètes et la langue arabe était vraiment circonscrite à la pratique religieuse, au parler du quotidien ou encore à la chanson arabe dans ses différentes déclinaisons, qui était très importante d’un point de vue culturel.
Aujourd’hui, les écrivains de langue arabe travaillent dans un environnement mondialisé. Leur langue est moderne, c’est celle de l’information, des télé-satellites, du monde contemporain, mais elle demeure très ancrée dans le religieux, car elle est la langue du sacré. C’est aussi celle du quotidien le plus prosaïque, du rap, des chants de supporters, et les auteurs doivent donc composer avec tout ça et remettre en question cette langue, la malaxer, la réinterroger tout en gardant cette dimension sacrée qui est profonde, qui a quinze siècles. C’est aujourd’hui l’un des enjeux littéraires majeurs pour les écrivains arabophones au Maghreb, parce que, contrairement aux auteurs égyptiens ou originaires du Proche-Orient, ils ont en face d’eux la France, la colonisation et la langue française, cette mémoire atavique. Ils doivent composer avec tous ces enjeux, mais aussi avec ceux du contemporain. Je ne sais pas si on peut parler de créolisation, qui est un mot très à la mode, un peu récupéré politiquement, ce n’est pas un métissage non plus, car je trouve que ce mot a des connotations péjoratives, mais ils sont dans un moment où ils doivent travailler la langue…
Un brassage ?
Oui, un brassage ! Moi j’aime beaucoup cette idée-là, j’écoute beaucoup de hip-hop et de rap parce que j’aime cette culture du sample, la culture du brassage, on prend des boucles ici ou là, on les malaxe, on réinvente une langue et on donne une énergie nouvelle. Je crois qu’on est dans ce moment où la langue n’est plus simplement quelque chose de figé qui a une origine et qui va vers un point. Aujourd’hui, elle subit des influences, elle est dans des contradictions, elle est une somme de paradoxes, d’une certaine manière.
Dans le même ordre d’idées, vous précisez sur le rabat de vos ouvrages que Khamsa « se veut une fenêtre ouverte sur l’imaginaire littéraire de pays si proches par l’histoire et la géographie humaine… ». Quel est-il, cet « imaginaire littéraire » arabophone contemporain ? Et comment ses auteurs s’inscrivent-ils et/ou se détachent-ils de l’histoire littéraire maghrébine ?
Aujourd’hui, on raisonne à l’échelle mondiale, c’est d’ailleurs l’un des points qui a nourri notre réflexion littéraire sur la question de l’édition. Quel regard peut-on porter sur les textes ? Les réflexions que peuvent mener certains chercheurs ou penseurs sur la littérature mondiale, que ce soit dans les pays anglo-saxons, en Afrique ou en France, nous influencent beaucoup dans la façon de penser la lecture. On ne peut pas faire autrement, on est local et global, donc quand on est à Alger, on est en même temps à Lagos, à Stockholm, à New York ou à Pékin. La façon dont on regarde les textes est forcément différente. On reçoit des textes par mail, les auteurs ont souvent des pages Facebook ou Instagram, on regarde qui ils sont, ce qu’ils font… Ça a beaucoup changé la perception des textes, mais aussi la façon d’éditer, de lire, de critiquer… Tout l’écosystème est perturbé. Néanmoins, vingt-trois ans après la création de Barzakh, je crois que la notion d’entre-deux demeure pertinente. Elle est pas très populaire aujourd’hui parce qu’on est plutôt dans un moment de radicalité, de pensées qui sont plutôt droites. Nous, on préfère les lignes courbes, les chemins de traverse… Je pense qu’il faut défendre encore cette idée du pas de côté, de l’entre-deux, de quelque chose qui n’est pas clair. Parce que la clarté peut être confortable, voire désirable, mais je pense que la confusion et l’ambiguïté ne relèvent pas uniquement de la complexité et du paradoxe. La confusion et l’ambiguïté sont au cœur de tous les livres qu’on publie, sans exception, y compris parce qu’on les fait depuis Alger, et on ne se fait pas que des amis… mais on se fait aussi des amis ! Cela étant, je crois qu’il est nécessaire de défendre l’ambivalence et l’ambigu dans un moment où tout le monde se pose des questions un peu trop tranchées, un peu trop radicales. Nos livres n’apportent pas de réponse, ils ne sont pas aimables, en vérité, c’est ça, ils ne sont pas aimables, on n’en ressort pas avec des certitudes, on ne se situe pas dans un camp ou un autre… Ça, ça ne nous intéresse pas.
Par ailleurs, il est intéressant de remarquer une distinction entre les auteurs arabophones et francophones. Pour le dire très succinctement, au Maghreb, les auteurs francophones sont plutôt issus de milieux sociaux un peu plus privilégiés – de la petite bourgeoisie ou des enfants de médecin ou d’ingénieur – alors que les auteurs arabophones viennent de milieux plus modestes et cela se traduit aussi dans les textes. Les arabophones écrivent des histoires un peu plus dures, moins spéculatives, qui traduisent des quotidiens plus prosaïques, des petites histoires à propos de petites gens. On sent une volonté d’exprimer une voix propre, un « je », dans des sociétés qui restent malgré tout très structurées par le collectif, par une dimension sociale unitaire qui est celle de : « Une seule langue, l’arabe, une seule religion, l’islam ».

Quand on lit les nouvelles de Salah Badis ou le roman d’Aymen Daboussi, on perçoit aisément, à travers la diversité des personnages qu’ils mettent en scène, une hétérogénéité sociale en Algérie et en Tunisie très éloignée de l’image tronquée qu’on peut s’en faire de ce côté-ci de la Méditerranée. On a l’impression qu’il est important pour vous, éditeur, d’en témoigner. Malgré tout ce que vous venez de me dire, c’est une forme de militantisme, non ?
En effet, cette hétérogénéité traduit les réalités du Maghreb d’aujourd’hui, qui ne sont pas seulement celles qu’on présente dans les médias. Ces pays sont des sociétés complexes, contradictoires, où il se passe des choses très différentes, qu’on n’imagine peut-être pas, et je crois que tous les auteurs qui publient au Maghreb essaient de traduire d’abord cette complexité sociale et cette hétérogénéité. Leur positionnement, de même que le nôtre, n’est pas militant. Au contraire, nous défendons le singulier, une voix ou des voix qui expriment quelque chose sans prétendre à la vérité. Nos livres ne sont pas de grandes théories sur la société algérienne ou tunisienne, ce sont des tranches de vie, des personnages parfois étranges, parfois loufoques, parfois un peu durs et, comme je le disais tout à l’heure, pas très aimables non plus. On n’a pas particulièrement envie d’aimer les personnages d’Aymen Daboussi, par exemple, ils nous font plutôt de la peine parce qu’ils traversent des situations difficiles et on sent qu’il y a une forme de désespérance derrière tout ça.
On est dans des sociétés intermédiaires en voie de sécularisation où la question de l’individu est en train d’émerger dans sa vraie raison d’être. C’est la question de la singularité et non pas celle du militantisme, mais, en même temps, être dans la singularité, c’est quand même une façon de s’engager, d’engager son propre corps et sa propre voix, donc ça rejoint d’une certaine manière le militantisme.

Quelle est la place des autrices dans le renouveau de cette littérature, et est-il plus difficile pour elles que pour les auteurs de faire entendre leur voix ?
Je suis convaincu qu’aujourd’hui le grand combat des sociétés du Maghreb est celui de la place des hommes et des femmes. Pour l’instant, la situation des droits des femmes n’est pas la même dans ces trois pays : elle est plutôt avancée en Tunisie, et plutôt laborieuse (pour être gentil) en Algérie et au Maroc. Mais aujourd’hui, ce sont des pays jeunes, des pays à parité, où quasiment tous les Maghrébins sont éduqués, voire font des études supérieures et où, comme partout dans le monde, il y a une majorité de filles dans les universités et notamment dans les filières littéraires. Les femmes accèdent à l’enseignement supérieur, au marché du travail. Ce sont aussi des pays où la fonction publique est très importante, et on trouve de nombreuses femmes dans les écoles, les hôpitaux ou l’administration, même si le statut juridique de la femme n’a pas beaucoup évolué.
On constate que de plus en plus de femmes se lancent dans la création, que ce soit au théâtre, dans le cinéma ou la littérature, mais pour elles c’est plus difficile. Il y a toujours une dimension patriarcale qui fait obstacle à leur démarche. Écrire pour soi, c’est le premier pas ; écrire en marge ou sous le regard du père, du frère, du cousin, c’est déjà une transgression ; vouloir publier en est une autre ; envoyer son manuscrit, signer avec un éditeur, et plus encore assurer la promotion d’un livre, sont autant de transgressions supplémentaires. Il nous est déjà arrivé de publier des autrices sous pseudonyme, et ce n’est pas un hasard. Pour une femme, écrire n’est pas encore très acceptable socialement. Mais ça évolue.
Cela pose d’ailleurs le problème de la fonction un peu cathartique que certains, consciemment ou non, confèrent à la littérature : « Par la littérature, je vais me soigner, essayer de sortir de mes angoisses, de mes contradictions, de mes oppressions, de cette question du patriarcat… » On reçoit beaucoup de textes écrits par des femmes qui n’ont pas encore su aller au-delà de cette première étape cathartique, qui restent dans la revendication ou la dénonciation. Les hommes ont moins de mal à s’en détacher, probablement parce qu’ils jouissent d’une plus grande liberté sociale. Mais il y a de plus en plus d’autrices importantes et confirmées au Maghreb, en Égypte et dans le monde arabe.
D’ailleurs, le prochain livre qu’on publiera en 2024 dans la collection Khamsa – un gros roman extraordinaire, vraiment très beau – est signé par une autrice tunisienne. Je crois qu’aujourd’hui les hommes et les femmes se débattent avec ces considérations sociales, mais notre travail d’éditeur ne consiste pas à devenir le reflet des militantismes et des engagements sociaux d’émancipation, parce que cette posture donne parfois des textes un peu trop militants. On peut en publier de temps en temps, bien sûr, pourquoi pas ! Mais notre travail, c’est plutôt de proposer des textes de création. Comme je le disais tout à l’heure, la littérature est mondiale, et aujourd’hui on peut plus réfléchir uniquement d’un point de vue local. Dans notre rapport à la littérature, on est obligé de prendre en compte les questions théoriques, et aussi les questions pratiques. Mais aujourd’hui, selon moi, tant pour les hommes que pour les femmes et même les jeunes femmes, la question du patriarcat est au cœur des problématiques. C’est le grand combat en cours et à venir.
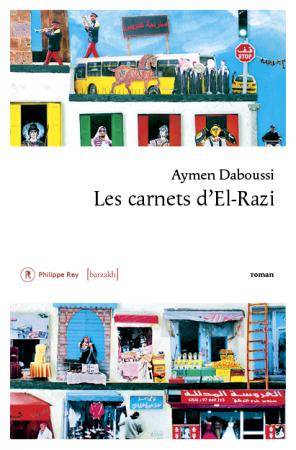
Effectivement, avec les deux premiers titres de votre collection, j’ai vraiment eu la sensation de lire des histoires et de rencontrer des personnages, mais sans revendication directe ou explicite de l’auteur, et j’ai trouvé que, d’une certaine manière, on sortait de la littérature postcoloniale, on va même dire postcoloniale 2.0.
Exactement ! Il y a pas de discours théorique, de dénonciation d’un état du monde ou des oppressions, mais des tranches de vie, des personnages qui se racontent un peu dans leur dérèglement, un peu dans leur folie, un peu dans leur tristesse, un peu évidemment dans l’engagement parce que ce n’est pas anodin d’écrire comme ça. Prenons Aymen Daboussi, par exemple, qui écrit en arabe un texte assez fort et assez dérangeant, eh bien ce n’est pas simple d’assumer un tel texte dans une société où la religion est aussi centrale et verrouille tellement de choses, c’est un risque ! Et la difficulté pour lui, c’est de rester quand même libre dans son écriture, de pas répondre à des injonctions, qu’elles soient religieuses, politiques ou sociales.
On l’a compris, la langue est primordiale dans votre démarche. Vous avez fait appel à Lotfi Nia pour effectuer la traduction de ces deux textes en préservant leur singularité. Comment s’est passé ce travail ?
L’une des difficultés qu’on rencontre lorsqu’on traduit ce type de texte du Maghreb, c’est que les auteurs sont souvent francophones – Salah Badis est même traducteur du français vers l’arabe –, et s’ils ne sont pas capables d’écrire en français, ils le lisent parfaitement. Pour Lotfi Nia, le traducteur, c’était enthousiasmant, mais c’était aussi un beau défi, parce qu’il y avait beaucoup d’interactions avec les auteurs et, au bout d’un moment, il y avait trop d’interactions avec les auteurs ! Pour le dire sans détour, ces derniers voulaient se mêler de tout, parce qu’ils pouvaient lire la traduction au fur et à mesure et donner leur avis. Mais Lotfi Nia étant lui-même poète, avec les éditeurs, on a essayé de trouver un juste équilibre où les auteurs ne sont pas là en permanence pour tout réécrire à leur sauce et où le traducteur demeure l’auteur de sa traduction. C’était Lofti la force de proposition, il a d’ailleurs rédigé une petite note pour expliquer ses partis pris et sa méthode de travail, ce que je l’ai vivement encouragé à faire. Et il est véritablement l’auteur de ces traductions.












