Le nouvel ouvrage de Pierre Crétois, La copossession du monde, poursuit l’analyse critique de la notion de propriété entamée dans La part commune, l’envisageant cette fois sous l’aspect économique quand elle était précédemment considérée du point de vue juridique.
Ainsi, après avoir mis en cause la tradition de « l’idéologie propriétaire », c’est-à-dire la pensée selon laquelle la propriété « est un droit naturel en tant qu’elle récompense le travail et le mérite », l’auteur s’attaque-t-il maintenant à « l’ordre propriétaire » qui défend la propriété privée en raison de ses « conséquences collectivement avantageuses » : elle « serait à même de mettre fin au chaos qui règnerait là où tout est commun » et « serait également de nature à réunir spontanément les conditions d’un certain ordre social ». L’emploi du conditionnel indique assez que l’auteur entend mettre en question la pertinence de cette représentation dont il commence par souligner « le rôle cardinal d’ordonnancement des sociétés en général et des marchés en particulier ». Son intention est du reste de promouvoir « une refondation contractualiste de [la propriété] à partir des exigences du commun ».
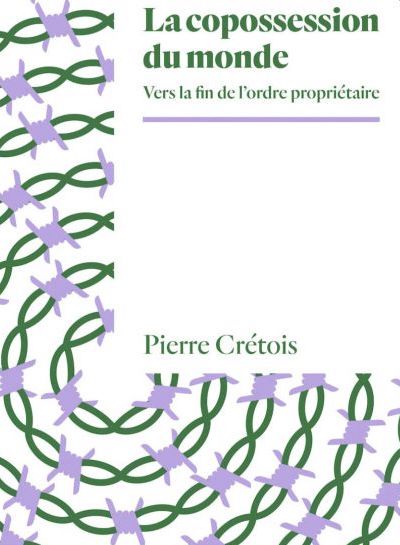
Pierre Crétois commence par revenir sur les fondements des deux arguments principaux qui soutiennent l’ordre propriétaire. Il met ainsi en évidence l’origine hobbesienne de l’idée selon laquelle la propriété privée permet d’éviter « la tragédie des communs », selon l’expression qui donne son titre à un « article capital paru en 1968 dans la revue de référence Science » de Garret Hardin. Contemporain d’une période de guerre civile, l’auteur du Léviathan envisage une « situation hypothétique », sans ordre politique assuré où « tout le monde pourrait légitimement avoir des droits sur tout », afin de montrer qu’elle conduit « au conflit généralisé ». Cela le pousse à défendre les « biens rivaux et exclusifs », qu’on nomme aujourd’hui les « biens privés », parce qu’ils permettent de « séparer les individus qui, sinon, se feraient la guerre », et à proposer un « libéralisme autoritaire » pour lequel « l’État n’a aucune vocation à réguler l’économie », se devant simplement « de réunir les conditions de son existence ». Utile pour éviter les conflits, donc, la propriété privée permet en outre de prévenir « la tragédie des ressources » liée à la limitation de ces dernières pour une population humaine toujours croissante. Cette idée, avancée dès le XVIIe siècle par Grotius, va être précisée par Malthus qui envisage « l’introduction de la propriété » comme une des « techniques de gouvernement », selon l’expression de Michel Foucault, « qui accompagnent la naissance de l’économie politique ». On est loin de la tradition issue d’Adam Smith prônant le laisser-faire dans laquelle s’inscrivent la plupart des économistes qui tiennent les droits de propriété « pour une réalité donnée, permettant l’organisation efficiente des marchés ».
Quant au second argument soutenant la propriété privée, qui assure qu’elle permettrait l’émergence d’un « ordre politique spontané », l’auteur l’envisage essentiellement à partir des analyses de Friedrich Hayek. Il faut dire que celui-ci, dont l’ambition n’est autre que de « réaliser pour le XXe siècle ce que Montesquieu avait fait pour le XVIIIe », développe bien « une philosophie politique pour notre temps » valant sans doute plus que ce que pensent ses adversaires. La présentation de cette défense de l’ordre propriétaire donne tout son relief à la deuxième partie de l’ouvrage qui s’attache à pointer ses « illusions et défaillances ». Pierre Crétois y réfute de manière claire et convaincante des thèses qui ont réussi à s’imposer comme rationnelles au point d’être rarement mises en question. Ainsi fait-il valoir que l’ordre spontané fondé sur la propriété privée défendu par Hayek peut s’avérer plus qu’instable ; que, livré à lui-même, le marché « est non seulement incapable de surmonter certains désordres mais les amplifie même de façon chaotique ». Il montre en outre combien l’esprit propriétaire, « qui ramène chacun exclusivement à ce qui est à lui », diffère de l’esprit civique, lequel, « sans pour autant annuler la propriété, la subordonne à des considérations d’ordre politique ». Il est alors possible de saisir que « les disparités qui voient le jour du fait du marché structurent des rapports de pouvoir qui rendent possibles des formes d’extorsion » et que le concept marxien d’exploitation n’a « rien perdu de sa pertinence ». La propriété privée des moyens de production s’avère ainsi « un des éléments qui nuisent le plus à l’autogouvernement de tous ». Quant à l’idée d’une démocratie des consommateurs, défendue par certains libéraux envisageant l’achat comme un acte citoyen, notre auteur n’a guère de difficulté à la mettre à mal : non seulement la consommation ne relève pas du même type de choix que celui qui prévaut lors d’un vote, mais le fait de privilégier « la volonté que l’agent forme en considérant ses besoins domestiques » ôte « toute pertinence à la volonté qu’il peut avoir en prenant en compte des objectifs collectifs ».
Il s’agit donc d’envisager « une alternative raisonnable au tout-marché néolibéral » ; ce qui suppose de repenser la propriété dans les termes d’une copossession ainsi que le manifeste la dernière partie de l’ouvrage. L’idée est de sortir de « l’isolationnisme propriétaire » afin « d’inscrire dans la définition même des droits de propriété, les droits d’autrui, des générations actuelles et des générations futures ». Il ne sera plus question de posséder des choses en propre, mais d’être titulaire de droits sur elles, « droits relatifs aux droits des autres » dont on perçoit le « caractère fondamentalement politique ». Il faut bien mesurer la portée de la proposition qui conduit à refuser que la propriété soit un droit fondamental : la propriété des moyens de production ou de capitaux ou celle que l’on peut appeler, avec John Rawls, la « propriété personnelle » portant sur des « objets individuels et insubstituables ».

Certains pensent pourtant avec Margaret Radin que ce dernier type de propriété est requis pour le bon développement de chacun au prétexte que « la continuité de l’identité personnelle ne peut être assurée, sans une certaine garantie de la continuité de notre rapport aux choses ». Sensible à cet argument, Pierre Crétois considère cependant qu’il porte moins sur la préservation de la propriété en tant que telle que sur l’ensemble des conditions requises pour l’exercice effectif des « facultés morales de la personne ». L’esprit propriétaire devient ainsi de plus en plus difficile à soutenir. Il cesse définitivement de l’être avec la prise de conscience du fait que nous sommes en dette vis-à-vis de la société, comme l’indiquait déjà Léon Bourgeois, et redevables aux générations passées ayant dégagé les savoirs dont « nous profitons quotidiennement ». Autant dire que « nous ne produisons rien seul » et qu’il convient d’admettre que « ce que nous avons est, d’une certaine manière, copossédé ». L’individu n’est donc plus seul à avoir des droits sur sa propriété, la puissance publique étant légitime à limiter la jouissance qu’il prétend avoir sur les choses qu’il détient. Ce pourquoi l’auteur parle de copossession politique du monde.
Il faut bien mesurer l’ambition de la thèse défendue : comment envisager la propriété « comme une modalité du commun » sans en appeler à un changement profond de mentalité et de comportement des individus ? Pierre Crétois invite à tourner radicalement le dos à l’homo œconomicus, cet être égoïste et calculateur que les néolibéraux conçoivent comme la quintessence de l’humanité. C’est tout l’intérêt de son ouvrage, nous semble-t-il, que de porter ainsi l’exigence de ce qu’on pourrait appeler une mutation anthropologique ; et l’on regrette que l’auteur n’y insiste pas davantage. Peut-être est-il trop conscient que beaucoup la jugeront inconséquente parce qu’irréalisable, toujours est-il qu’on a l’impression qu’il ne semble pas toujours l’assumer, ou pas tout à fait. On s’étonne, par exemple, de l’application qu’il met à faire valoir que ses vues s’accordent aux exigences de justice telles qu’on peut les concevoir à partir des cadres de pensée de John Rawls, alors même qu’il reconnaît que la défense de l’idée de copossession politique du monde suppose, non de se placer sous un voile d’ignorance afin de se détacher de ses conditions sociales d’existence, mais bien de s’envisager prioritairement comme être social, comme citoyen conscient de son inscription dans un monde qui le détermine et des liens qui l’unissent à ses semblables comme à son environnement. De même peut-on s’interroger sur ce qui paraît être, sinon de la naïveté, du moins une confiance peu critique à l’égard de l’État. Si Pierre Crétois souligne bien le rôle actif que joue ce dernier dans la dynamique néolibérale, il n’en attend pas moins qu’il se ressaisisse du « rôle spécifique qui doit être le sien », consistant à « porter à l’existence des objectifs proprement politiques et [à] prendre en charge les questions collectives d’ordonnancement social à long terme ». N’est-ce pas ce qui, dans une démocratie bien comprise, incombe plutôt au peuple lui-même, lequel ne saurait admettre l’existence d’un État conçu comme appareil séparé ? Reconnaissons cependant qu’il s’agit là de tensions d’autant plus compréhensibles que l’auteur prétend penser de manière réellement critique, mettant en cause les idées dominantes de l’époque à laquelle il appartient, et que ces tensions ne limitent nullement l’importance de la réflexion présentée.












