Un empêchement, premier roman de Jérôme Aumont, est un texte délicat qui confronte trois voix comme étranglées par un amour empêché. Avec justesse, le récit met au jour les failles et les petits arrangements avec la vérité qui structurent le moi sensible de chaque être humain.
Le récit fait se succéder, en trois parties qui portent chacune le nom d’un personnage, les monologues des différents protagonistes. L’intrigue, minimale, nous est révélée d’emblée, on ne trahira donc aucun secret : Mathieu, marié à Marie, tombe amoureux de Xavier qui l’aime en retour. L’idylle n’aura qu’un temps, Xavier trouvant la mort dans un accident de voiture, à l’instar du personnage de Pierre dans Les choses de la vie de Paul Guimard (Denoël, 1973), immortalisé à l’écran par Michel Piccoli. Triangle amoureux et adultérin classique, nonobstant l’homosexualité des deux protagonistes masculins.
La succession de ces trois voix pourrait apparaître comme un dispositif un peu artificiel, mais Jérôme Aumont en joue avec subtilité. Il s’agit moins, en effet, de ménager des révélations que de rendre le caractère nécessaire de cette construction. De fait, toute la narration découle de la disparition de Xavier. Sans cela, on imagine que la vie aurait suivi son cours, dans une situation plus ou moins confortable, plus ou moins douloureuse, certes, mais sans nécessité vitale pour les personnages de s’exprimer, de donner tout à coup de la voix, de crier leur désarroi et de se confronter avec les mensonges dont ils ont drapé leur propre existence. Cette mort soudaine constitue donc le maelstrom rendant possibles ces voix en même temps qu’il menace de les engloutir.
Car ces trois monologues sont tous adressés à un être absent : Mathieu s’adresse à l’amant disparu ; Xavier s’adresse post mortem à Mathieu ; et Marie s’adresse à l’époux perdu. L’empêchement du titre, ce n’est pas seulement l’amour contrarié entre Xavier et Mathieu, c’est aussi l’impossibilité même d’un dialogue, d’un échange. Chaque personnage est condamné à s’exprimer depuis sa solitude. Chaque personnage lance sa voix dans le vide laissé par l’autre, avec un goût de « trop tard désormais ». Il ne s’agit donc de monologues que par la force des choses.
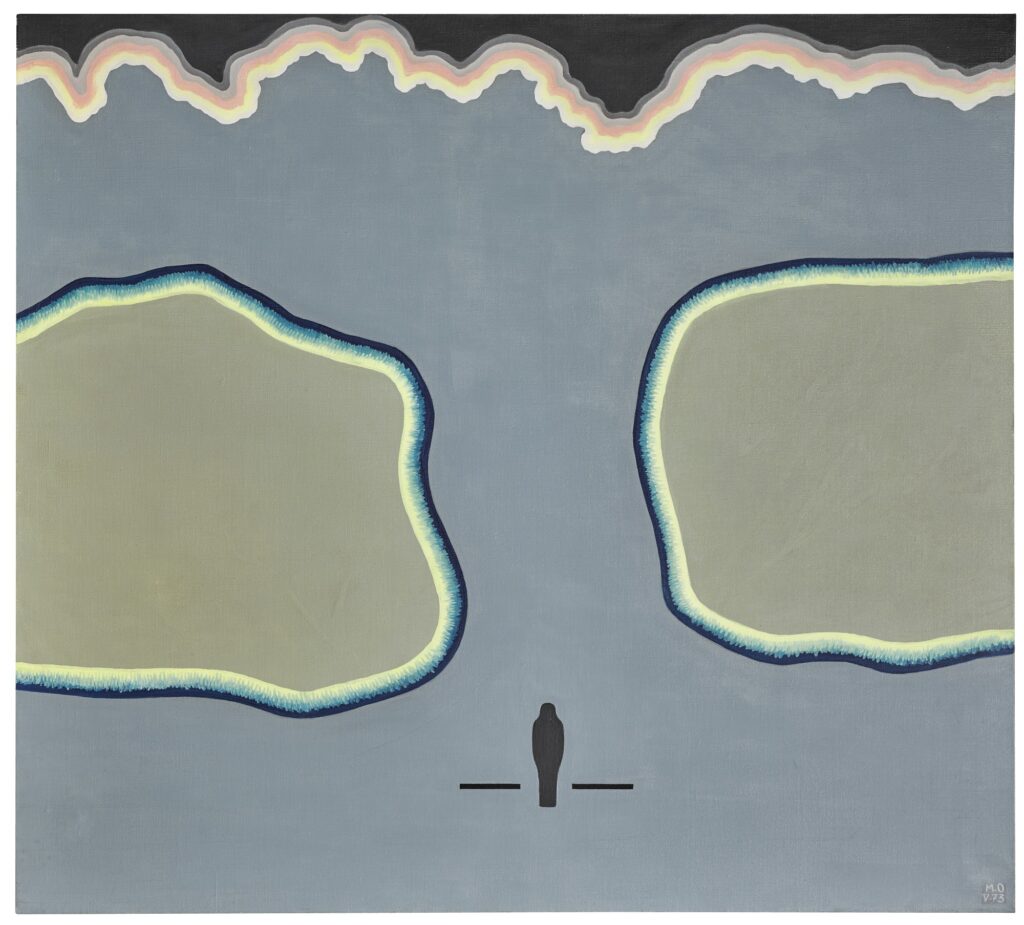
Paradoxalement, c’est dans les pages exprimant le désir et la passion amoureuse que la langue se fige en des formules plus convenues. Mais l’intérêt est ailleurs. Il vient plutôt des marges de cette passion, de ce qui la contraint, la formate, et, tout compte fait, la prédestine à une forme d’échec. À tour de rôle, donc, les protagonistes affrontent les compromissions auxquelles ils ont consenti pour conformer leur être à une image façonnée par les préjugés de leur milieu, de la société. Et le drame seul de la mort de Xavier libère la parole, permet la confrontation avec ce misérable petit tas de secrets dont l’homme est fait et qui est source de tant de souffrances silencieuses : « Plus que tout au monde, s’écrie Mathieu, j’ai besoin de tout affronter : la paternité, la colère, le mensonge. […] Je finis par me soupçonner d’être capable d’ainsi tout enfouir. […] Une pelletée pour Marie, une pelletée pour Jeanne. Une pelletée sur toi ». On ne saurait mieux dire la responsabilité du mensonge social dans la mort de Xavier.
Ce réquisitoire sévère et amer contre l’hypocrisie à laquelle la société a contraint les protagonistes de ce drame ordinaire porte d’autant plus qu’il est partagé par chacune des voix du récit. Les pages où Mathieu, Xavier et Marie tentent de délier les fils du passé qui les ont menés à s’arranger avec la vérité de leur être sensible sont parmi les plus convaincantes. Le poids de leur éducation, du milieu dans lequel ils ont grandi, y est sondé avec beaucoup de justesse, et la responsabilité du patriarcat y apparaît, en fin de compte, accablante. Le portrait de la mère de Xavier en proie à la jalousie violente de son mari et qui, pour se défendre du regard des hommes, s’engraisse littéralement est particulièrement touchant. Réflexe de protection ahurissant qui ne fera qu’attiser les remarques méprisantes du mari et des autres hommes qui auparavant la couvraient de leurs regards concupiscents. Ou encore, dans un tout autre milieu, le portrait de la mère de Marie, « cette mère plus prompte à brûler son torchon par mégarde que son soutien-gorge par rébellion », prisonnière de l’ « ilotisme bourgeois » et qui accompagne le départ de sa fille, rompant avec l’autorité paternelle, « d’un timide sourire ». Reste l’espoir que les générations suivantes sauront se défaire de ce carcan, car, comme le dit Mathieu avec des accents mussétiens : « Cette génération a compris que la vie n’est pas faite pour fleurir les tombes de ceux que l’on a plus ou moins su aimer. »
On aura compris que, comme dans un film de Claude Sautet, il ne se passe pas grand-chose. Mais, comme dans un film de Sautet, on y écoute, avec attention, la petite musique que fait la vie, avec ses contentements éphémères et ses élans contrariés, et cette musique seule, mélancolique à souhait, suffit à maintenir l’intérêt.





![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)






