Dans son petit ouvrage Fondamentaux de la vie sociale (CNRS Éditions, 2019), le grand anthropologue Maurice Godelier concluait, après des décennies de recherches, qu’une question le « préoccupait à présent : Peut-on se moderniser sans s’occidentaliser ? ». Il tente d’y répondre dans Quand l’Occident s’empare du monde.
En réalité, comme il le dit dans son introduction, cette question le préoccupe depuis… 1988 : «c’est au cours de mon dernier séjour chez les Baruya [peuple de Nouvelle-Guinée] qu’est né le projet d’écrire ce livre, de prendre du recul et d’analyser «en grand» les processus qui ont accompagné la mainmise de l’Occident sur le reste du monde, à savoir sa montée en puissance, sa « modernisation » mais aussi la modernisation forcée ou voulue des sociétés non occidentales ».
C’est la réponse d’un jeune Baruya se voulant « moderne » à une question posée par l’anthropologue qui produit ce déclic : « Mais qu’est-ce qu’être moderne ? », lui demande Godelier. «Être moderne, Maurice, c’est simple, c’est suivre Jésus et faire du business ». Et l’auteur de commenter : « faire du business n’était pas pour lui faire du profit mais gagner de l’argent. Il en fallait maintenant pour vivre. Suivre Jésus, c’était faire comme les Blancs, dont le dieu devait être puissant parce qu’ils avaient la puissance et la richesse ». Quand l’Occident s’empare du monde semble poursuivre la conversation avec ce jeune Baruya avec cet « alors » placé dans le sous-titre.
Le livre commence donc par le « retour d’expérience » de l’auteur chez les Baruya, qui est en même temps, comme en passant, un rappel de l’importance du travail de l’anthropologue, «historien des temps présents ». Maurice Godelier passa en tout sept années, entre 1967 et 1988, chez ces indigènes de Nouvelle-Guinée qui n’eurent leurs premiers contacts directs avec les Occidentaux qu’en 1951. En trois décennies, les Baruya se sont « modernisés », mais se sont-ils pour autant occidentalisés ? Ce concept, l’auteur le résume, pour la période contemporaine, autour de « trois axes : l’adoption du capitalisme, la démocratie parlementaire et, via le christianisme, un certain rapport à la religion ». Le chapitre sur les Baruya se clôt par un tableau opposant « ce qui a disparu ou n’existe plus que résiduellement » et les « institutions, pratiques, représentations précoloniales qui continuent d’exister avec un poids et un rôle différent ».

Puis Maurice Godelier s’arrête sur le cas du Japon, qui lui permet, d’entrée de jeu, de souligner les spécificités de chaque pays face à l’Occident mais aussi deux traits que l’Occident retrouvera souvent sur sa route : la modernisation du pays entreprise pour mieux s’opposer à l’Occident et une occidentalisation partielle, limitée par une ligne rouge d’ordre politico-religieux, en l’occurrence le caractère sacré de l’empereur et de la religion shintoïste. Il déroule ensuite les modalités violentes des conquêtes européennes depuis le XVe siècle jusqu’aux dernières colonisations. Les Occidentaux ont voulu imposer leur pouvoir, leur économie, leur culture, au nom de la mission évangélisatrice d’abord, puis au nom de leur « mission civilisatrice ». Le degré d’occidentalisation dépend ici largement du colonisateur. Maurice Godelier différencie les premiers empires ibériques « qui européanisent et occidentalisent les populations colonisées (conquête des esprits et destruction des sociétés) et la pratique coloniale hollandaise qui européanise a minima les populations et les modernise avant tout pour en tirer les richesses ».
De même, nous montre l’auteur, les stratégies des puissances européennes lancées entre le XIXe siècle et le début du XXe dans une concurrence féroce à la colonisation peuvent présenter aussi des différences selon qu’elles éliminent les pouvoirs politiques des pays conquis ou les contraignent à leur obéir, selon qu’elles respectent ou non la religion et les modes de vie locaux, selon qu’elles pillent plus ou moins les richesses, selon l’installation ou non de nombreux colons. Une constante : la violence et les massacres perpétrés contre les populations qui leur résistent. Et les États-Unis ne sont pas en reste, tout comme la Russie tsariste qui constitue un empire continental au mépris des peuples – sans toutefois leur imposer la religion orthodoxe – empire qui est, rappelle Maurice Godelier, bien qu’amoindri, toujours en place.
Mais le cas de la Russie est original : s’étant modernisée et en partie occidentalisée pour s’imposer face aux puissances européennes, elle a tenu à garder un régime autocratique et n’a pas procédé à une réforme agraire de grande ampleur – contrairement au Japon – pour ne pas mécontenter la noblesse et l’Église orthodoxe. Et au XXe siècle, avec la révolution bolchevique, elle a emprunté à l’Europe occidentale une idéologie, le communisme, mais a mis en place un régime totalitaire redoutable.
L’autre cas original est l’Empire ottoman. La nécessité de se moderniser pour résister aux puissances voisines concerne d’abord l’armée puis l’organisation de l’État et l’industrialisation. Avant la Première Guerre mondiale, les résistances à la sécularisation de l’État et de la société restent fortes en cette terre d’Islam. Des résistances que les modernisateurs turcs, pendant et après la guerre, vont vouloir éradiquer. D’abord, ils empruntent à l’Occident le modèle de l’État-nation, poussant le nationalisme à l’extrême, s’engageant dans l’épuration ethnique de l’Anatolie et le génocide des Arméniens. Pour le théoricien de ce génocide, Zia Gökalp, la Turquie devait avoir une population homogène pour devenir une nation moderne. L’État-nation inventé par les Européens peut ainsi monstrueusement dégénérer, et le nazisme ne tardera pas à le montrer.
Maurice Godelier insiste sur la Turquie et l’Iran modernes à plusieurs reprises : ce sont deux cas où des dirigeants, Kemal Atatürk, Reza Pahlavi et son fils, ont pensé que moderniser nécessitait d’occidentaliser et de laïciser la société, sans tenir compte de l’opinion de populations contraintes au silence par une dictature. Le retour de bâton intervient en 1979 en Iran avec l’instauration de la République islamique et en Turquie avec Erdoğan. Ces pays continuent à chercher à se moderniser et à moderniser leur armée mais tirent une ligne rouge d’ordre politico-religieux.
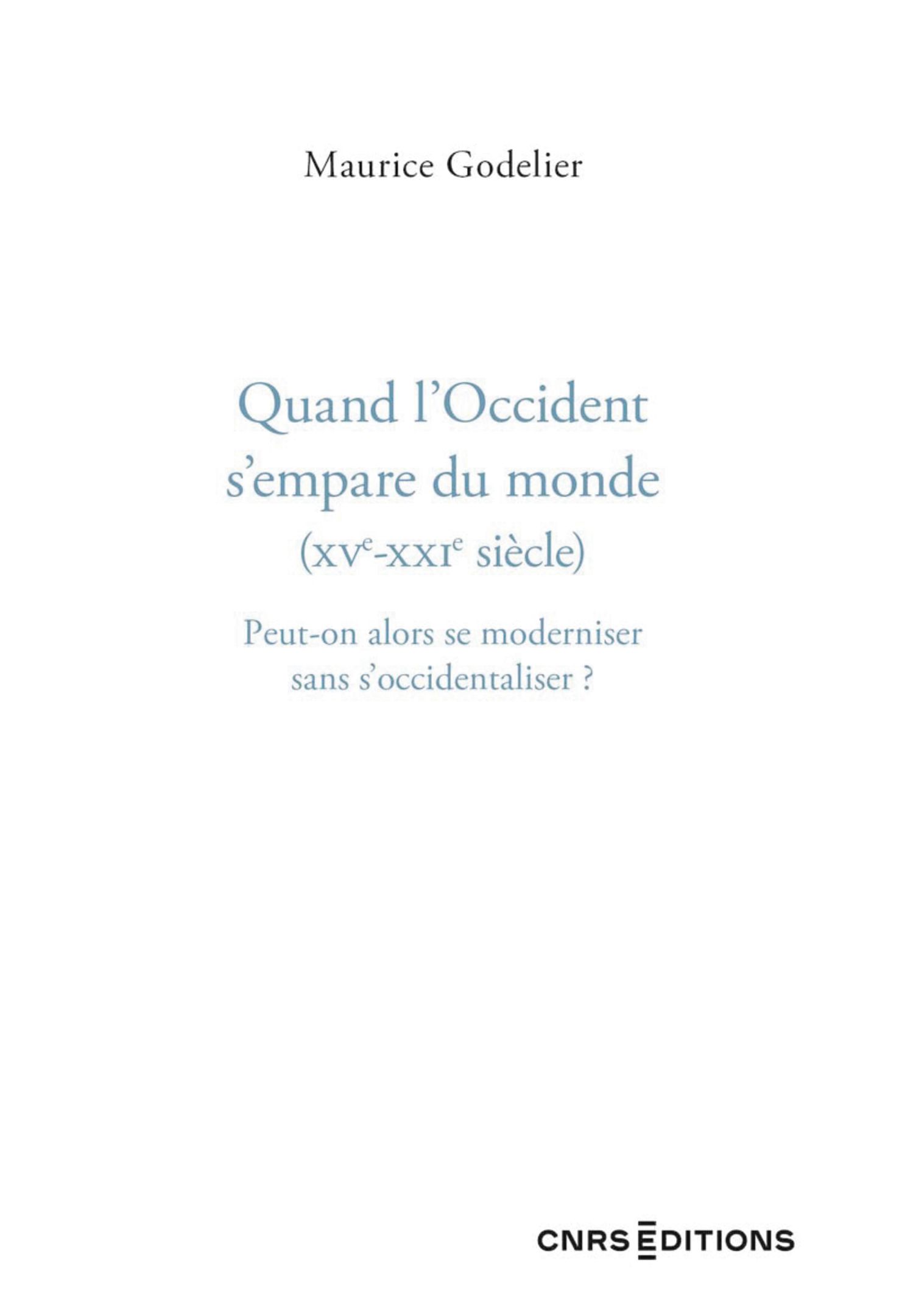
Abordant la fin du XXe siècle et le nôtre, l’auteur s’interroge : «vers un autre monde ? ». L’Occident sort affaibli par les guerres que ses conflits internes ont déclenchées à l’échelle du monde. Le bloc soviétique, renforcé par la révolution communiste chinoise, peut apparaître comme une autre voie possible de modernisation. Mais le « mode de production socialiste » disparaît avec l’ouverture de l’économie chinoise dans les années 1980 et la chute de l’URSS. La Chine, forte de sa main-d’œuvre, a intelligemment ouvert la porte aux investissements mondiaux en imposant des transferts de technologie et est devenue en trois décennies la deuxième puissance capitaliste au monde, sans céder un pouce de terrain politique : le Parti communiste est fermement aux commandes. «Le capitalisme mondialisé est indifférent à la nature des régimes politiques », nous dit Godelier, et l’Occident, États-Unis en tête, voit sa domination battue en brèche, tant sur le plan économique que géopolitique, comme le montre la non-condamnation de l’agression russe contre l’Ukraine par les grands pays du « Sud ».
Des trois traits de l’occidentalisation définis au début de l’ouvrage, seul le capitalisme a triomphé à l’échelle de la planète. Encore faut-il souligner tous les dégâts sociaux, les inégalités et les mécontentements qu’il engendre en Occident même et dans le reste du monde. Encore faut-il souligner aussi que les dégâts environnementaux qu’il a engendrés le remettent en cause. Quant au « politico-religieux », il a fait de la résistance. La démocratie à l’occidentale a échoué à s’exporter. «Le temps serait-il donc venu pour les États hostiles à l’Occident d’entonner un requiem pour l’Occident, et en Occident pour les populistes de célébrer la disparition de la démocratie ? » Maurice Godelier ne le croit pas, malgré les défis.
Sa réflexion, sans que cela soit précisé dans le texte, rejoint des analyses de géopoliticiens comme Bertrand Badie qui souligne l’échec de l’importation d’un État à l’occidentale en Afrique (L’État importé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Fayard, 1992). Elle rejoint le travail d’historiens soucieux d’oser une « histoire globale » ou une «histoire connectée », permettant ainsi de confronter la vision des Occidentaux et celle des peuples qu’ils tendent à dominer (voir en particulier le livre de Jean-Louis Margolin et Claude Markovits, Les Indes et l’Europe. Histoires connectées XVe-XXIe siècles, Gallimard, coll. « Folio », 2015). En soulignant les «lignes rouges » d’ordre politico-religieux que bien des États ont opposées à l’occidentalisation, Maurice Godelier n’en conclut certes pas à des « lignes de fractures » et encore moins à un « choc des civilisations » dans un monde complexe. Même si le présent est gros de conflits, même si les régimes dictatoriaux répriment une jeunesse avide de libertés qu’ils veulent, comme le dit l’auteur, « désoccidentoxiquer », le plus grand danger qui menace l’Occident réside, selon lui, dans ses propres démons, dont Trump et les suprémacistes blancs sont les tristes hérauts.
Gérard Vindt, agrégé et docteur en histoire, est responsable de la rubrique « Histoire » du magazine Alternatives économiques.












