La traduction de la poésie palestinienne est en pleine expansion. En France, le poète marocain Abdellatif Laâbi poursuit son travail de passeur. Traducteur de Mahmoud Darwich, Samih al-Qassim et Ashraf Fayad, auteur de trois remarquables anthologies, dont la dernière en 2022, il revient avec la traduction d’une sélection de poèmes de Najwan Darwish, l’un des poètes palestiniens les plus remarqués de la nouvelle génération.
Issus de cinq recueils publiés initialement entre 2018 et 2021, les poèmes de Darwish — simple homonyme de Mahmoud Darwish — donnent à lire une voix singulière et un univers poétique qui ne laissent pas indifférent. Né à Jérusalem en 1978, il est journaliste, critique et rédacteur en chef de la rubrique culturelle du journal Al-Arabi al-jadid (Le Nouvel Arabe) basé à Londres. Saluée par la critique internationale, son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues. Sa traduction en anglais par l’éditeur égypto-américain Kareem James Abu-Zeid a eu d’excellents échos aux États-Unis.
Anxieuse et tourmentée, la poésie de Darwish est dominée par le questionnement. Le recueil s’ouvre sur un « chant nocturne » où le poète interroge d’emblée son appartenance et ses douleurs : « Pourquoi dois-je appartenir à une nation / qui, quand elle s’enivre / se précipite vers l’embouchure des larmes ? » Cette question résonne tout au long du recueil, invitant le lecteur à méditer la question palestinienne à partir d’interrogations souvent sans réponse.

Dans son introduction, Laâbi écrit que la poésie de Darwish s’apparente à de « l’art brut, grinçant, répudiant tout maniérisme ». Comme le suggère le titre du recueil, la Palestine est à la fois rapprochée et dissociée de l’image d’une Andalousie perdue, dont la perte se répète à l’infini :
Mon pays est une Andalousie de poésie et d’eau
Je l’ai perdue
et continue de la perdre
C’est de sa perte
qu’elle devient mon pays
La Palestine de Darwish est avant tout une absence, un mirage qui conduit le poète dans une impasse absolue : « C’est un pays emporté par les pluies / qui m’a laissé sans possibilité / de le perdre ou de le retrouver ». Ou encore :
Je n’ai pas de pays pour en être exilé
Je n’ai pas de pays pour pouvoir y retourner
Et si je m’arrêtais dans un pays
je mourrais
Comment sortir de l’impasse ? Darwish ne donne pas de réponse définitive mais la force de sa poésie est d’envisager l’impossible, de tordre le cou au destin, de sortir de la fatalité en renouvelant sans cesse la résilience et l’attachement à la terre natale : « S’il m’était destiné de revenir / je ne reviendrais pas sous un autre drapeau / Je t’enlacerais avec mes deux mains coupées ». Dans un renversement de perspectives particulièrement expressif, ce n’est plus le poète qui cherche son pays mais le pays lui-même qui est sommé de partager la quête et l’angoisse du poète : « Et ce sera ton tour / d’aller à ma recherche / souffrant le martyre / la peur au ventre ».
À y voir de près, la poésie de Darwish est le lieu d’une tension permanente entre l’envers et l’endroit. Les contraires ne sont plus opposés mais pris dans une dualité qui renforce le sentiment d’une situation sans issue : « L’espoir / rehaussé de désespoir / Le désespoir / distillé par l’espoir ». Comme toute poésie palestinienne, celle de Darwish regorge de paradoxes et de contradictions, autant de références au destin complexe et accidenté de l’être palestinien : « J’ai une mer et une montagne / et ceux que j’aime vivent en exil ». Cela n’empêche pas la lucidité, souvent concentrée dans une métaphore en apparence simple mais tellement évocatrice : « Les sièges de l’espoir / sont toujours réservés ».

Ce mélange de réalisme intense et de fantaisie troublante se traduit dans le traitement de la mort. Ici, pas d’apitoiements ni de misérabilisme mais plutôt une succession d’images saisissantes, parfois insolites : une dépouille sans linceul « d’où suinte l’univers », des crucifiés qui demandent à pouvoir se reposer, des rêves qui mènent « par erreur » au paradis. Là encore, une métaphore suffit à apprivoiser le drame, à détacher la douleur des corps et des esprits : « La mort n’est qu’une servante chargée de ramasser les verres et de laver les draps ». Le poète pousse l’ironie jusqu’à imaginer sa propre mort, envisageant l’âge éventuel de sa disparition et anticipant la réception de son œuvre par les générations futures. La mort du poète n’est ni une tragédie ni une limite mais l’occasion de clamer son identité collective : « N’importe quelle femme / qui ressentirait de la peine ce soir-là / pourrait être ma veuve ».
D’un poème à l’autre, Darwish oppose à la solitude du poète un sens de la communauté et de l’attachement à toute épreuve :
Je ne prétends pas avoir d’autres proches
que ceux que j’ai perdus dans les guerres
les exils
les paradis promis ou en enfer
L’existence du poète, l’existence tout court, est radicalement liée à celle de son peuple, sans cesse interpellé et pris à témoin : « Si toi tu n’existes pas / qui pourrait prétendre à l’existence ? » Oscillant entre le je et le nous, la poésie de Darwish cherche de manière délicate à saisir l’écart entre les générations, à se frayer un chemin entre « une obscurité sans fin » et « une aube qui ne vient pas ». Pour les Palestiniens, nous dit Darwish, chaque naissance porte les prémices d’une chute inéluctable : « Au fond, nous sommes venus au monde / pour nous effondrer ».
Mais comment se relever ? Là encore, pas de réponse définitive mais le poète n’hésite pas à interroger ses silences, à fustiger ces amis « fidèles et intimes » devenus des « voyous » ou ces politiciens d’un autre âge qui « se sont lavé les mains de la réalité ». C’est qu’il y a dans la poésie de Darwish une forme d’aplomb teinté d’amertume, une manière désarmante et raffinée de contenir la douleur. À ce monde qui parle de la Palestine sans vraiment la connaître, il rétorque : « Tu ne pourras pas dire sur mon peuple / quelque chose qui m’aura échappé ». L’amour du poète pour son peuple a beau le conduire vers « l’abîme », les poèmes sont là « pour instaurer l’oubli » et relancer la quête.
Pour étendre son espace poétique, Darwish rend hommage à des compatriotes comme le grand écrivain Jabra Ibrahim Jabra, auteur de ce roman fondateur de la littérature palestinienne et arabe qu’est À la recherche de Walid Masud (traduit par France M. Douvier, JC Lattès, 1988), et l’incontournable caricaturiste Naji al-Ali, créateur du personnage de Handala, icône de l’indignation palestinienne. Mais il rend aussi hommage à d’autres figures telles que la diva égyptienne Oum Kalthoum et le poète français Bernard Mazo. Quand un poème évoque un Martiniquais et un visage qui, à force d’être caché, « s’est transformé en masque », le lecteur pense immédiatement à Fanon, comme une subtile invitation à penser les effets de la colonisation à partir de l’auteur des Damnés de la terre.
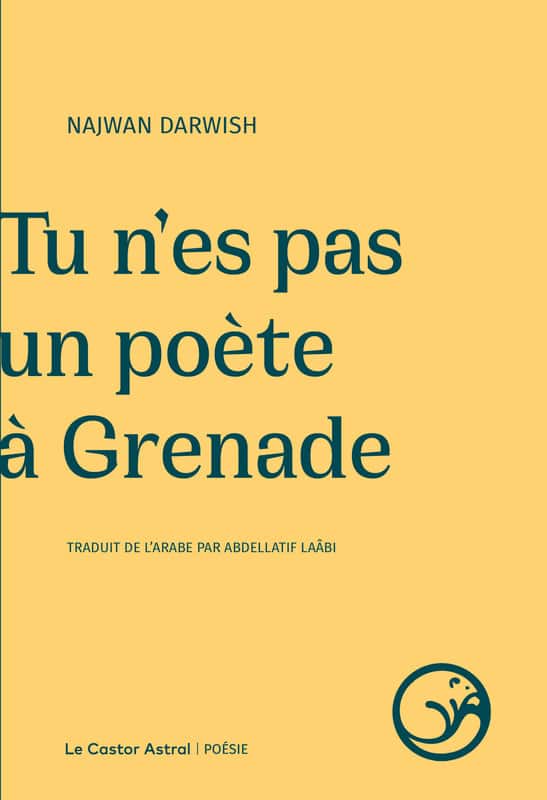
À bien des égards, la poésie de Darwish est ce miroir intransigeant dans lequel le poète passe en revue ses faiblesses et ses incertitudes, mais aussi la transformation de son être au contact de la violence. Dans le poème « Phobies », par exemple, le poète énumère les peurs qui le hantent et trouve refuge dans un humour cynique et grinçant : « Ils vont m’expulser de l’existence / car j’ai un faible pour le néant ». Dès lors, il s’agit de faire du poème un espace de révolte contre les pseudo-vérités du moment, contre le poids insoutenable des injonctions et des slogans. Comme un symbole, une notion aussi précieuse que la liberté est réduite à « une statue d’argile / se craquelant sous le soleil du littoral ». Porté par un rythme saccadé, le poème « Factices » est une dénonciation radicale et cinglante d’un monde où rien ne semble vrai, sinon la réalité de l’oppression et les tentatives d’étouffer la cause d’un peuple : « Si tu veux vivre, tu dois te salir. En voilà une autre théorie factice ».
Pour Darwish, le poète palestinien est cette « pierre de touche » négligée par les maçons dans une construction en ruines. Il est l’être sacrifié, « toujours prêt à verser [son] sang pour la moindre futilité ». Narguant « le cortège funèbre / du capitalisme palpitant », la poésie de Darwish s’obstine à chanter la brise qui souffle sur une montagne, le rêve incertain d’une petite maison et la fin d’un amour qui renait avec un autre. Dans « Poème fortuit à cause d’une femme », Darwish martèle ce qu’il doit aux femmes qu’il a aimées, à celles qui ont inspiré ses paroles et donné sens à sa vie, avant de conclure de manière caustique : « Dommage, vraiment / que ce soient les hommes qui m’enterreront ».
Tantôt mélancolique et légère, tantôt défiante et acerbe, la poésie de Darwish refuse les assignations et l’abandon : « se tenir debout / sur les premières marches de la poésie », voilà tout ce qui compte, car la poésie est à la fois le cimetière et la mémoire, la terre volée et l’horizon retrouvé, la parole confisquée et le silence éloquent. Dans le poème intitulé « La mère de Charles », Darwish imagine ce dialogue improbable entre sa mère et celle de Baudelaire :
Tu as vu ce que la poésie
a fait de nos enfants ?
Najwan était adorable quand il était petit
Mais la mère de Charles reste silencieuse
comme la dernière épine
dans le jardin du mal
Cet article a été publié par notre partenaire Mediapart.











