L’esclavage est censé ne plus exister nulle part : tous les États membres de l’ONU s’y sont déclarés hostiles. Et pourtant on voit bien que certaines situations que nous admettons volontiers ne sont pas très différentes de ce qu’a pu être l’esclavage du temps où il était un statut juridique admis. Pour le penser, il faut donc résister à la tentation de projeter le présent sur le passé ou le passé sur le présent, comme l’entreprend l’historien Paulin Ismard dans Le miroir d’Œdipe.
L’évidence actuelle, quand est prononcé le mot esclavage, est de penser à la traite négrière des XVIIe et XVIIIe siècles, au commerce triangulaire avec ces centaines d’Africains entassés dans les cales d’immondes navires où beaucoup mouraient avant d’avoir vu les îles caraïbes. Nous ne pensons pas aux bateaux en plastique dont tant de passagers se noient avant d’avoir atteint les côtes européennes. Cela n’a rien à voir, nous semble-t-il, puisque ces migrants étaient libres de s’embarquer sur ces bateaux d’infortune. Nous préférons ne pas nous demander ce que vaut cette liberté supposée et nous dire que les femmes noires qui emmènent les enfants blonds des beaux quartiers glisser sur les toboggans des jardins publics, que ces femmes ne sont pas esclaves puisque, venues spontanément chez nous, elles sont munies de titres de séjour réguliers et convenablement payées par des employeurs qui ne se perçoivent pas comme des maîtres.
D’un autre côté, nous sommes bien conscients aussi que les formes modernes d’exploitation de migrants démunis ne peuvent être entièrement assimilées à de l’esclavage. Les différences ne sont pas négligeables, à commencer par la violence que s’autorisaient les gros propriétaires et qui pouvait aller jusqu’à un droit de vie et de mort comparable à celui que nous avons sur nos animaux de compagnie – sans parler du viol ordinaire qui, pour n’avoir pas été une négation de l’humanité des prisonnières, n’en était peut-être que plus odieux.
Des mots de cette sorte emportent tout un imaginaire qu’il est très difficile de surmonter. À nos yeux, l’esclavage, c’est la traite négrière entre l’Afrique et l’Amérique, et nous ne pouvons pas lire sans rage les explications que dans les années 1780 les défenseurs de l’esclavage opposaient à la Société des amis des Noirs de Condorcet et Grégoire. C’était, bien sûr, l’argument de la concurrence économique : supprimer l’esclavage dans les îles caraïbes ruinerait nos planteurs confrontés à la concurrence anglaise.

L’esclavage, ce fut aussi l’ordinaire de la plupart des sociétés antiques, ce à quoi l’Église n’a rien trouvé à redire même si elle a proclamé par la voix de Paul : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car tous vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ » (Galates, 3, 28). Les évêques possédaient les esclaves que leur position sociale justifiait. Mais de quoi s’agissait-il sous ce nom ? Le mot grec est souvent oikétes, l’exact équivalent de notre domestique et nous pouvons penser aux valets de nos comédies – qui n’étaient pas toujours dûment payés : Dom Juan mort, Sganarelle n’aura pas ses gages. Nous pouvons aussi penser aux milliers d’esclaves crucifiés par Crassus après sa victoire sur Spartacus. Est-il justifié d’employer le même mot pour désigner les domestiques des citoyens d’Athènes et les hilotes de Sparte ou les dizaines de milliers d’hommes et de femmes que possédaient les richissimes Romains du temps de Spartacus ? Les Grecs ne le faisaient pas mais Paulin Ismard le fait, dans l’idée de penser ainsi l’essence de cette réalité globale nommée « l’esclavage ».
Dans le passage du Théétète où Socrate raconte l’anecdote de Thalès tombé dans le puits à force de regarder les étoiles, celle qui se moque du philosophe perdu dans les nuées est qualifiée de « jolie et charmante soubrette ». On peut certes supposer qu’elle a statut d’esclave mais ce n’est pas là-dessus qu’insiste Platon. Quand Hérodote (VI, 137) parle d’un temps où les Grecs n’avaient pas encore de « domestiques », on ne peut affirmer que « le mot oiketai ne peut se traduire que par esclave ». Là encore, c’est faire dire au texte autre chose que ce qu’il dit. Il n’est pas négligeable que les Grecs n’aient pas systématiquement mis en avant le statut juridique d’esclave de tel ou tel. On peut juger qu’il s’agit là d’un impensé, d’une dénégation ou d’une euphémisation – mais c’est justement celle-ci qu’il s’agirait de penser, ne serait-ce que pour s’interroger sur notre façon de concevoir la situation de personnes qui vivent chez nous dans des conditions auxquelles n’aurait pas eu grand-chose à envier la soubrette thrace qui se moque de Thalès. Mais il est plus rassurant d’éloigner de nous la réalité de l’esclavage en se polarisant sur la mémoire de la traite négrière. Quitte à oublier l’importance des esclaves d’État pour l’Athènes classique tout comme le statut servile des directeurs d’administration centrale sous l’Empire romain.
En s’appuyant sur l’Ajax de Sophocle, Paulin Ismard s’attarde à juste titre sur l’étrange statut des enfants de concubines serviles. La difficulté de leur statut tient au fait qu’il peut s’agir de princesses réduites en esclavage parce que faites prisonnières à la suite d’une défaite militaire. Tecmesse est née libre d’un père libre et riche mais elle est réduite en esclavage. Elle est cependant l’épouse d’un roi, en la personne d’Ajax. Néanmoins, ses enfants ont beau être d’un tel père, ils sont surtout fils d’une telle mère et n’auront donc pas droit à la citoyenneté après la mort de leur père ; ils seront ramenés au statut d’esclaves. Il est vraisemblable qu’en composant cette tragédie Sophocle ait eu à l’esprit la loi (attribuée à Périclès) qui « exclut de la citoyenneté quiconque ne serait pas né de deux citoyens ». Être esclave est donc un statut juridique, sans rapport constant avec la condition sociale. Dans la réalité de leur existence, Andromaque, la soubrette thrace et Spartacus n’ont à peu près rien en commun, hormis ce statut qui n’a pas le même sens pour eux.
Dans la Chine du XXIe siècle, citadins et ruraux n’ont pas le même statut juridique, un peu comme les serfs et les bourgeois de notre Moyen Âge. Jusqu’à quel point peut-on comparer ces situations ? Aux États-Unis, l’obsession d‘établir des classifications raciales conduit à considérer qu’est noire toute personne dont un ancêtre du XVIIIe ou du XIXe siècle aurait été « de couleur ». On ne dit pas « noire » mais « afro-américaine ». Cette formule « politiquement correcte » révèle que l’enjeu n’est pas la couleur de la peau, qui peut être aussi blanche qu’on voudra, mais l’éventuelle origine servile. Qu’un ancêtre sur seize, trente-deux ou soixante-quatre ait été esclave constituerait une tache indélébile. On retrouve là quelque chose qui rappelle l’affaire d’Ajax et de Tecmesse.
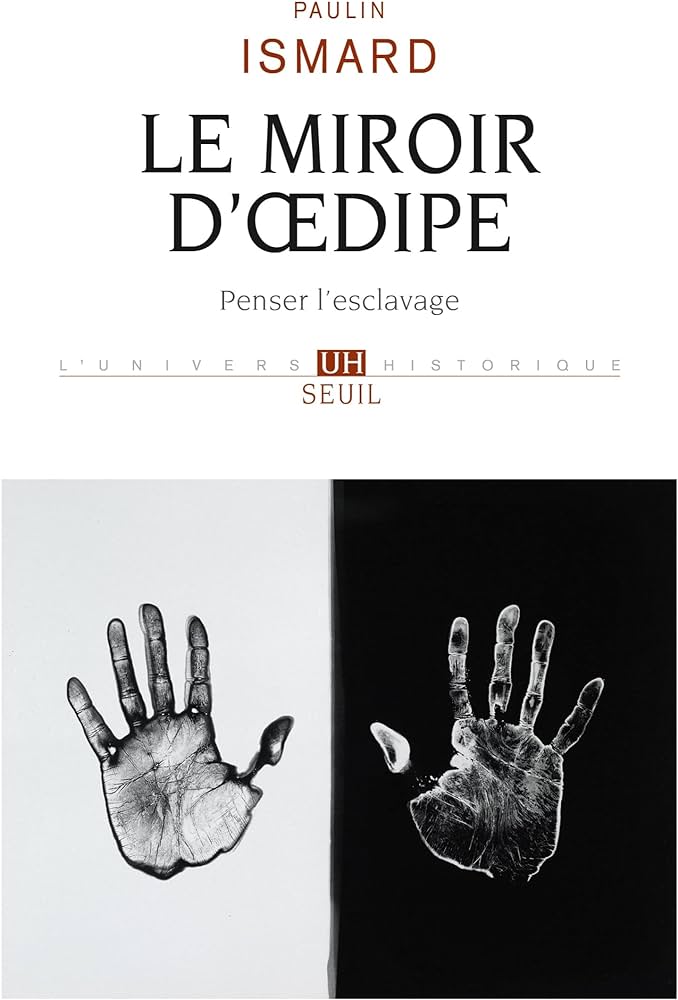
Conséquence de la traite négrière, cette association entre esclavage et racisme n’existait pas pour les Grecs anciens. Non qu’ils fussent moins racistes que d’autres peuples – même s’ils avaient moins d’occasions de l’être – mais parce que n’importe qui pouvait être réduit en esclavage, et plutôt des riches cultivés que des pauvres incultes : ceux qui se retrouvent prisonniers de guerre ou qui sont pris en otage par des bandits de grand chemin. Platon lui-même a été vendu comme esclave. Mieux vaut s’acheter quelqu’un d’apte à faire les comptes plutôt qu’un individu tout juste capable de balayer la cour. Cela a plus de valeur sur le marché, à l’achat comme à la revente.
En 2021, Paulin Ismard codirigeait un volumineux travail collectif consacré aux mondes de l’esclavage. Même si l’on peut lui reprocher d’essentialiser « l’esclavage », son livre est loin d’être dénué d’intérêt. Un chapitre particulièrement inattendu explore la manière dont des esclaves ont inventé le théâtre documentaire : leurs spectacles de mime pouvaient avoir une force émancipatrice comparable au théâtre de Piscator dans l’Allemagne de 1925. Il reprend ainsi à son compte l’hypothèse de Jean-Pierre Vernant selon laquelle le thème philosophique de la mimèsis pourrait dériver du genre théâtral du mimos. Il est aussi très stimulant de penser l’esclave comme vivant dans une sorte de mort.
Un des aspects les plus intéressants de ce livre se résume dans la formule « la politique fait de l’esclavage son refoulé », qui complète cette évidence banale pour les Grecs eux-mêmes : on ne peut pratiquer la démocratie ni mener une réflexion philosophique si l’on doit travailler. Il faut donc que d’autres travaillent. Mais sont-ils forcément de condition servile ? Voir la liberté dans le miroir de l’esclavage ou considérer que la philosophie s’efforce de le conjurer, c’est encore essentialiser « l’esclavage ». Mais il est incontestable que cela pose un des problèmes les plus troublants de la pensée politique : le fait que l’on ait pu accepter l’existence d’un statut servile alors même que l’on proclamait l’égalité des citoyens. La question se pose aussi à propos du rejet des femmes hors du champ politique, rejet qui paraissait aller de soi pour les plus avancés des républicains, les plus favorables à un scrutin universel – sans les femmes. Celles-ci étaient-elles esclaves ? Domestiques comme Bécassine ?












