Dans Ouragans tropicaux, Mario Conde, le héros de Leonardo Padura, revient pour la dixième fois enquêter sur quelques meurtres et poursuivre son évocation de l’histoire et de la société cubaines tandis qu’en Grèce le commissaire Charitos de Petros Markaris remplit pour la treizième fois à peu près la même fonction dans Le crime, c’est l’argent. Loin de l’Europe, le détective tokyoïte Totsomu Godai, de Keigo Higashino, offre, lui, un aperçu du système policier et judiciaire japonais dans Le cygne et la chauve-souris. Enfin, Harry Bosch, agent du bien de Michael Connelly, part pour la vingt-septième fois régler son compte aux méchants de Los Angeles dans L’étoile du désert.
Ouragans tropicaux de Padura s’intéresse à plusieurs périodes historiques : le début du XXe siècle avec le meurtre en 1910 d’Alberto Yarini, célèbre proxénète assassiné par un concurrent, le présent de 2016 quand la visite d’Obama et un concert des Rolling Stones suscitèrent d’illusoires espoirs, ainsi que les années 1960 pendant lesquelles sévit une répression particulièrement forte contre les artistes et les écrivains. Ce dernier moment occupe le devant de la scène puisqu’un des hauts responsables de ces persécutions, maintenant fort âgé, est tué et que Conde accepte d’apporter son aide à la recherche du coupable, tâche complexe car les suspects sont légion.
Le roman ressemble aux précédents, pour la « cubanité » qui s’y déploie, le caractère de Conde, le positionnement nostalgique. Il ravira les amateurs de Padura, mais les autres renâcleront un peu devant les longueurs, l’ambiance et la psychologie carton pâte, le nombre des stéréotypes. Quant à la rhétorique du désastre et de la désillusion, elle a sans doute ses séductions, mais la vieille solution sentimentale masculine de Conde/Padura à la noirceur du monde (les vieux copains, l’alcool, la bonne bouffe…) ne parvient pas ici à avoir beaucoup de charme.

Le commissaire Charitos de Petros Markaris dans Le crime, c’est l’argent parvient aisément, quant à lui, à convaincre que la famille, les amis, la cuisine faite maison et la sympathie politique bien placée sont les fondements du bonheur. L’auteur, qui poursuit ainsi son aimable sitcom « engagée » athénienne, continue donc à faire du crime le prétexte d’une analyse de la situation actuelle de la Grèce. Le livre, situé en 2019, s’ouvre sur un enterrement symbolique de la gauche, « morte suicidée », qu’organise un vieil ami du commissaire, l’ex-communiste Lambros Zissis, et sur la création par lui du « mouvement des pauvres ». Autant dire que Le crime, c’est l’argent met au premier plan, et comme toujours sans pesanteur, crise économique, immigration, appauvrissement des classes moyennes, affairisme… Mais, tandis que tout le monde discute, que Lambros prépare des manifestations, se produisent coup sur coup les assassinats de deux investisseurs étrangers. Inquiétude et mécontentement dans les milieux politiques et financiers ! Charitos doit « faire avec » la pression venue d’en haut et la gestion des rassemblements organisés par son vieux copain auxquels son épouse, sa fille et son petit-fils (le bébé Lambros, en poussette) participent parfois, le mettant, lui fonctionnaire de police, dans une situation délicate.
Le crime, c’est l’argent, dernier conte familial, amical et policier de Markaris, est politique et sympathique en diable.
Keigo Higashino n’a, lui, aucune prétention à l’humour et au commentaire politique, mais, comme Markaris, un certain goût pour la gastronomie. Comme il le fait en général dans ses romans, il prend au sérieux dans son dernier livre, Le cygne et la chauve-souris, l’énigme policière et la procédure judiciaire. Tutsamu Godai, détective aux Affaires criminelles de Tokyo, enquête sur l’assassinat d’un avocat très connu dont tout le monde s’accorde à reconnaitre l’impeccable moralité. Un retraité avoue le crime ainsi qu’un autre commis trente ans auparavant (et donc prescrit). Mais rien ne vient corroborer ses aveux. L’enquête passe alors, d’une certaine manière, dans les mains de la fille de l’homme assassiné et du fils du présumé assassin qui vont s’efforcer ensemble de comprendre ce qui s’est passé.
Le livre apprend de curieux aspects de la procédure judiciaire japonaise dans le déroulement de laquelle les familles de la victime comme de l’accusé sont étroitement impliquées. Les notions d’honneur et de respectabilité occupent ici une place centrale complexe : la vision du crime, l’ostracisme généralisé qui punit les familles des « coupables » et bouleverse leur fonctionnement, les images de soi, apparaissent ici comme appartenant à un système anthropologique et rhétorique différent du nôtre.
Le cygne et la chauve souris est un peu lent, fort policé, et, sans être le meilleur des Higashino, déconcerte agréablement.
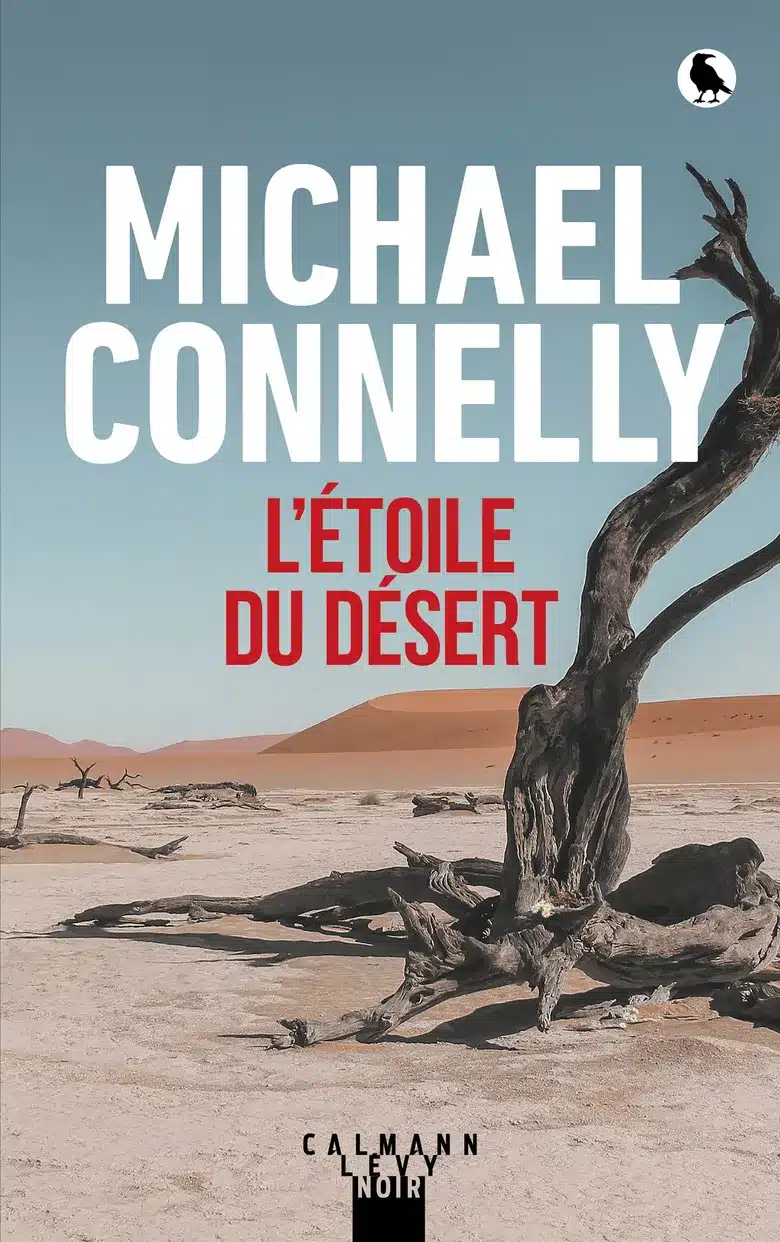
Pas de bons petits plats ni de psychologie familiale ni d’étude sociale chez Michael Connelly car on est dans ces bons vieux États-Unis peu gastronomes, méfiants devant l’introspection et pétris de certitudes en matière de gestion du pays : pour l’auteur, le mal n’étant pas social mais individuel, il suffit (presque) pour que règnent paix et concorde de se montrer gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Dans L’étoile du désert, Harry Bosch, une fois de plus, bien que retraité, s’en charge, et, malgré la simplicité idéologique, nul ne s’en plaindra.
Ici, il quitte sa retraite pour devenir le subordonné de son ancienne coéquipière de la police de Los Angeles, Renée Ballard. Celle-ci a été autorisée à recréer une unité des affaires non résolues avec des contractuels et des bénévoles. Elle doit d’abord résoudre le mystère entourant l’assassinat vieux de trente ans de la sœur d’un conseiller municipal, car c’est lui qui a débloqué les maigres fonds pour le service et c’est donc de lui que dépend sa longévité. Harry Bosch, peu soucieux de se plier aux desiderata très personnels d’un élu, souhaite avant tout résoudre le meurtre d’une famille entière, retrouvée enterrée quelques décennies plus tôt dans le Mojave Desert, et dont le meurtrier a échappé à toutes ses investigations.
Le livre n’est pas du « grand » Connelly, mais il est vif, prenant, et les clichés habituels s’oublient devant le talent principal de l’auteur : une excellente maîtrise des situations, des enchaînements et du suspense. Bref, fan de Harry Bosch ou pas, il n’y a aucune raison de ne pas se laisser guider par le bout du nez par cette Étoile du désert.
Le choix policier est donc ici entre La Havane, Athènes, Tokyo et Los Angeles, et des imaginaires policiers plus ou moins tranquilles.












