Publiés à quatre ans d’intervalle, au milieu et à la fin de la décennie d’austérité que vient de traverser la Grèce, deux romans grecs dépeignent, chacun avec son ton et son genre d’écriture propre, une situation de désastre et d’asphyxie, tant dans la capitale que dans les campagnes, sur les esprits et les corps. Leurs personnages – métaphores d’une génération perdue, en sursis dans son propre pays – résistent à l’ordre des choses, par l’action chez Mihalis Makropoulos et par la pensée chez Christos Armando Gezos. Le premier est une fable sur la destruction du lien social, l’autre impose une langue du désespoir.

En 2014, paraissait en Grèce l’emblématique roman de Christos Oikonomou Le salut viendra de la mer (traduit par Michel Volkovitch, Quidam, 2017), dans lequel des personnages fuyaient dans les îles la misère et l’oppression des grandes villes de la crise. Eau noire, écrit avec Stalker de Tarkovski en tête, imagine le trajet inverse : la désertion forcée des campagnes grecques. Malgré l’empoisonnement meurtrier de leurs terres natales en Épire, un quinquagénaire et son fils Christophoros refusent de quitter leur village moribond et d’être relogés dans des complexes urbains. Comme souvent dans les dystopies, la nouvelle génération incarne la maladie de la Terre : Christophoros, la vingtaine, est né avec un handicap qui l’empêche de marcher. Au début de la novella, les douze habitants restants survivent grâce à des allocations, bientôt supprimées par le gouvernement qui a rendu leur monde inhabitable. Au fur et à mesure des départs, le père se sert dans les maisons abandonnées, et s’arme.
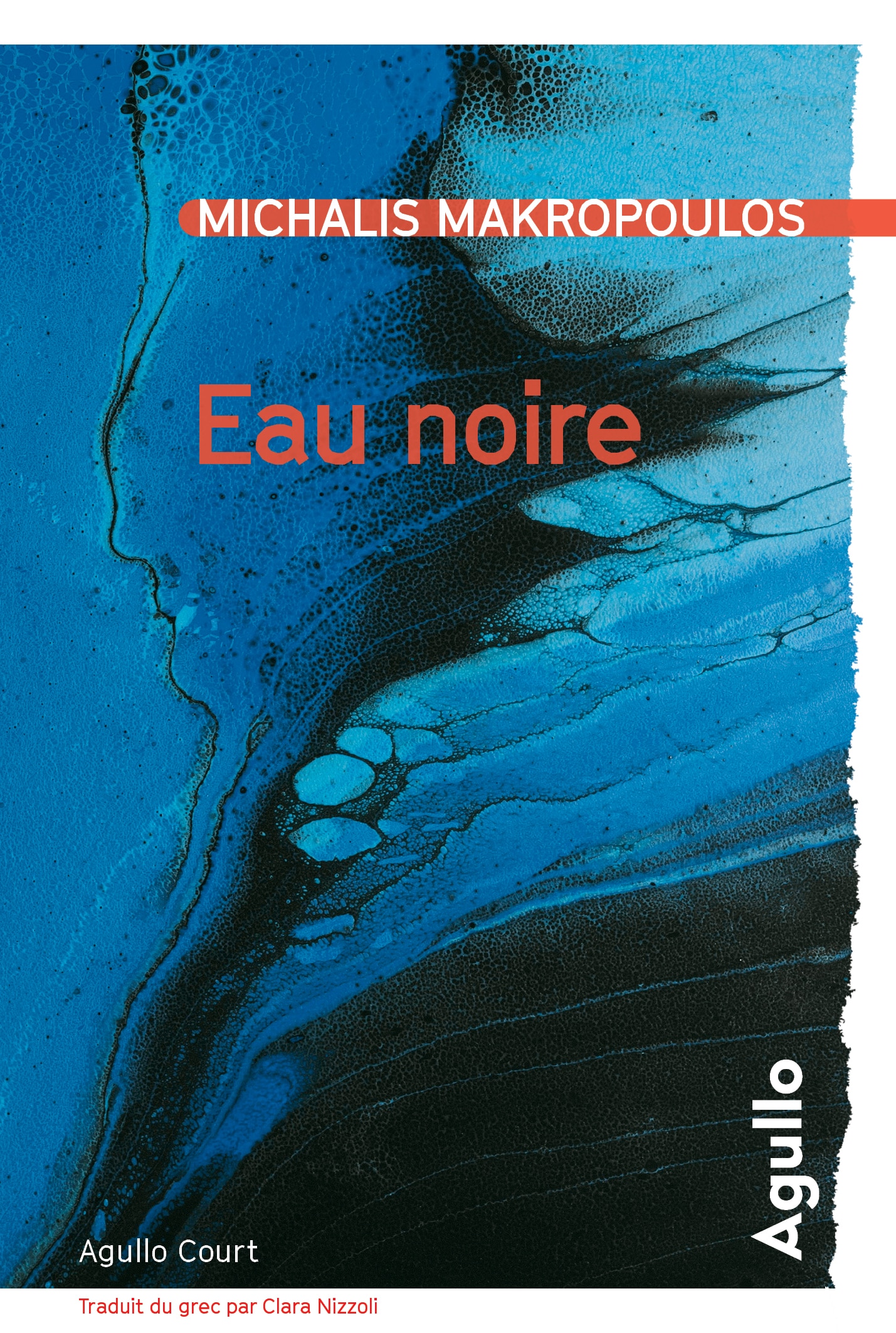
Avec une parfaite économie de moyens, cette fable politique restitue froidement la dislocation accélérée d’une communauté : « De fait, il n’y avait plus de village : seulement des gens oubliés. » Au milieu de paysages balafrés par des années de forage, le père est hanté par le souvenir de ce qui fut. Certains lieux sont particulièrement chargés de passé, comme le lac avoisinant : « Dans le temps, il avait la propreté et la polissure du verre, mais maintenant il jetait un regard vitreux, aveugle, au ciel bas » et les nombreuses chapelles, toutes abandonnées, qu’il visite régulièrement avec son fils. Ces dernières scènes surtout, aussi dramatiques que pudiques dans leur reconstitution d’une tradition orthodoxe, font penser à une nouvelle du fondateur des lettres néo-helléniques au tournant du XXe siècle, Alexandros Papadiamantis, qui aurait été écrite de nos jours. Isolés, les deux personnages survivent parmi les fantômes du village.
Là où Makropoulos use d’une prose austère pour faire entrer le silence d’un environnement torturé, La boue de Gezos s’apparente à un magma verbal en mouvement perpétuel. Sa mince intrigue est contenue dans la première et tortueuse phrase, longue d’une dizaine de lignes – le reste n’est que ressassement. Alexandros, le narrateur, va avoir vingt-huit ans. Après une année hors de Grèce, il est de retour à Athènes. Il avait fui, pensant avoir tué son père – ce n’est pas le cas. Il revient pour se rendre ou se suicider – il n’en fera rien. Hébété par une rage qui ne trouve pas de débouché, toute possibilité d’action anéantie par la puissance même du monologue intérieur, il erre dans la ville avec un pistolet puis revoit son ancien appartement, sa petite amie, sa sœur et, peut-être (le livre se clôt alors), sa mère. On ne peut s’empêcher d’y lire une parodie sombre du retour d’Ulysse, un Ulysse sans Ithaque certaine.
Alexandros, tout comme l’auteur, est né dans une famille grecque du nord de l’Épire, en Albanie. Comme tant d’autres dans les années 1990, il a passé la frontière enfant, en Grec autant qu’en étranger. Au fil de ses pensées et de ses souvenirs pêle-mêle, sa géographie mentale se dessine : Athènes se trouve entre le village albanais où le narrateur est né, Drepeni, et le village grec où il a grandi, Methenia – deux noms inventés. L’écriture de Gezos, haletante, se veut instable, comme refusant de s’ancrer dans l’un de ces lieux. Dans son style même, il vient troubler l’identité nationale depuis la littérature, mêlant citations de poètes grecs du XXe siècle, références à Mishima, Dostoïevski, Salinger, et termes dialectaux gréco-albanais. Ces influences tiraillent et débordent le narrateur mais l’écrivain les maîtrise au sein d’une langue faite d’embranchements, de courants parallèles, qui sans arrêt est sur le point de rompre pour dire la dislocation de cet homme. On songe au Bavard de Louis-René des Forêts – comme chez lui, la langue de Gezos « se résout en retournant ses armes contre elle-même », pour citer Pascal Quignard. Régulièrement, le narrateur se transforme en vain pamphlétaire, ne s’adressant qu’à lui-même, ici sur ce qui serait un aspect de la condition grecque : « le soleil est une misérable ankylose de plus qui remplit les Grecs d’une confiance/arrogance totalement creuse et véreuse, une ancestrale divinité du temps des cavernes, qui pourtant ici est encore adorée incommensurablement par les hommes préhistoriques qui sautillent en hurlant autour de la statue sphérique enflammée qui leur fournit en abondance sous forme de lumière une illusoire supériorité capable de les débarrasser du devoir et de l’envie d’atteindre quoi que ce soit d’autre ».

De retour à Athènes en observateur extérieur, Alexandros règle son compte à la capitale grecque, « une modeste réplique de ville européenne » dont le nom même serait « une appellation dissonante qui revient à baptiser un cafard Napoléon ». C’est Athènes au plus mal, celle de la crise du début des années 2010, une ville invivable, qui suinte une folie destinée à se généraliser. Le narrateur souffre physiquement d’un mal auquel aucun médecin ne trouve d’explication, et nous mène de ses entrailles à celles de la ville et retour. Comme le Dublin de Joyce, cette Athènes est saturée de marques, de réclames, de mots lus sur toutes les surfaces de la ville. Paradoxe, dans La boue, c’est une histoire qui « du début à la fin, n’est rien d’autre qu’une affaire personnelle », et pourtant Alexandros est toujours dehors, parmi les Athéniens. Le narrateur cherche « à se distinguer de toute l’incohérence ambiante », mais il n’est qu’une incarnation de plus de la ville, il est aussi fou qu’elle.
Ces deux romans n’ont ni la radicalité symbolique de La destruction du Parthénon (2010) de Christos Chryssopoulos, qui dynamite le Parthénon et avec lui le poids de son héritage, ni l’optimisme de Rhéa Galanaki dans L’ultime humiliation (2015), où deux retraitées rejoignent une des grandes manifestations contre l’austérité. Face à l’ampleur et au choc de la crise économique, politique et sociale commencée en 2008-2009, les écrivains grecs ont tout de suite réagi avec des romans dont l’intérêt littéraire dépasse le simple traitement symptomatique, avec un foisonnement d’angles et de styles d’écriture, pour témoigner de la transformation intégrale de la société grecque. Dans La boue, la crise sert de catalyseur à une pure création littéraire en vase clos ; dans Eau noire, l’insécurité et l’absence de perspectives s’expriment en une dystopie. Plutôt qu’ils ne proposent des issues, ce sont des livres inquiets, de la défaite, du nouveau régime après la crise.
Cet article a été publié par notre partenaire Mediapart












