Paul Louis Rossi est un artiste qui goûte le divers. À la fois poète, critique, peintre, il combine les gestes artistiques, les confronte les uns aux autres. Nous lui consacrons une livraison exceptionnelle de notre chronique « À l’écoute » qui rassemble des souvenirs et des lectures d’Yves di Manno, Anne Malaprade, Christian Rosset et Marie Joqueviel-Bourjea.

« [C]’est au murmure du Monde qu’il faut nous confier. Je n’ai pas résolu cette histoire : qu’est-ce que je cherche. Il n’y a rien qui me touche plus que le bruit des vagues de l’Océan sur le rivage, la nuit surtout. » (revue NU(e), n° 67)
Un « écrivain de la mémoire et de la nuit des objets » : c’est ainsi qu’Yves di Manno et Isabelle Garron présentent Paul Louis Rossi dans leur anthologie Un nouveau monde. Poésies en France 1960-2010. Parmi ces objets, on retiendra ceux, proprement stupéfiants, de la peinture, dont l’œuvre n’aura cessé de méditer le « fascinum » : aux yeux du poète, ils se révèlent « semblables à des amis vivants ou disparus, à des femmes rencontrées, à quelques paysages sublimes et rares dans le monde, à quelques randonnées dans les cavernes et les vestiges du monde ancien » (Visiteur du clair et de l’obscur, 2004).
Mais Paul Louis Rossi est peut-être, d’abord, un écrivain « [d]es pierres, [d]es végétaux, [d]es oiseaux et [de] quelques variétés de scarabées insignifiants » (Berlin. Voyage en automne, 2015). Car ce n’est qu’après s’être soucié du « chaos des roches » bretonnes (Inscapes, 1994, Les ardoises du ciel, 2008), des orpins en bord de Loire (« Variations d’orpins », Faïences, 1995 ; « Méditations d’orpins », Les gémissements du siècle, 2001), des grues et aigrettes garzettes de la rivière Kamo à Kyoto (dessins, Paysage intérieur, inscape, 2004) que l’on peut « s’occuper des humains et du droit des citoyens de l’humanité ». Regardons les brindilles (Fuscelli, 2000 ; Visage des nuits, 2005), ramassons les « fragments de [la] vaisselle du monde » dans le ressac, nous demande Rossi ; de là ces « poèmes minuscules » (Cose naturali, Faïences) qui inventent leurs formes épiphaniques sous le regard des peintres :
J’évoquais une fois encore La Corbeille des Verres de Sébastien Stoskopff. Je voulais une sorte d’euphonie qui anéantirait les angles et les contrastes, afin de la troubler ensuite par des gestes et des couleurs :
transparence
des verres
dans une
corbeille
jaune
osier
(Les ardoises du ciel)
L’écrivain, lui, c’est en « Visiteur oscillant » du clair et de l’obscur qu’il se présente régulièrement, en « Voyageur incertain » dont poèmes rigoureusement disposés et proses inclassables mettent en fable la quête intranquille. Du Voyage de sainte Ursule (1973) à Berlin. Voyage en automne, en passant par La voyageuse immortelle(1969/2001), Le supplément au voyage de Jacques Cartier (1980), La traversée du Rhin (1981) ou Les chemins de Radegonde (2011), c’est en effet à autant d’enquêtes que nous sommes conviés : enquêtes rétrospectives, cependant, qui semblent n’avoir d’autre visée que le fonctionnement vertigineux de la mémoire elle-même. Paul Louis Rossi ne confie-t-il pas : « partir du manque et même l’organiser, c’est ma méthode » ? (revue NU(e)). Marie Joqueviel-Bourjea

quand ce qui
reste caché
demeure
ce qui est montré
déjà
se décompose
Je relis aujourd’hui après beaucoup d’années et avec une émotion moins limpide, plus poignante peut-être, ces Cose Naturali de Paul Louis Rossi dont le rôle s’était avéré décisif autrefois, ouvrant un chemin d’écriture que je n’aurais pas entrevu sans elles, pas de cette manière en tout cas… Que ce soit par l’intensité, l’austérité presque de sa méditation sur la vanité des possessions ou par l’extrémisme de sa démarche – ses descriptions épurées, ses nomenclatures atones, son minimalisme prosodique –, ce livre est resté sans équivalent dans le monde de la poésie, parmi ses contemporains immédiats.
Bien sûr, il y avait eu les Documentaires de Cendrars, les Ardoises de Reverdy, le Printemps de Williams… Mais cela remontait déjà loin dans le temps. En outre, les Cose Naturali ont conservé une aura particulière à mes yeux, liée au caractère secret et presque confidentiel de leur découverte. Achevé dès 1973, l’ouvrage n’avait pas trouvé d’éditeur : seuls des fragments avaient vu le jour çà et là et je l’ai donc lu pour la première fois dans sa version complète à la fin des années 1980, l’auteur m’en ayant confié le manuscrit. Ce qui n’ajoute et n’ôte évidemment rien à son évidence sans âge, ce point d’équilibre presque miraculeux entre l’apparente fragilité des mots qui réinventent sous nos yeux, dans la trame du langage, ces natures mortes anciennes, et l’assurance de leurs strophes brèves, ciselées sur la page dans un mouvement conjoint d’effacement et de mise en lumière.
Cette thématique et cette quête formelle innervent bien sûr l’ensemble de l’œuvre de Paul Louis Rossi, l’une des plus justifiées et des mieux réfléchies de sa génération, malgré l’ombre dans laquelle on semble la reléguer. Et dont les Cose Naturali constituent le centre incandescent, l’infracassable noyau d’où elle ne cesse depuis lors d’irradier. Yves di Manno
En 1991, le poète Paul Louis Rossi et le peintre François Dilasser ont l’idée de composer un ouvrage à deux voix et quatre mains « par correspondances, échanges, voyages, et rencontres successives entre la peinture, l’écriture et le dessin ». Sous l’égide de Gerard Manley Hopkins, Inscapes paraît en 1994 : proses hybrides et poèmes plastiques de Rossi dialoguent avec dessins, notes et brouillons de Dilasser. Le livre s’organise sur le double modèle de la composition (musicale) et du montage (cinématographique), par « tuilage » de voix, mais aussi coupure ; ce qu’il vise, ce n’est pas la continuité du récit, mais la coupe épiphanique du poème :
Sourire
colossal
des idoles
il faut r
avaler
tes louanges
quoi qu’en dise
l’immortel
Hopkins
Les huit chapitres dessinent un cheminement à la fois rigoureux et lacunaire au sein de paysages intérieurs dont on pressent l’horizon commun :
Je suis persuadé […] qu’il existe un point de rencontre où la séparation convenue des formes artistiques se dissout. […] je vois cela plutôt comme une ligne à l’horizon, un peu comme à l’aube une lumière indécise, que l’on distingue tout à coup et qui se précise.
La comparaison géographique n’est pas fortuite : peintre et poète partagent les paysages de l’« Ouest surnaturel », le livre n’ayant de cesse de revenir aux formes, couleurs et lumières d’un lieu dont le centre est sans nul doute la maison du peintre dans l’anse venteuse de Goulven, dans le Finistère Nord. « On doit se dire parfois que c’est trop. » La beauté du monde nécessite en effet, après qu’on l’a éprouvée, de revenir sur la pointe des pieds à l’atelier, car « [l]e vrai travail est dans la nuit ». Marie Joqueviel-Bourjea
je suis au bord
des montagnes
je regarde
l’eau
Mettant en tension, de manière aussi libre que savamment construite, proses brèves et séquences en vers de quelques syllabes, Faïences marque, en 1995, le retour de Paul Louis Rossi à la poésie, non comme genre mais comme forme, après une formidable échappée en terre romanesque. Prenant racine dans les années 1980, au cours d’explorations des lieux d’origine de sa famille – la Bretagne mégalithique et l’Italie des peintres –, ce « recueil » en neuf parties est pour l’essentiel composé de variations dans l’esprit de Bach, de Webern ou du jazz moderne. Revenant sur « cette idée d’écrire un poème » qu’il avoue mal comprendre, il note que la précision de la sensation doit s’accorder à l’exigence d’une loi plus ou moins secrète ; et que la maîtrise de l’art de la digression doit ferrailler avec la « condensation dans la pensée du rêve ». En disciple de Segalen et de Ponge, il disserte aussi bien sur des végétaux éphémères que sur les rocs sur lesquels ils se sont fixés ; ou au sujet de ce malheur sans fond frappant une femme vêtue de la « robe bariolée des gitanes » qui rend visite à un prisonnier « en maillot de corps ». Animé par cette singulière densité des méditations où ce qui a été soustrait compte autant que ce qui a été ajouté, Faïences dissémine nombre d’interrogations, sans apporter de réponse définitive. C’est alors le silence, tant brisé que résonnant, qui a le dernier mot :
maintenant
rien
ne bouge
je sens
que
je
vais
rester
là
avec
les
ombres
Christian Rosset
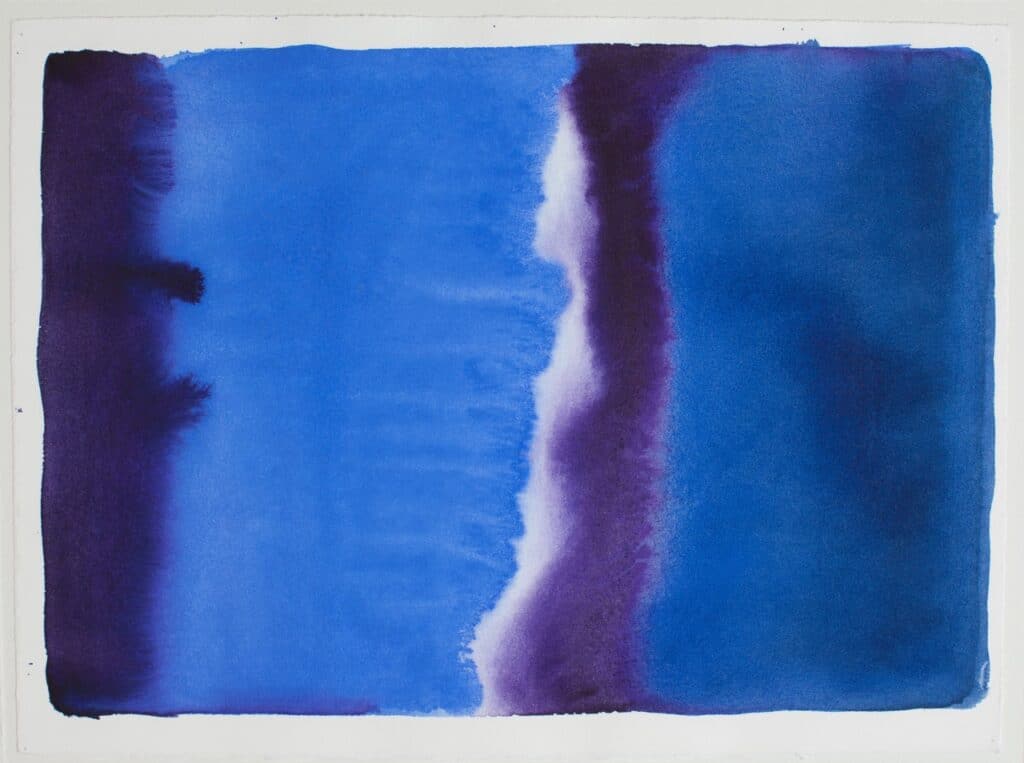
Qui a suivi le parcours de Paul Louis Rossi sur plusieurs décennies n’a pu que relever sa grande prodigalité en tous domaines – car au poème il faut ajouter le roman, l’essai et leurs nombreuses interpénétrations. Quelques pages de Cose Naturali publiées en 1975 dans le n° 23 de la revue Change m’avaient paru lumineuses, au point de m’inciter à rencontrer leur auteur – chose faite quelques mois plus tard. Je n’avais qu’à peine vingt ans, mais une première collaboration à l’Atelier de création radiophonique de France Culture avait été aussitôt mise en œuvre sur le thème d’Albrecht Altdorfer et la guerre des paysans. Notre poète s’étant montré homme de regard et d’écoute – et non des moindres –, il y en eut par la suite beaucoup d’autres. Il faut dire que la peinture est une des grandes affaires de sa vie. Mettant lui-même la main à la pâte (illustrant ses carnets), il s’est toujours montré à l’affut, tant de vestiges plus ou moins mystérieux du passé que de toiles en cours d’exécution, comme celles de Gaston Planet dont il a parfaitement su saisir la force d’inachèvement. Je me souviens qu’un jour, à Rome, il s’était longuement immobilisé devant une œuvre du Caravage, avant de nous gratifier de ses déductions sur ce que cette œuvre dégageait simultanément de force narrative et de beauté plastique. Mais il pouvait aussi fermer les yeux et se mettre à l’écoute des murmures de la nuit.
Lire Paul Louis Rossi, qu’on le connaisse personnellement ou non, c’est reprendre une conversation jamais interrompue. Pas besoin de se montrer bavard, même si le poète, malicieux et séducteur, aime les digressions. La soixantaine de livres qu’il a publiés bâtit une somme qu’il convient de ne pas laisser sommeiller. Il ne se passe guère de temps sans que je tire de ma bibliothèque un de ses ouvrages, et en particulier un de ceux où il s’est engagé dans une forme de dialogue en compagnie. Comme l’a écrit le peintre et cinéaste Jean-Michel Meurice : « Son travail est un hymne calme et joyeux à la vie ». À quoi j’ajouterai – un peu de contradiction ne pouvant faire de mal au visiteur du clair et de l’obscur – ce soupçon d’intranquillité qui a le don de mettre en chemin. Christian Rosset

Régine serait le premier récit de Paul Louis Rossi. C’est en tout cas un ouvrage éminemment poétique, dont la structure, organisée autour de seize chapitres, raconte comment le paysage d’une ville (« I. Le quartier de Doulon ») constitue le cadre d’une apparition (« II. Régine »). Apparition qui va frapper le narrateur au point qu’il déroule quelques fragments de sa vie, et de l’histoire tourmentée de la France de la Seconde Guerre mondiale puis de la guerre froide, sans jamais pouvoir oublier le visage et le corps d’une femme qui, actrice, au double sens du terme – elle agit et elle joue –, interroge le rapport que le narrateur entretient avec son enfance, la guerre, la politique et l’art. Le chapitre XIV, intitulé justement « Le Théâtre », raconte une révélation : celle des dangers et du pouvoir des artifices et des illusions. Au théâtre, depuis les coulisses, on passe de l’autre côté du décor, et on apprend à voir autrement le monde de l’enfance et des passions humaines, puisque tout geste s’y « consume » et s’y « défait ». Au théâtre on « trahit » ses croyances et son innocence. Au théâtre on touche le « Centre » de quelque chose d’essentiel que, peut-être, la littérature met en mots. Au théâtre, on représente un trésor idéal que les héros de la résistance ont incarné et que l’après-guerre a sans doute déconstruit : « En ces années, c’est l’idéal lui-même qui se mit à chanceler. On voyait bien que l’idéal, c’étaient des mots qui obscurcissaient la dure réalité. Ce n’étaient que des mots… Ces hommes et ces femmes, lorsqu’on leur montrait du doigt la vérité, tout simplement, ils n’y croyaient pas, comme les enfants dans les pires circonstances, qui refusent d’abandonner un rêve. » Je pense aussi à ces mots de René Char, issus des Feuillets d’Hypnos : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament », ou à cette parole de Tocqueville : « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit avance dans les ténèbres », que Hannah Arendt cite dans sa préface de La crise de la culture. Ces aphorismes racontent comment, lors de certains moments historiques proprement extraordinaires, l’homme s’engage en actes et en paroles dans le monde des affaires humaines.
Le monde est un théâtre : et la guerre, et l’amour, et la politique, sans aucun doute. Régine y est une « Reine » énigmatique et magnifique qui, le plus souvent silencieuse, apparaît sur la scène du monde pour si vite en disparaître. Exister, s’engager, aimer, fuir, résister, survivre, revivre, poursuivre, se suicider… Elle est celle qui, en tout cas, s’étend sur le dos pour « voir venir la mort en face… ». Sa vie, que le narrateur connaît aussi grâce à quelques fragments de son journal intime, dévoile une « vérité affreuse : […] le malheur peut ne pas avoir de fin, peut se dévorer lui-même et s’engendrer à l’infini, dans une sorte de ressassement ». Régine, nous dit le narrateur, instaurait une distance entre elle et ceux qu’elle aidait et fréquentait. L’écriture de Paul Louis Rossi ne force pas cet écart, qui est aussi une marque de respect et d’admiration. Sa prose, discontinue, agence des fragments de récits, des épisodes, des souvenirs, des anecdotes, qui jamais ne s’approchent trop près de cette femme. À partir de quelques photos, de témoignages, d’extraits de journaux, le narrateur reconstruit une silhouette errante dont le visage et le suicide restent finalement insaisissables.
Régine et son narrateur dégagent une aura mélancolique qui m’a fait penser à l’atmosphère du Grand Meaulnes d’Alain-Fournier. Apparition et disparition, brume et mystère, fascination et perte sont au cœur de ce récit dont l’écriture, précise et ciselée, classique et intempestive, est d’une mesure et d’une beauté remarquables. Elle sait en tout cas aller jusqu’« au-devant » des morts, au plus près de l’abîme. Parler avec eux et pour eux du « jadis et de l’autrefois ». Anne Malaprade
Pour aller plus loin : Poezibao revue Nu(e) dossier 67 Paul Louis Rossi











