C’est toujours un plaisir de lire Antonio Muñoz Molina, l’écrivain à la fois le plus célèbre et le plus discret du roman espagnol. Même sur le mode mineur de ce roman doucement crépusculaire, comme peut l’être un ciel lisboète au-dessus du Tage.
Puisque de « tes pas » il est question dès le titre, le lecteur français pensera peut-être à ceux de Paul Valéry (« tes pas, enfants de mon silence ») et à ses derniers vers : « Douceur d’être et de n’être pas / Car j’ai vécu de vous attendre / Et mon cœur n’était que vos pas. » N’oublions pas que Nathalie Sarraute, avec son article féroce intitulé « Paul Valéry et l’enfant d’éléphant », a définitivement réglé son compte à cette poésie – et ce n’est pas sans scrupules que je la ressuscite pour l’occasion. Mais même si la formule Tus pasos en la escalera ne renvoie sans doute pas à ce poème, ces quelques vers disent tout de même l’une des possibilités de sens du roman de Muñoz Molina. L’une seulement car, comme toujours chez ce grand écrivain, rien n’est jamais ce qui semble être.
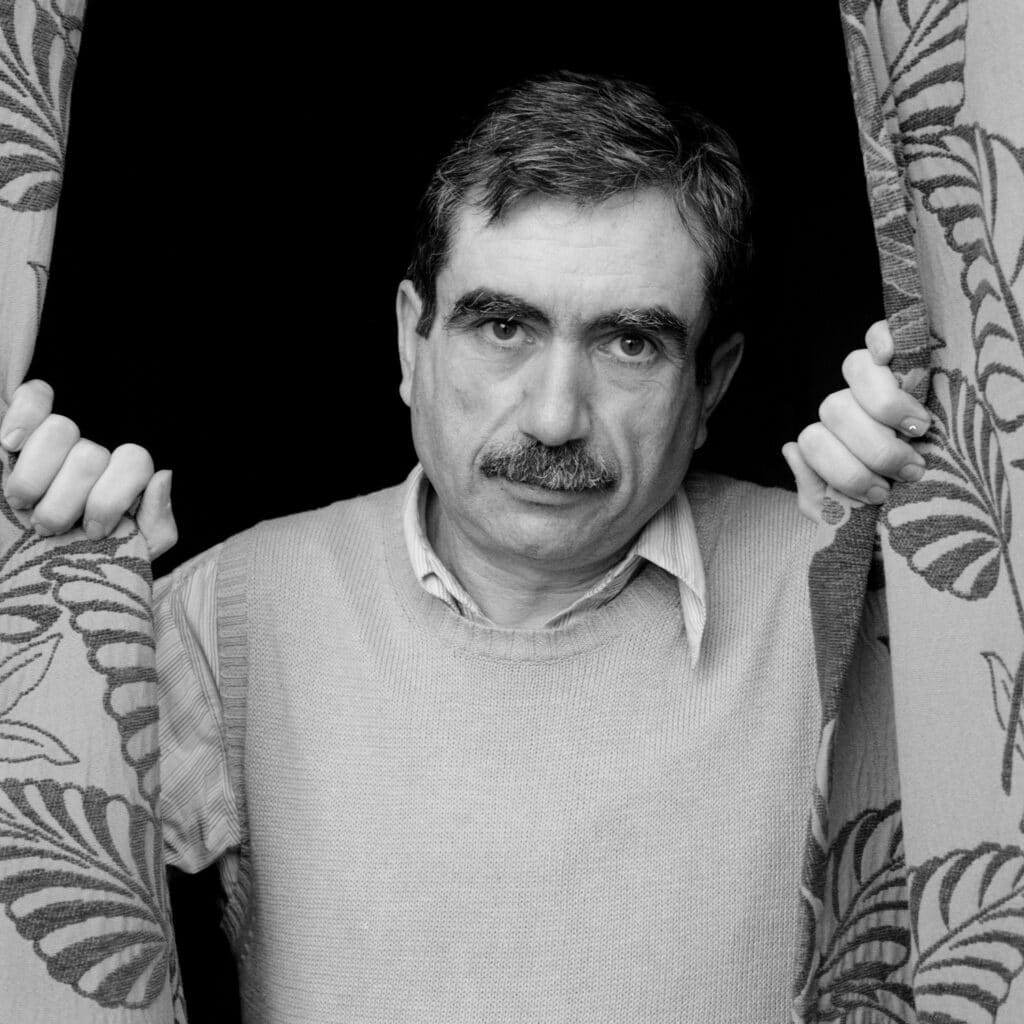
Le narrateur attend, dans son appartement neuf de l’Alcântara – réplique quasi parfaite de son ancien appartement new-yorkais –, et en compagnie de sa chienne Luria, que le rejoigne sa compagne, Cecilia, brillante scientifique spécialiste des mécanismes neurologiques de la mémoire. Après le 11-Septembre, dans les ruines des tours, il n’était plus possible de rester à New York, et Lisbonne est apparue comme une forme de distension du temps, frappé d’une amnésie intermittente. Or (c’est nous qui l’ajoutons), sous le pont (« du 25 avril ») de Lisbonne, un graphe fait lire : « Until debt tear us apart ». Ce qui sépare le couple central du roman, outre l’Atlantique, ce n’est pas la dette proprement dite, mais quelque chose qui s’en rapproche – un compte non soldé, une relation sous hypothèque, le mystère d’une histoire inachevée, dont le dévoilement n’intervient que lentement, « dans l’ordre méticuleux du temps », et surtout de cette façon très singulière qui fait tout l’art d’Antonio Muñoz Molina.
« La littérature n’est pas intellectuelle. C’est le récit du monde. C’est primitif. C’est essentiel », confiait l’auteur à Marie Richeux, qui l’interrogeait le 5 décembre dernier. On savait déjà que Muñoz Molina était l’un des conteurs d’Espagne les plus virtuoses et subtils – et ce depuis 1986 et la parution d’un chef-d’œuvre, Beatus ille : un roman qui, déjà, savait jouer des illusions narratives, sensorielles et amoureuses, même, pour mieux retourner comme un gant les mythologies historiques de l’Espagne post-franquiste. Heureux celui qui loin des affaires cultive le champ de ses ancêtres… La leçon des Épodes d’Horace n’était audible qu’à la toute fin du roman, une fois traversé le voile des apparences. Le primo-romancier faisait la preuve qu’on pouvait à la fois aimer Jules Verne et reprendre en récit la leçon foucaldienne sur les Ménines.
« La littérature n’est pas intellectuelle. C’est le récit du monde. C’est primitif. C’est essentiel », confie Antonio Muñoz Molina.
À l’autre bout d’une carrière aussi prolifique que discrète, où les accomplissements se sont régulièrement succédé (Beltenebros, L’hiver à Lisbonne – déjà –, Séfarade, Dans la grande nuit des temps…) et où la conscience du temps qui passe succède implicitement à celle des temps passés, voici que reprend forme (très bien servie par la traduction d’Isabelle Gugnon) la méditation initiale sur les errances et les lacunes d’une vision du monde portée par qui en a perdu le sens. Il faut dire que le jeu de miroir qui fait que le narrateur quitte l’appartement new-yorkais pour sa réduplication lisboète a de quoi troubler la conscience, et plus précisément cette partie du cerveau qui gouverne l’articulation entre les facultés de mémoire et de peur – objet d’étude de Cécilia. Ce n’est pas qu’il y ait péril en la demeure dans ce récit patient et subtil de la fin du monde : il n’y a de demeure que dans ce péril, et la fin du monde a déjà eu lieu. Tout se passe comme si le traumatisme du 11-Septembre et la conscience de la crise climatique avaient déjà privé le récit (et la vie, c’est pareil) de tout arrière-plan, et qu’il ne restait plus au protagoniste qu’à promener sa mélancolie légère au gré des rues qui bordent le Tage et dont il oublie régulièrement la géographie, menacé par ce qui ressemble fortement aux prémices d’Alzheimer. À moins qu’il ne s’agisse d’autre chose ?
Selon Antonio Muñoz Molina, on apprend des choses de l’amour quand on lit. C’est ainsi qu’il peut, contrairement à la plupart d’entre nous, pleurer au « Et ce fut tout » de L’éducation sentimentale, quand (et parce que) Frédéric Moreau et Mme Arnoux ont conscience qu’il est trop tard. Il peut aussi croire suffisamment en la littérature pour penser que « les romans sont l’archive de l’expérience humaine ». Mais quand cette expérience se rapproche de celles que Cécilia produit en manipulant le cerveau de ses cobayes, que reste-t-il, au narrateur, errant dans son labyrinthe, qui lui garantisse de préserver l’archive de sa vie ? Comment faire confiance à ce qui va advenir quand on perd la mémoire de ce qui s’est passé ?
Il n’est pas utile d’en dire plus ici. On laissera aux lecteurs le soin de reconnaître les indices, ou plutôt les « pistes » laissées à son intention sur le pavé du récit lisboète par un Muñoz Molina à la fois espiègle et tendre. Est-ce un roman sur la mémoire (et ses maladies) ? Sur la douleur fantôme de ce qui aurait pu avoir lieu ? Sur la vie arrêtée dans l’attente de ce qui ne peut arriver ? Ou sur l’illusion masculine d’une destinée conjugale non consentie ? Un peu tout cela, selon les moments et ce que l’on choisit d’y lire.
Olivia Rosenthal avait déjà traité brillamment et délicatement du thème de la maladie d’Alzheimer dans On n’est pas là pour disparaître (Verticales, 2007). « “Faites un exercice.” Imaginez-vous dans la situation de celui dont l’histoire a été engloutie. “Faites un exercice.” Quand vous êtes sûr que c’est la dernière fois que vous voyez quelqu’un, prononcez, non comme une injonction mais comme un constat, cette phrase dans votre tête : je ne le reverrai jamais. » Cet exercice même se pratique ici comme un art du récit à éclipses (éclipse de lune comprise). On ne sait pas bien pourquoi le narrateur est là, à Lisbonne, disparaissant peu à peu dans le décor de sa nouvelle vie, en forme de boîte-miroir du passé perdu. On oublie un peu soi-même ce qui motive son récit, attentif à la seule rythmique des phrases. Mais parfois il est bon de ne pas bien savoir, et d’oublier ce qui nous motive.












