On parle beaucoup en ce moment de Ségurant, ce chevalier de la Table ronde jusqu’alors inconnu, exhumé de manuscrits retrouvés dans différentes bibliothèques d’Europe par un jeune médiéviste italien. Ce dernier compare non sans humour sa quête de dix ans à la recherche des manuscrits à celle de son « chevalier au dragon », tombé dans l’anonymat de la censure et de l’oubli. C’est une entreprise un peu analogue, quoique plus discrète, qui nous permet aujourd’hui de lire les aventures du chevalier Paris et de la princesse Vienne, traduites du yiddish ancien par Arnaud Bikard, jeune et brillant chercheur lui aussi, qui réussit la prouesse de restituer en alexandrins le texte original écrit au XVIe siècle en ottava rima. C’est le mètre de l’Arioste dans le Roland furieux, ouvrage qui a directement inspiré ce roman de chevalerie en yiddish, joyau inégalé de la littérature ancienne en vernaculaire ashkénaze.

Son auteur, dont l’identité restait jusqu’alors assez controversée, est un érudit d’origine ashkénaze, un grammairien et philologue hébraïque, dont l’œuvre en vernaculaire, au sein de laquelle deux romans de chevalerie, le Pariz un Vienè, sans doute écrit après 1532, et le Bovo Dantone, publié en 1541 mais écrit en 1507, a fini par éclipser la renommée de son œuvre savante en hébreu. Le nom d’Elia Levita renvoie à la sphère italienne, où s’est déroulée la plus grande partie de son activité intellectuelle, mais il est souvent désigné en yiddish par son nom d’usage, Elye Bokher, qui peut vouloir dire Élie l’étudiant, ou Élie le célibataire. C’est le nom qui apparaît dans le prologue comme celui du vieux maître du narrateur, et la qualité de célibataire (bokher) attribuée au narrateur anonyme revient de façon ludique comme une ultime pirouette à la fin du récit, ce qui pour Arnaud Bikard, à côté d’indices stylistiques et formels solides, vaut pour signature de l’œuvre.
Né en 1469 dans les environs de Nuremberg en Bavière, Elia Levita émigre en Italie au tournant du siècle, d’abord à Padoue et à Venise, villes d’imprimeries hébraïques, puis à Rome, auprès du cardinal Gilles de Viterbe, éminent représentant des courants humanistes qui tentent de faire un retour aux sources hébraïques et bibliques de la religion chrétienne. Protégé par ces cercles proches de l’Église, Levita n’en mène pas moins une vie assez précaire, et lui qui est l’un des meilleurs spécialistes de son temps de la Bible est souvent réduit à exercer le métier d’imprimeur, de correcteur ou de scribe, parfois même d’enseignant, retournant en Allemagne peu avant sa mort (en 1549) pour aider l’imprimeur chrétien Paulus Fagius dans son entreprise d’impression hébraïque, ou travaillant à Venise avec Daniel Bomberg à une célèbre édition de la Bible. Il est surtout connu comme grammairien et massorète, fixant la grammaire et la vocalisation du texte biblique en en précisant le caractère construit et humain, contrairement au dogme, qui en fait un texte inaltéré depuis sa source divine.
Dans son magistral travail de thèse La Renaissance italienne dans les rues du ghetto. L’œuvre poétique yiddish d’Elia Levita (1469-1549), publié en 2020 (éditions Brepols), Arnaud Bikard décrit Levita comme un auteur bifrons, caractéristique par ses multiples facettes, voire ses contradictions, de la richesse et de l’ouverture de la société juive italienne et de la modernité complexe de l’œuvre en vernaculaire. Le yiddish ancien – encore assez proche de l’allemand à cette période de son évolution, mais comportant une composante hébraïque importante qui le différencie, et des variations locales, comme, dans le cas de Levita, de fréquents italianismes – est alors une langue déjà dotée d’une importante diffusion littéraire, même si son utilisation reste souvent cantonnée dans des sphères teintées de didactisme religieux ou moral ; et si Levita la combine avec la rime caractéristique de la production poétique et épique italienne, il n’en destine pas moins la lecture de ses romans chevaleresques à une sphère beaucoup plus vaste que celle du lectorat juif italien puisqu’il les écrit en yiddish, sa langue maternelle. En outre, il reprend des motifs courtois qui sont déclinés dans des œuvres ayant une vaste diffusion européenne, dans un grand nombre de langues ; le roman de chevalerie originel, narrant l’histoire d’un couple d’amants séparés par la rigueur paternelle et finissant par se retrouver au terme de longues et douloureuses épreuves, a connu de multiples adaptations à partir de la version originale provençale, datant du début du XVe siècle, et de ses réécritures, en ancien français puis en italien. Cette dernière est la source dont s’inspire Levita, qui ne craint pas de faire référence au livre « chrétien » dont il tire sa matière tout en l’adaptant à ses vues propres et à l’atmosphère du ghetto juif dont il est familier.
S’il reste un auteur juif fidèle à sa foi religieuse et à sa langue maternelle, et s’il bénéficie bien évidemment du bilinguisme caractéristique des érudits, utilisant l’hébreu et le vernaculaire selon des sphères d’activité bien spécifiques, il n’en relève pas moins d’une démarche intellectuelle d’interaction profonde avec la culture profane de son temps, adaptant à un public bourgeois et juif les énoncés aristocratiques de la culture médiévale, déjà largement transformée par l’évolution du roman de chevalerie en Italie et l’hybridation de l’épopée par la poésie courtoise et la parodie, qui motivent son évolution, jusqu’aux transformations décisives du Don Quichotte, qui en signent la fin.
Que cette problématique culturelle et littéraire soit au cœur du texte de Levita est en soi un indice des processus d’ouverture et d’interactions culturelles dans les deux sens, réinscrivant la littérature juive dans un contexte européen, qui infuse une créativité malgré tout spécifiquement juive, foisonnante de vivacité et de références propres. L’influence de l’Arioste, décisive au vu des nombreux emprunts de Levita à l’Orlando, œuvre omniprésente dans les listes de censure des livres juifs en Italie, influence qui passe par la prosodie et les quasi-traductions littérales de certaines strophes, est elle-même une preuve de l’intégration culturelle des Juifs italiens, parmi lesquels vit une importante communauté ashkénaze, dont fait partie Levita. Certes, le ghetto est instauré à Venise en 1516, du temps de notre auteur, mais il correspond à cette époque à un simple quartier juif, et les interactions sociales entre les deux sociétés sont beaucoup plus faciles qu’en Allemagne, par exemple, dont Levita a fui les violences et les discriminations. Il est malgré tout mêlé aux événements historiques de son temps et est chassé de Padoue par le sac de 1509 par la Ligue de Cambrai, et de Rome, par celui de 1527 au moment des guerres d’Italie. Et si Levita, malgré son ouverture d’esprit humaniste, reste attaché à la religion de ses pères et est enterré au cimetière juif du Lido, ses petits-fils, quant à eux, se convertissent du vivant de leur grand-père et rejoignent des cercles proches de l’Église où ils peuvent exercer leurs compétences dans le domaine de l’édition et des savoirs juifs.
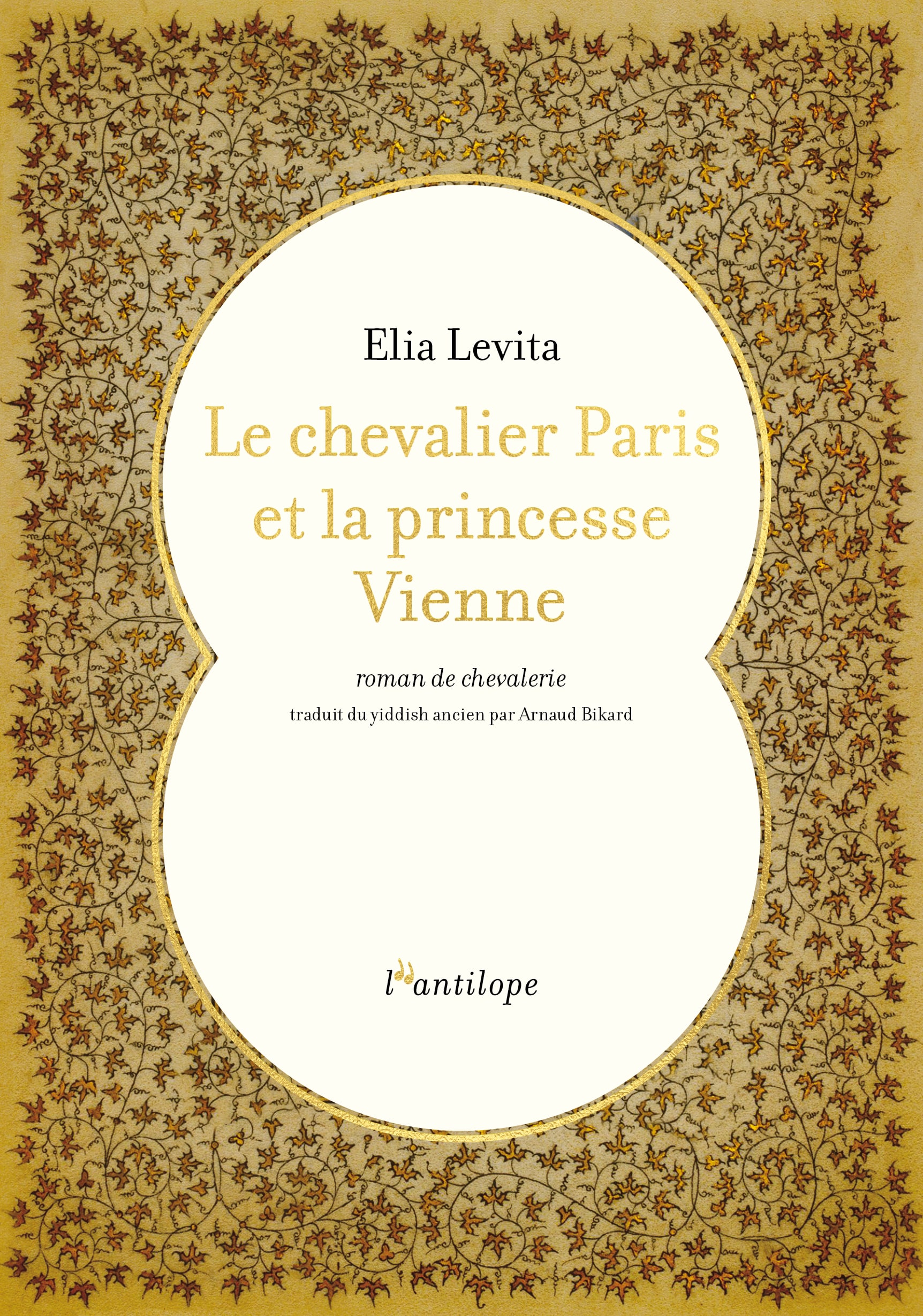
L’évolution de l’écriture entre le Bovo Dantone et Pariz un Vienè, à quelque vingt-cinq ans d’écart, témoigne de l’approfondissement par Levita du modèle chevaleresque italien, fait de décalage subtil avec la tradition médiévale, d’ironie savante et d’évolution vers un traitement du roman courtois plus psychologique et sentimental qu’épique. L’influence de la poésie lyrique, celle de Pétrarque, celle de Dante également à travers la composition en « chants », mais aussi l’influence de la parodie et du traitement humoristique des relations entre les sexes, avec des pointes appuyées de misogynie et un recours au bas corporel qui peut évoquer Rabelais, sont au carrefour des transferts culturels entre l’œuvre juive et ses contemporaines européennes.
C’est surtout la présence de prologues, comme chez l’Arioste, au début des dix chants du roman yiddish qui signe la proximité culturelle avec la référence italienne. De même que chez l’Arioste, ces prologues fonctionnent comme un miroir du contexte contemporain et autorisent de multiples allusions aux énoncés sociaux des Juifs italiens, en particulier ceux de Venise dont Levita dresse un portrait peu flatteur, leur reprochant leur manque d’accueil de leurs frères étrangers, souvent des exilés comme lui-même naguère. Il dénonce pêle-mêle le culte de l’argent et la plaie des mariages arrangés, souvent mal assortis en âge, qui causent généralement le malheur des femmes. Il vante, à l’inverse, l’amitié vraie qui supplée aux relations de parenté défaillantes et même aux règles générales de solidarité communautaire en contexte juif.
La reprise du modèle chevaleresque lui permet de transférer les codes d’honneur courtois et les hiérarchies strictes du monde féodal vers une critique subtile des dysfonctionnements de la société juive où il garde, malgré sa notoriété en tant qu’érudit, une position à la marge. Loin de reprendre une tradition narrative teintée de merveilleux et de surnaturel, que l’on trouve encore chez l’Arioste à travers de multiples entrelacements et démultiplications foisonnantes d’intrigues, il témoigne avec son Paris et Vienne d’une appropriation teintée de réalisme psychologique et social de la matière épique chrétienne.
La trame reprend assez exactement le déroulement des épisodes dans l’histoire de départ : la naissance de Vienne, fille longtemps espérée d’un couple royal, l’amour immédiatement passionnel qui l’unit à Paris, fils d’un vassal du souverain, les preuves secrètes de cet amour liées aux épreuves chevaleresques auxquelles se soumet Paris, le refus violent du père de Vienne d’accepter ce prétendant de rang inférieur et l’échec de la tentative de fuite des amants, l’emprisonnement de Vienne qui refuse les autres prétendants, les voyages de Paris en Orient pour échapper au désespoir amoureux, et enfin l’issue réconciliatrice qui voit le père de Vienne sauvé par Paris de sa captivité chez le sultan et le mariage des amants qui vient sceller leur fidélité réciproque.
Le narrateur intervient très souvent dans l’intrigue, soit dans les prologues, où il brise l’illusion fictionnelle et parle au nom de son temps et de sa condition juive, soit même au sein de l’histoire racontée, où il commente sans cesse, de façon humoristique, son rapport à sa source, aux énoncés chevaleresques déjà présentés comme matière récréative d’un temps antérieur et d’une culture chrétienne étrangère, et même à ses personnages, dont il manipule sans vergogne le vécu diégétique, annonçant ou retardant à son gré les épisodes sans doute déjà connus des lecteurs, et accréditant la fiction d’une récitation orale, lors même qu’il souligne constamment le rapport au livre et à l’écrit. Il s’agit donc d’un rapport ludique à l’écriture, d’un divertissement littéraire présenté comme accordé au besoin des femmes juives de lire en yiddish des histoires à la mode, mais sous le masque également d’une stratégie subtile d’insertion de son auteur-narrateur dans les circulations littéraires les plus prestigieuses de son temps.
Déjà entamée par cette position en surplomb qui autorise tous les jeux d’esprit et la satire masquée du monde de l’auteur, la matière chevaleresque intrinsèquement féodale et chrétienne apparaît alors comme une trame merveilleusement ductile, où l’histoire de départ chatoie à travers des revêtements, des couleurs, des fils ressortissant avec le plus grand naturel à une vision juive de l’histoire narrée. Cela oblige certes à quelques contorsions et à une certaine ingéniosité imaginative : ainsi, pour conserver le rôle de l’évêque, médiateur important entre les deux amants dans l’idylle de départ, Levita doit expliciter l’amitié de Paris pour ce personnage polémique en contexte juif, en l’assortissant d’un avertissement anxieux des parents du jeune homme sur les dangers de cette fréquentation, énoncé qui fait immédiatement sens pour son public juif mais est peu cohérent avec la trame narrative principale. Les transpositions qui suppriment les allusions transparentes au monde chrétien, comme certaines dates de fêtes religieuses, les pèlerinages en terre sainte ou l’évocation du Christ ou de la Vierge s’accompagnent d’idiomatismes ou de formulations courantes en contexte juif, comme par exemple l’évocation des mariages décrétés d’en haut, de la bar-mitzva, ou des salutations usuelles de la sociabilité juive.

Mais, plus globalement, l’impression dominante est celle d’une « traduction » ou d’une adaptation tout en souplesse d’un idiome culturel dans un autre, d’une fiction palimpseste, reformulant dans une langue extrêmement vivante et naturelle la partition antérieure, l’acclimatant à son public juif par sa forme, ses trouvailles linguistiques, sa diversité idiomatique, son stock de références aux textes juifs, et peut-être aussi avant tout au mode de vie du ghetto italien et aux énoncés pratiques du judaïsme. Ainsi, à côté des hébraïsmes qui parsèment le vernaculaire, on va trouver des italianismes usités dans le cadre quotidien, l’évocation concrète de mets particulièrement prisés par les habitants du ghetto, des recettes de bonnes femmes dans le cadre médical ou des allusions très claires à la piété en milieu juif. La pluralité linguistique au sein du cadre organique de l’ottava rima est à l’image d’une vie juive multidimensionnelle, dont le lecteur moderne découvre avec étonnement qu’elle laisse toute sa place au corps, au plaisir amoureux, à l’évocation de la beauté des jeunes amants épris de liberté et d’accomplissement du désir. La physiologie des corps est également traitée avec le plus grand réalisme, non exempt de traits d’humour cru, à la façon d’un Rabelais. Notre image de la société juive ancienne gagne ainsi en nuances et en profondeur.
Sans oublier le cadre du récit, foncièrement adapté à la religiosité juive, qui postule dans l’incipit le pouvoir créateur du divin et dans la conclusion la certitude de la venue du Messie, quand « nous raconterons de Dieu le réconfort/Et ne parlerons plus de Paris ni de Vienne » : ultime renversement d’un récit riche en travestissements, qui révèle sans doute là son noyau intime, reliant son auteur à ses coreligionnaires par-delà la virtuosité éclectique de ses codes littéraires.
Et pour finir sur le mode de la réclame, adopté par les conteurs anciens qui incitent à l’achat de leur ouvrage, n’oublions pas de saluer le riche travail d’édition de L’antilope, qui nous gratifie d’une très belle édition en fac-similé, avec les gravures originales et quelques pages de la seconde édition imprimée de Vérone de 1594 !












