Est-on plus attiré par un film dont les publicitaires assurent qu’il est « inspiré d’une histoire vraie » ? A-t-on besoin de savoir que le destin de Julien Sorel est inspiré d’un « fait divers réel » ? Devant son nouveau livre Identité nomade, le lecteur fervent de J. M. G. Le Clézio est décontenancé de le voir exhiber ce qui, dans sa vie réelle, l’a incité à écrire ses romans. On était sensible à la magie de son écriture et l’on se sent comme le spectateur fasciné à qui le prestidigitateur dévoilerait ses trucs. Et puis on comprend qu’autre chose est en jeu.
Identité nomade commence sur le mode de l’autobiographie, avec la naissance puis l’enfance. La situation des parents, le père éloigné par la guerre passée à soigner les Nigérians puisqu’il était citoyen britannique en tant que Mauricien. Vient ensuite la découverte de l’Afrique quand ses parents se retrouvent là-bas après un long voyage en bateau. Puis ses études, son mariage avec une Marocaine noble du Sahara. Enfin, la gloire littéraire à vingt-trois ans avec Le procès-verbal – mais de cela il est assez peu question et du prix Nobel pas du tout.
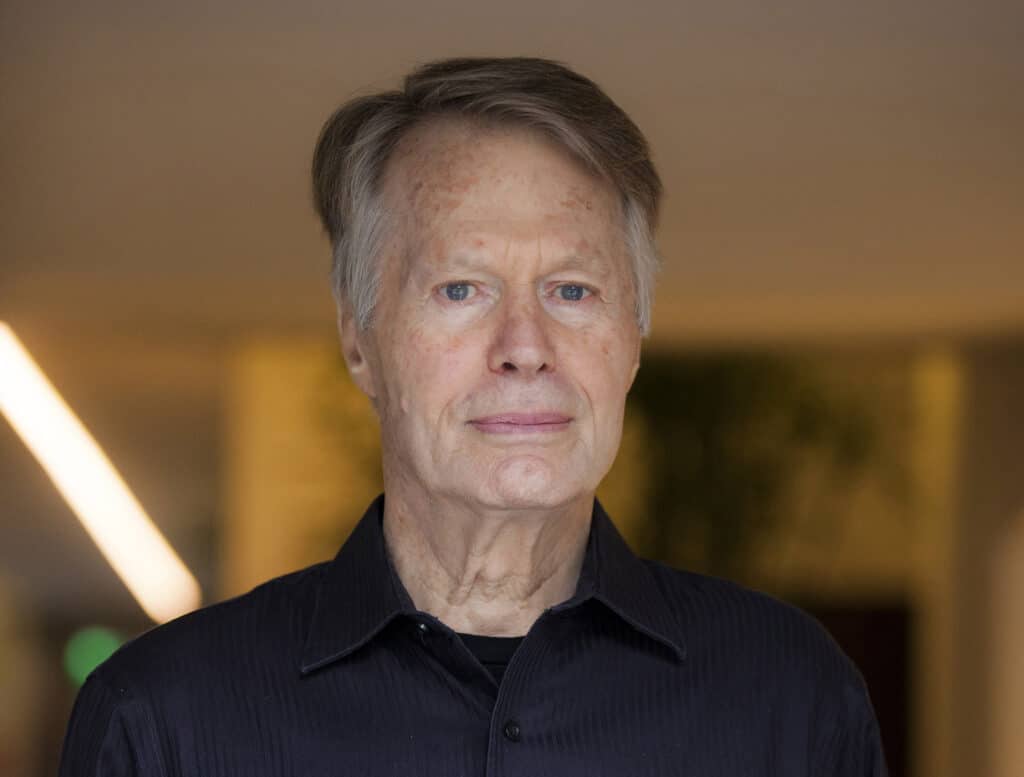
En avançant dans ce bref livre constitué de vingt-cinq chapitres très courts, le lecteur prend peu à peu conscience que l’auteur était animé d’une intention autre que de se complaire dans le miroir de souvenirs, certes originaux. Il y a les faits, sans doute, mais surtout la lecture qui peut en être proposée et qui n’est pas psychologisante. Naître à Nice en 1940, ce n’est pas bénéficier d’emblée de la richesse d’une capitale du luxe mondial. C’est arriver dans une ville maritime dont l’occupant a rendu impossible tout accès à la mer, une ville où l’appauvrissement est tel que la faim tue « des gens âgés et des enfants en nombre effrayant » et où la famine n’a pas subitement cessé le 9 mai 1945. La guerre, c’est cela : « un crime contre les vieux et contre les enfants ».
On comprend alors que ce livre pose la question de l’identité de cet homme, cet écrivain « qui écrit sans cesse les mêmes choses, qui remet en scène ce qui le hante et ce qui l’a motivé ».
Le petit garçon de huit ans qui part pour le Nigeria y découvre son père, certes, mais aussi la vie africaine. Il quitte un pays fermé par la guerre et bombardé par « l’aviation canadienne et américaine », et arrive dans une colonie dépendant de la couronne britannique, où l’on peut courir pieds nus dans la forêt, découvrir la vie, celle des multiples espèces d’animaux. « C’était une vraie liberté » dans laquelle il fallait apprendre suffisamment de mots ibos pour pouvoir jouer avec les autres enfants. Le retour vers la France quelques années plus tard ne fut pas aisé, moins parce que cela signifiait les contraintes de la scolarisation qu’à cause de la différence de maturité entre des petits Français munis de jeux prêts à l’emploi, ne serait-ce qu’un simple ballon, et des petits Africains qui « possédaient très peu de jeux [et dont] les activités étaient en général liées à l’utilité de la vie ».
Lors d’un voyage au Maroc au début des années 1950, il voit un geste de racisme ordinaire commis par un chauffeur de bus français contre un pauvre vieux paysan. Son père lui explique que telles sont les injustices de la colonisation et cette scène est pour lui fondatrice. Elle a corroboré celle, qu’il avait vue au Nigeria, d’hommes enchaînés pour aller construire la piscine du District Officer.
On comprend alors que ce livre pose la question de l’identité de cet homme, cet écrivain qui « écrit sans cesse les mêmes choses, qui remet en scène ce qui le hante et ce qui l’a motivé ». Et cette identité est « nomade », ne serait-ce que du fait de la double nationalité anglaise-française. Si sa vie fut aventureuse, c’est malgré lui, sans qu’il se soit posé la question de l’identité puisque de fait elle était double, avant même qu’il se découvre un peu nigérian à l’âge de l’école primaire puis marocain par son épouse. Et bien sûr il était aussi mauricien par ses deux parents, chacun à sa manière.

Le lecteur de Le Clézio a déjà reconnu la source de plusieurs de ses romans, mais il n’avait pas forcément soupçonné quelles étaient ses lectures favorites. Il peut s’étonner d’un goût pour la littérature anglo-saxonne, Stevenson par exemple, qu’il n’avait pas pressenti. Il pouvait deviner un intérêt particulier porté à l’Afrique – mais peut-être pas une connaissance aussi approfondie de la littérature africaine. Celle-ci diffère profondément de ce qu’a pu être le « formalisme » du Nouveau Roman car la réalité africaine est « très puissante, très forte […] une sollicitation permanente » : on est « sommé à chaque instant de prendre part, voire de prendre parti ». D’une certaine façon, tout lecteur de Le Clézio avait remarqué que celui-ci était loin de se reconnaître dans le moderne mouvement de l’art pour l’art, lui préférant le « flambeau de la littérature engagée » que portaient de jeunes écrivains d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique.
Ce n’est pas, toutefois, que ce romancier prétendrait écrire des livres politiques au sens qui put être celui des années 1950, quand le monde était partagé en deux camps entre lesquels la ligne de séparation était claire. Le Clézio est prêt à admettre l’idée désespérante que la littérature serait aussi inutile que tout art puisqu’elle « n’a pas su arrêter la traite des esclaves ni les crimes de la colonisation, […] empêcher les guerres, […] interdire les mouvements haineux et les injustices, elle n’a même pas contredit la dégradation du milieu ambiant, de la nature ». Peut-être y avait-il de l’angélisme à énoncer un tel programme, mais on peut tout de même attendre de la littérature qu’elle donne « la parole aux grands élans de consolation en incarnant les rêves d’enfance, l’amour, l’espoir d’un monde meilleur, le goût de la beauté ». Peut-être est-ce encore trop demander mais reste quand même la dimension de témoignage d’une époque, parfois de sa critique, si l’écrivain a une parole vraie, ou du moins s’il recherche la vérité.





![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)






