Le cinquième tome de la correspondance de Marguerite Yourcenar couvre trois années (1968-1970) essentielles pour l’écrivain puisque s’y confirma, avec la publication de L’Œuvre au noir (1968), la grande réputation que lui avaient acquise les Mémoires d’Hadrien (1951). Elles apportèrent à l’auteure des reconnaissances officielles, comme son élection à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique en 1970. Il fallut dix ans supplémentaires à la France pour lui accorder « l’immortalité », honneur qu’elle n’avait d’ailleurs aucunement recherché.
Ce tome la trouve donc essentiellement occupée à « suivre » la publication de L’œuvre au noir et, comme dans les précédents volumes, à organiser son existence entre sa résidence de Petite Plaisance sur l’île des Monts Déserts dans le Maine aux États-Unis et des séjours en Europe. Il comprend une abondante « correspondance d’affaires », de nombreux commentaires sur ses propres œuvres et donc aussi sur sa vision morale et philosophique du monde, de brefs aperçus sur des engagements ou préférences politiques et sur sa vie intime si l’adjectif convient à une auteure peu adepte du dévoilement d’elle-même.

Ce volume, comme les précédents, est construit autour de deux « principes » qui ne sont pas sans influence sur la vision qu’il donne de la femme et de l’auteure. Encore une fois, la correspondance « à sens unique » (seulement ses lettres) fait inévitablement paraître Yourcenar plus catégorique et parfois « sans appel » qu’elle ne l’était sans doute dans la réalité. Ensuite, ces lettres, tirées d’un fonds déposé par elle à la Houghton Library de Harvard, sont « autorisées » (d’autres sont interdites de consultation jusqu’en 2057), et fournissent donc une image « sous contrôle », Yourcenar choisissant bien évidemment les côtés de sa personnalité dont elle aimerait qu’on se souvînt.
Cela étant, le contrôle a ses limites, et le côté parfois vétilleux ou mesquin de quelques missives professionnelles, surtout de la part d’une âme aussi élevée que la sienne, pourra surprendre. Mais l’essentiel n’est pas là, il réside dans la haute conception de la littérature qui transparaît dans ses lettres et dans le désir que son travail réponde aux plus exigeantes aspirations de son art. Pourvue d’une riche culture littéraire, elle a pour modèles, disons « de référence », de grands auteurs classiques (des écrivains de l’Antiquité, Dante…) et aime quelques-uns de ses contemporains ou presque contemporains (Thomas Mann, on le sait, mais aussi, on le sait moins, le Vladimir Nabokov de Lolita pour ce qu’ « il montre de l’Amérique vue par les yeux d’un étranger ») tandis qu’elle dit ne pas beaucoup goûter Virginia Woolf, dont elle a pourtant traduit Les vagues et qu’elle a rencontrée dans sa jeunesse, car elle ne ressent aucune « affinité » esthétique avec son œuvre. Quant aux auteurs de sa génération ou plus jeunes, ils ne l’intéressent guère, sans doute les trouve-t-elle soumis à des « valeurs en vogue » et trop désireux, dit-elle à un correspondant, de « refléter notre affreux chaos, au lieu de l’explorer pour essayer d’en sortir ». En tout état de cause, alors que 1968 vit le prix Nobel de littérature attribué à Yasunari Kawabata, 1969 à Samuel Beckett, et 1970 à Alexandre Soljenitsyne, Yourcenar ne mentionne aucun des trois.
Le cœur de cette correspondance consiste en une défense et présentation de son œuvre, ici essentiellement L’œuvre au noir qui paraît aux éditions Gallimard en 1968 et obtient le Femina, mais aussi de quelques romans antérieurs (Le coup de grâce, Mémoires d’Hadrien). Pour L’œuvre au noir, elle ne cesse de donner des instructions de publication, de corriger (au risque d’apparaître d’« une méticulosité pédantesque »), de veiller sur de futures « bonnes feuilles », de choisir les illustrations de couverture… bref de tout vouloir contrôler jusqu’au matériel pour les « étalages de librairies » et l’interprétation du roman. Elle suggère le nom des critiques qu’elle aimerait voir sollicités et, après la parution des articles, leur envoie souvent un mot de remerciement ou des corrections, allant parfois jusqu’à exiger d’un journal un droit de réponse quand un article lui semble avoir manqué le propos de l’ouvrage. Elle porte un soin particulier à réfuter des doutes sur l’exactitude des faits qu’elle présente (L’œuvre au noir se déroule au XVIe siècle) et renvoie épistolairement dans les cordes les spécialistes (ou pas) qui s’étonnent de ce qu’elle dit sur l’évolution des métiers à tisser, une question particulière de théologie, le mode d’exécution des condamnés ou l’emploi d’un mot par un personnage… Son érudition semble sans défaut.
Quant à l’interprétation du roman lui-même, elle la répète et la module lettre après lettre, bien déterminée à ce que l’exégèse critique aille toujours dans son sens. Gabriel Marcel (qu’elle sollicite pour un article), Maurice de Gandillac et d’autres correspondants moins connus se voient dicter comment il convient de le lire. Il est « difficile à définir » mais parle de « l’aventure secrète d’un esprit [celui de Zénon, personnage principal de « médecin, alchimiste, artificier, astrologue »] à travers les faits extérieurs […]. Plus on avance [dans la lecture] plus on s’enfonce dans un domaine pas très distinct de celui de la philosophie et même de la théologie ». On y découvre comment « la condition, la pensée et la sensibilité humaines [se] manifeste[nt] à travers les modes et les incidents d’un siècle ». Le roman, fait-elle savoir, est une quête spirituelle, à la fois « le pendant et l’entier contraire » des Mémoires d’Hadrien.
Zénon y est une sorte d’idéal pour Yourcenar, un être qui, confronté à l’atrocité du monde, questionne et s’oppose indéfectiblement dans un complet oubli de soi et de la gloire. Bien sûr, elle n’est pas Zénon et rejette tout rapprochement mais elle est comme son héros taraudée par l’exigence morale et spirituelle. Si d’abord son dégoût du monde moderne l’a poussée à hériter des facilités et des amitiés conservatrices ou réactionnaires typiques de son milieu, elle a été poussée ensuite vers une sympathie aux autres assez grande : ici elle parle d’ engagement pour la protection de la nature et des animaux (les fameux bébés phoques), de sa compréhension pour 1968, de son opposition à la guerre du Vietnam, du soutien aux minorités (même si elle juge le Black Power « raciste »)…
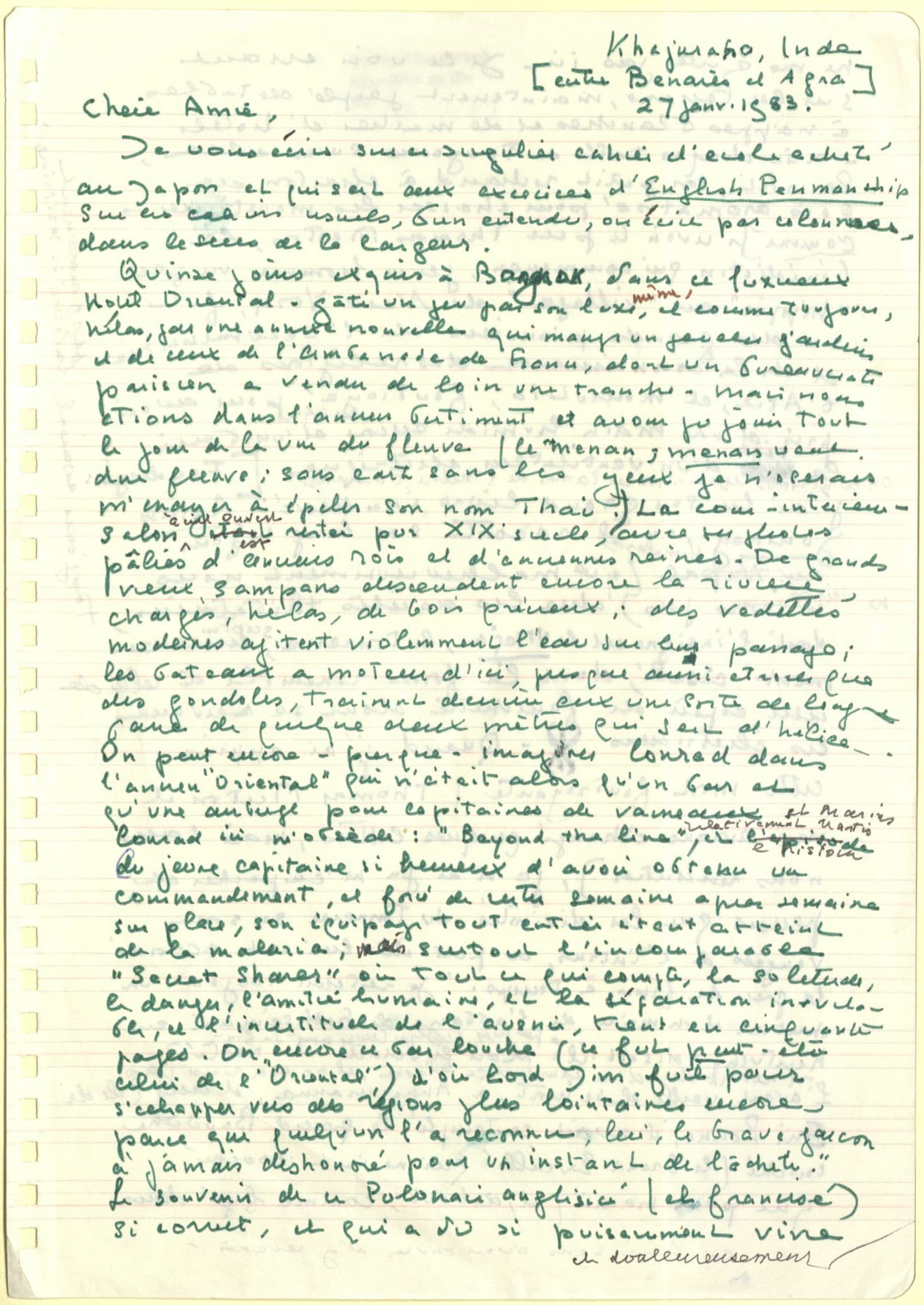
« Engagée », donc, mais tout en restant la solitaire de Petite Plaisance qui jardine « en pantalon de laine et jaquette de forestier » ou nourrit les redpolls de passage. En arrière plan très lointain apparaît Grace Frick, sa compagne pendant quarante ans, mais qu’elle présente toujours comme « une amie ».
La note comique n’est pas absente de ces neuf cents pages de lettres et vient du récit de la relation ratée entre l’auteure et un jeune critique dont elle avait aimé un article et accepté qu’il rédigeât un ouvrage critique sur elle. Après une première rencontre à Paris, des contacts épistolaires amicaux et l’échange des portraits de Rodogune et de Valentine (leurs chiennes respectives), le jeune homme débarque à Petite Plaisance magnétophone sous le bras et « une lourde serviette contenant… des centaines de pages de notes de lecture non classées et…inutilisables ». Tout se passera très mal et nous en sourions au fil des missives ulcérées de Yourcenar.
Mais le sourire n’est en général pas de mise au cours de la lecture de ce tome où fascinent avant tout, bien qu’un peu effacés par l’abondance des propos « d’affaires », le cheminement de l’auteure, sa recherche d’un humanisme ouvert sur l’autre, sa conscience de la place limitée des humains dans l’univers. L’autoritarisme de Yourcenar, sa férocité et son intransigeance pointilleuse frappent alors moins que son formidable désir d’un « enrichissement de l’âme », lequel lui est toujours apporté, malgré le limpide pessimisme dont elle fait preuve, par le travail et l’étude, les arts, les amitiés, les voyages et une vie rustique dans un des derniers endroits du globe qu’elle jugeait « admirable » parce qu’il n’avait pas encore été trop endommagé par l’homme.












