Si l’on retrouve dans les deux derniers romans de Russell Banks – Le royaume enchanté et Oh, Canada – tous ses thèmes habituels, ils sont mis en scène dans des récits incroyablement composés qui interrogent l’écrivain sur ce qu’il est et ce qu’il peut. Testamentaires, distanciés, réflexifs, ardus, ils parachèvent une œuvre lucide et courageuse. On lira et on parlera de ces livres autrement, un peu à la manière d’Italo Calvino.
Tu as entre les mains le dernier roman de Russell Banks, tu sais, le grand écrivain social américain, celui qui a écrit Continents à la dérive et De beaux lendemains, dont tu as vu il y a longtemps l’adaptation au cinéma d’Atom Egoyan qui te l’a fait connaître. Tu es assis dans ton salon, avec un bon verre de whisky et tu vas commencer son roman posthume (qui a paru en anglais très peu avant sa mort, il y a un an) et, comme chaque fois que tu vas entamer le dernier livre d’un grand écrivain, tu trembles un peu. Tu l’entames avec une certaine appréhension, avec la tension de retrouvailles, comme si tu en attendais quelque chose… C’est ainsi avec les écrivains familiers et que l’on aime. Tu as encore le goût de son roman précédent, un peu aride et crépusculaire, dont le titre, emprunté à l’hymne national canadien, t’avait surpris à sa sortie l’an passé, Oh, Canada…

Tu commences donc à lire Le royaume enchanté, grand format Actes Sud, pas le plus grand mais presque, presque 400 pages denses en perspective, avec toute la soirée devant toi. Tu es confortablement installé dans un fauteuil, les chevilles croisées, une couverture très douce sur les jambes, ton verre de whisky posé près du pied avant droit, le chat pas loin. Tu découvres alors le prologue du livre dans lequel Banks t’explique comment il s’est trouvé en possession de cassettes magnétiques et comment il se fera le scribe d’un dénommé Harley Mann qui aurait enregistré sa biographie au tout début des années soixante-dix, revenant sur le parcours de sa famille au début du siècle dans une Floride encore ensauvagée, sorte de terre promise incroyablement âpre.
Tu es frappé, immédiatement, par la place que s’assigne le romancier, celle d’une figure qui s’intercale dans le récit, car, assure-t-il, il a trouvé dans ces enregistrement, dans ce récit qu’il reprend – et tu sens bien que tout réside dans cette opération de restitution, tu es un lecteur un peu averti –, de « nombreux parallèles troublants et autres similitudes entre ma propre histoire et celle de Mann ». Tu te dis que, comme procédé, ce n’est pas bien nouveau, que ça fait belle lurette que les écrivains procèdent ainsi, par ce subterfuge, usant de ce dispositif indirect. Mais ce truc de romancier te surprend de la part de Banks qui, pendant toute sa carrière, n’en a pas usé, y préférant des fictions directes, enveloppantes dirais-tu, de celles qui entrainent le lecteur d’une manière absolue, évidente et franche. Tu te dis alors que, peut-être, c’est un roman différent des autres, que tu dois le lire autrement, y penser autrement. Et, comme tu essaies d’être un lecteur à peu près lucide, de te méfier de ta réaction, le lire avec une attitude différente de celle que tu as quand tu lis des livres que tu aimes beaucoup comme Affliction, Trailerpark ou Pourfendeur de nuages.
Voilà le grand enjeu de cette histoire, comment faire de la vie un récit, comment lui trouver une voix.
L’histoire donc – Le dernier royaume, c’est la longue confession enregistrée d’un vieil homme qui revient sur son enfance et sa jeunesse. Sur les pérégrinations avec sa mère et sa fratrie qui, au gré des difficultés de la vie au début du XXe siècle, atterrissent dans une communauté religieuse dans les marais d’une Floride sauvage et inhospitalière. Cette secte a banni la propriété et elle obéit à un système social utopique – chacun glosera cet enjeu essentiel du roman – et oblige ses membres à une abstinence sexuelle totale. Fasciné et effrayé par le chef de cette communauté, le jeune Harley fera toutes les expériences de la vie et l’apprentissage contraire de la liberté. Il tombera amoureux, affrontera la hiérarchie sociale, défiera Dieu, apprivoisera le capitalisme et trahira ceux qu’il aime… Et toute sa vie sera hantée par une faute qui ne passe pas, qui ne peut passer que dans son inscription dans le récit d’une vie, de sa vie. Car voilà le grand enjeu de cette histoire, comment faire de la vie un récit, comment lui trouver une voix.
On lira ce livre autrement donc ! Depuis son récit autobiographique intitulé Voyager, Russell Banks a changé. Non pas sur le fond de ce qui l’intéresse ou de ce qu’il raconte – ses derniers livres, au contraire, ont quelque chose d’un peu ressassant et une dimension assumée de récapitulation – mais dans la forme qu’il adopte, une forme indirecte, distanciée, presque secondaire. Spontanément, tu dirais que ces deux derniers romans – les moins romanesques de leur auteur – ont quelque chose de testamentaire, comme si l’écrivain se devait de se trouver une place dans la mécanique même de la fiction, comme s’il devait expliquer des choses, recoudre ensemble – tu apprécies bien cette image-ci – des enjeux ou des obsessions qui hantent ses romans depuis les années 1970 et qui doivent trouver un écho dans la conscience de l’écrivain qui se démasque ou s’expose enfin.
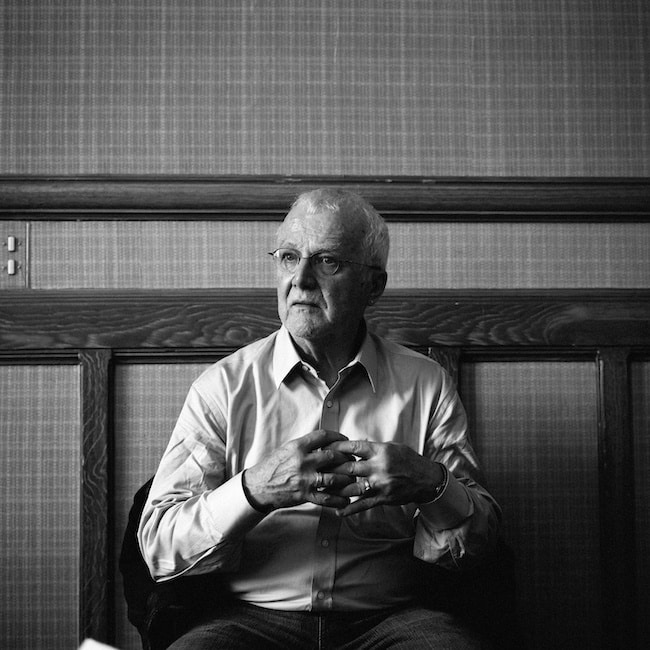
Est-ce une réaction à une angoisse de la fin ou bien un moyen de relancer la machine romanesque ? Tu ne sais pas bien, pour tout dire. Mais, sans choir dans une psychologie de mauvais aloi, il faut bien voir que la très bonne idée de Banks consiste à parler de soi de manière indirecte, de réfléchir son œuvre et la nature même du récit romanesque par les moyens propres de la fiction. Car, comme nombre de très bon écrivains états-uniens, Philip Roth en tête, Banks excelle dans la composition des romans et brille par la virtuosité avec laquelle il en manie tous les outils et toutes les formes. En racontant l’ultime série d’interviews que donne un cinéaste adulé autour de la confession de sa fuite des États-Unis pour échapper à la conscription au moment de la guerre du Vietnam, dans Oh, Canada, roman dans lequel la composition, la reprise, le commentaire, l’auto-analyse, le récit dans le récit sont entièrement tendus vers l’éclaircissement de la manière dont un artiste crée des récits ou impose des écrans entre lui et la réalité, lui et les autres, sur comment l’artiste peut tenir un discours, penser son propre travail, explorer ses obsessions…
Le résultat est un peu glaçant, abrupt pour le moins. Peut-être parce que le roman devient le véhicule d’une réflexion qui a pour objet de s’exhiber, de s’assumer en tant que geste accueilli par la fiction. Et c’est la même tension, le même mouvement, qui habitent Le royaume enchanté. Car en racontant l’histoire de Harley Mann, se glissant dans sa voix même, Banks raconte et reconfigure ce qui l’obsède dans l’histoire de son pays et sur la manière dont des individus – plus ou moins libres, plus ou moins conscients d’eux-mêmes – s’y débattent sans fin, faisant face à des choix moraux qui les définissent de manière absolue. On retrouve tout de l’univers des fictions de Banks – quel que soit leur sujet, l’époque où ils se situent, que ce soit des hommes ou des femmes qui les portent –, tout de ses obsessions et de ce qui, pour lui, fait la nature d’une nation paradoxale, terriblement violente et injuste, de sa vision d’un monde travaillé par des tensions presque insurmontables.
Russell Banks parvient à une hauteur méditative, une sorte de recul sur soi-même en tant qu’homme mais aussi en tant qu’écrivain (à moins que ce ne soit le contraire).
Il y a dans cet ultime roman, dans l’espèce d’épopée existentielle de Harley Mann, tout du roman historique, du récit de formation, de la fable sociale et morale. Ce n’est pas rien comme ambition, te dis-tu en achevant ce gros livre que tu lis assez vite alors qu’il ne s’y passe finalement vraiment pas grand-chose. Il constitue en quelque sorte, pour Banks, une sorte de synthèse romanesque – mais mise à distance, auscultée avec une certaine férocité. On retrouve ses thèmes fétiches – la fuite, la découverte du Sud, la question de la communauté, de sa confrontation avec un sujet qui la disloque, la croyance politique qui relève de la foi et qui mène à la faute, la brutalité corruptrice et perverse du capitalisme, la solitude fondamentale des hommes, la pulsion sexuelle et ce qu’elle fêle du réel, l’indignation et la résistance, certes souvent vaines, face à un ordre du monde qui broie l’individu… On trouve dans ce livre toutes les qualités de Banks : la manière dont il allie la puissance de la fresque à la finesse de la psychologie, dont il fait avancer ensemble l’histoire individuelle et les grands mouvements qui structurent son pays, son souci du détail, sa qualité de voix, la manière virtuose dont il manie la composition du récit et dont il la met ici clairement en scène.
Et ce n’est pas un hasard si ces deux derniers livres sont habités par la faute, par le sentiment de culpabilité qui fait basculer, non pas la vie en fait, mais le récit que l’on en fait. Car si ce sentiment traverse presque tous les livres de Russell Banks – des remords des personnages de De beaux lendemains ou celui d’American Darling aux errements de John Brown et de son fils dans Pourfendeur de nuages ou les pulsions qui habitent Lointain souvenir de la peau –, il est ici exposé non pas comme un thème mais comme le moteur même du récit. C’est à son aune qu’il faut lire le roman, cette fresque politique et existentielle effarante qui, comme la confession du cinéaste de Oh, Canada, semble déborder du cadre. Car, finalement, de quoi parle Banks dans ces romans si ce n’est de lui-même ? Ou pour le moins d’une figure qui s’interpose dans le récit même, se révèle, s’expose enfin à la vue de tous.
C’est hardi, assurément ! Mais il y a là quelque chose de dur, d’ardu, que tu trouves âpre, raide. Russell Banks parvient à une hauteur méditative, une sorte de recul sur soi-même en tant qu’homme mais aussi en tant qu’écrivain (à moins que ce ne soit le contraire). À tel point que l’on se demande souvent ce qu’on lit, que l’on questionne la nature même du texte. C’est que l’écrivain y réduit au maximum la séduction romanesque pour en exhiber, en analyser la mécanique, en jauger la portée, revenir sur les illusions du créateur, son espèce de folie prométhéenne. Il assume de revenir en arrière, de s’exposer radicalement, comme l’aridité de livres peu séduisants, affronte une certaine nudité de son œuvre et de lui-même. Dans une sorte de transposition infinie, toujours redite, il assume une fiction qui récapitule ce qu’il écrit, les moyens qu’il a trouvés, au fil du temps, toutes les expériences qui portent de grands et beaux romans. Tu te dis qu’il faut pour cela une lucidité assez terrible et un courage exemplaire.












