Comment sont entendues les femmes soumises à des violences dites domestiques par le tribunal civil ? se demande Solenne Jouanneau dans Les femmes et les enfants d’abord ?. L’enquête porte sur l’ordonnance de protection de 2010 qui devrait permettre de « sécuriser la séparation » d’avec le conjoint maltraitant. Avec Les femmes du coin de la rue, Patricia Bouhnik enquête au plus près de celles qui sont déjà séparées et rendues muettes, réduites aux figures déviantes du féminin. Son ouvrage nous conduit vers des scènes de rue, où chacune d’elles cherche à se cacher plus encore. Enfin, Carol Gilligan développe une éthique de résistance et de libération qui commence par l’écoute radicale.
Ces trois ouvrages démontent – chacun à sa manière – les mécanismes du devoir-taire. Comment disparaître, se masquer, éteindre l’incendie, retenir les mots, se couvrir et s’éclipser, s’enfermer en cas de danger, écarter la menace ou le chantage, échapper à l’accusation en somme. « Savoir s’effacer » serait-il un art genré ?
Le droit ne cesse de se cogner à des corps en mouvement. Il se heurte aux transformations des sensibilités envers les femmes « en danger ». Mal armés, les magistrats entendent peu les menaces psychologiques en deçà des coups, des chocs et des blessures. Comment entendre la vérité de l’abus, du chantage, de la faiblesse économique, de la domination, tant que le langage du droit l’enfermera sous la cloche du seul « conflit familial » ? Combien de fois les femmes devront-elles répéter les mêmes choses, dans différentes instances, dire et répéter les détails de ce qui a eu lieu et continue d’avoir lieu ? Comment élargir les vues des magistrats, pour une prise en compte des « atteintes » à la volonté des femmes, la captation de leur décision, les barrages faits à leur autonomie ?
Du combat féministe à la cause publique, les violences au sein du couple ont été peu à peu « déprivatisées » depuis que le caractère « aggravé » des actes de maltraitance est entré dans la loi. Problème public ? Solenne Jouanneau étudie – au-delà de la punition – comment protéger matériellement les femmes et les enfants par une audience en urgence afin de les faire bénéficier de plusieurs mesures de protection : être autorisé à dissimuler son adresse ; interdire à l’agresseur de posséder une arme ; lui interdire d’entrer en contact avec les personnes protégées ; enfin organiser autrement les relations avec les enfants, notamment leur garde.
L’ouvrage enquête dans plusieurs tribunaux, dresse des statistiques, épluche des décisions de justice, entend des magistrats, explore les formations des juristes. Massivement, à plus de 80 %, ce sont des femmes pauvres économiquement qui font appel au dispositif des ordonnances de protection. Sans ressources propres, elles ne peuvent s’extraire du danger, se dégager du chantage, se retirer des pièges. Sont-elles pour autant entendues ? Comme l’explique un juge : « On ne nous demande pas de juger de la réalité des violences. On nous demande d’apprécier la vraisemblance des violences, qui peuvent être physiques, mais pas seulement, elles peuvent aussi être psychologiques par exemple, ce qui est encore plus dur à évaluer ; et si cette violence place une personne, ex-conjoint ou conjoint, dans une situation de danger. » L’embarras est de mise.

L’enquête se loge dans cet écart. On entre dans le bureau du juge aux affaires familiales qui interprète les critères d’appréciation énoncés par la loi. Et de se prononcer sur les seuils de la violence – suffisamment grave ou pas – pour engager ou écarter une protection en urgence. Car 60 % des demandes de protection seront rejetées ! En matière civile, on découvre que les mots sont en bataille. Cent fois on s’interroge. Qu’est-ce qu’une relation de couple, une violence conjugale, une tension, un danger, un risque ? Et les magistrats de fouiller certes les codes civil et pénal, mais aussi l’intranet des tribunaux, les définitions mises en circulation par l’action publique en matière de « lutte contre les violences faites aux femmes » ; les actions de communication gouvernementale ; les cours d’appel ou les délégations régionales à l’Égalité Femmes-Hommes ou encore l’Observatoire des violences envers les femmes. Bataille de définitions, à chacun son langage. « En quoi une violence conjugale, demande un magistrat, serait séparable des conditions de logement, de l’argent qui manque, du souci des enfants ? » Ah non, répond un second : « Les violences physiques donnent lieu à des constatations physiques, des certificats médicaux. En matière de violence psychologique, c’est beaucoup plus compliqué à retenir. Ça crée trop d’hésitations. Et la problématique de preuve ? Pour ma part, j’admets plus facilement le concept de violence psychologique en plus des éléments permettant de croire aussi à des violences physiques ».
Les jugements tremblent. Il en découle que sur 6 000 demandes par an, 40 % sont refusées. Entre conflits conjugaux, disputes parentales, violences conjugales, les juges se heurtent à des événements, tentent de les empoigner, glissent sur des affects contraires, alors les mots souvent se désagrègent. La violence s’envole vers d’autres contrées ! Pour les spécialistes des violences de genre, la différence entre « le conflit » et « la violence » tient à la nature de la relation qui unit les deux partenaires. Est-elle égalitaire ou inégalitaire ? Est-elle ou non basée sur la recherche du contrôle et de la domination de l’autre ? Rien à voir avec la démarche des magistrats qui dessine tout autrement la frontière entre le conflit et la violence : les faits de violences ont-ils une cause ? se demandent-ils. Peut-on imputer la responsabilité de ces actes de violence à une seule des deux parties ? Sont-ils suffisamment graves pour justifier l’impossibilité d’une démarche de conciliation ? Et après, comment déterminer les conditions d’organisation de la séparation et les droits qui seront accordés à chaque partie? Qui va garder le logement à son nom ?
Ces questions sont d’autant plus fortes chez les juges qu’ils se méfient des scènes entendues, soupçonnent des chausse-trappes, hésitent entre le droit des enfants et un risque de manipulation puisque l’ordonnance permet d’obtenir des droits spécifiques tout en en retirant à l’auteur vraisemblable des violences. Ainsi, pour les couples pacsés ou les concubins, l’attribution du logement commun ne relève normalement pas de la compétence du juge. Selon la même logique, les chances d’obtenir l’exercice unilatéral de l’autorité parentale, la suppression du droit de visite ou la mise en place d’un droit de visite avec un médiateur sont beaucoup plus importantes dans le cadre de cette procédure que dans les procédures classiques.
Dès lors, les violences dénoncées font l’objet d’une hiérarchisation implicite. C’est en particulier le cas des violences physiques dites « légères » et des pratiques de harcèlement psychologique, notamment lorsqu’elles sont interprétées comme une conséquence des « conflits » générés par la séparation du couple. Les jugements dansent entre « violence conjugale » et « conflit conjugal », dans une pesée largement aveugle aux enjeux de la domination masculine. Il ne s’agit plus de protéger les femmes qui le demandent mais de fixer un seuil de violence variable dans le couple, un quantum socialement et juridiquement tolérable. De sorte que les violences se trouvent profondément remaniées à travers un filtre, une méthode de traduction de « ce qui s’est passé ». Un nouveau voilage, en somme. Car le magistrat travaille à l’horizon de la plus simple preuve, ce qui a pour effet de « donner la prime à l’hématome et aux bras cassés parce que c’est bien clair, bien net », confirme une magistrate. À l’inverse, la notion de « vraisemblance » ne favorise pas la prise en considération des violences psychologiques ou verbales qui, si elles n’ont pas été commises devant témoin ou enregistrées, ne laissent que peu de traces. Le vraisemblable, de quoi s’approcher du doute, de l’incertitude, d’une sorte de neutralité qui fait baisser la tête sur ses chaussures. De sorte qu’en 2024 cette ordonnance de protection des femmes fléchit et s’incline. À peine quelques centaines. Entendre les femmes, au tribunal civil : le chemin est encore long.
Hématomes et bras cassés ? Et après ? Que se passe-t-il pour certaines d’entre elles ? Pour celles qui n’auront pas été protégées ou pour qui la protection de la justice aura été absente ? Nombre de femmes au fil des ruptures se retrouveront sans domicile. Bien après les séances au tribunal, l’ouvrage de Patricia Bouhnik propose une cartographie de la ville et de ses « femmes de la rue » : « je suis partie de ces disparitions-là pour tisser le fil des histoires, recouper les contextes et déterminants et tenter de restituer la force des expériences et capabilités engagées ».
Ruptures familiales ou conjugales, perte d’emploi, placement des enfants, exil, expulsions. Ces femmes n’ont pas osé porter plainte ou la police n’a pas voulu les entendre. Certaines ont frôlé la mort, elles ont réussi à partir, s’appauvrissant encore. D’autres vivent ces violences au quotidien, taillent une pipe contre une dose de crack. Le déclassement se mesure aussi à des formes successives de dépouillement. Partie avec trois valises dans lesquelles Cathy a rangé son passé, il ne lui en reste plus qu’une aujourd’hui. La vie entière de Coralie tient, quant à elle, dans un sac à dos. Awa et Farhia n’ont plus de sac du tout.
Les femmes – dans ce paysage de désolation – complètement oubliées ? De l’école à la psychiatrie, du centre de protection maternelle au médecin généraliste, les systèmes d’alerte ne sont pas branchés les uns aux autres. Les femmes se murent. Comment s’en étonner tant on leur a appris à souffrir en silence. Disparaitre est la seule issue. S’enfermer en cas de danger : la menace subie, le chantage, le trafic, l’argent si rare, les excès. Se retirer sur la pointe des pieds, le sacrifice ultime. Au bout de l’oubli, de l’endurance et de la survie, invisibles et monotones comme la prison ou la prostitution, ces filles, ces femmes, ces mères, ces grands-mères échangent avec Patricia Bouhnik d’une manière incomparable. Le miroir narratif coupe le souffle.
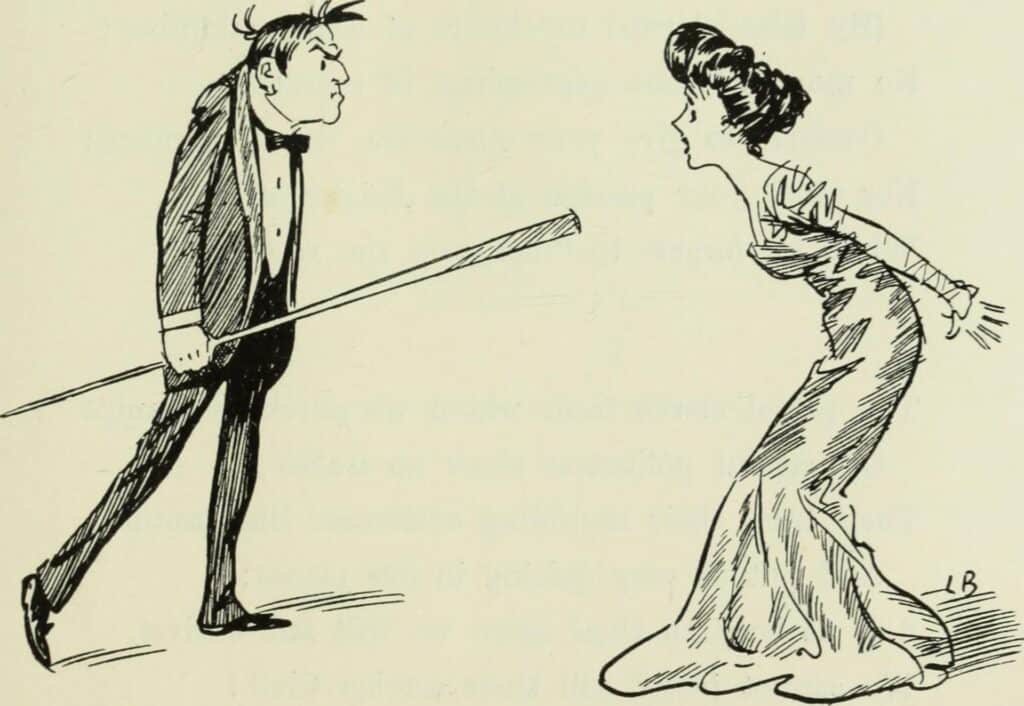
À la dérive on les suit. Il s’agit pour elles de marcher sur les frontières des zones de passage – chambres d’hôtel, compagnons de fortune –, des points de replis sur des recoins – embrasures, bancs, friches, stations de métro, gares – ou de rejoindre des regroupements discrets en squats ou chambres proposées dans des foyers, hôtels sociaux, centres d’hébergement d’urgence ou associatifs, appartements vétustes ou précaires ; avec parfois un passage en prison ou aux urgences psychiatriques. La tournée de ces lieux éclaire les nuits de dépendance et de pénitence. « J’ai mal partout, tout le temps, susurre Nadia qui a 22 ans. Les enfants sont tout le temps fatigués et malades, on ne s’arrête jamais, on va d’un endroit à l’autre pour manger, demander, on est tout le temps dans la rue, c’est très difficile… J’attends dans la rue, je me cache, des fois, quand je vois la police. Neige, pas neige, beau pas beau, c’est tous les jours la même chose. Je mange dehors, les enfants c’est pareil que moi, comme tout le monde… Quand il fait très froid c’est le plus dur ». Ne jamais s’arrêter de circuler. Passer de lieu en lieu en courant, c’est le prix à payer pour gagner une petite sécurité sans agression, en évitant l’insulte de « mauvaise mère », en attendant un pli de rue, un recoin ou un bout de chambre pour se réfugier.
Et une pluie qui tombe. Incapables, incompétentes, indigentes, indignes, infâmes, la liste est longue de ces forces négatives qui peuplent ces dominations souterraines, avec ces mots mi-juridiques mi-psychiatriques qui hantent le langage institutionnel jusqu’à contaminer le plus ordinaire des gestes. Cette série des « in » marque les actes moteurs autant que les actes mentaux. Dans ces interstices, le droit n’agit qu’en « négatif sur » les modes de repos, les circulations, les recoins, les manières de se laver, d’aimer même. Femme vieille, seule, sans attache, pauvre de surcroit, mal née et mal aimée, chaos humain comme autant de cicatrices, dans ce sous-sol strié de menaces existentielles imminentes. Le retrait du droit de ces espaces de danger accentue les effondrements. L’idée même de « non-assistance à personne en danger » se dissout dans le caniveau. Ce serait la faute à « pas de chance » ?
Nous sommes bien entre l’implicite, le non-dit, le devoir-taire que l’on nomme à tort le silence, autant dire le dernier maillon de la traque. Nous sommes bien au bord du féminicide. Discret, celui-là.
Faire revenir les voix des femmes dans la conversation humaine et dans les arènes sociales ? Psychologue et philosophe, auteure d’un ouvrage de référence en sciences humaines, Une voix différente (In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, 1982, trad. fr., Flammarion, 1986), Carol Gilligan poursuit cette idée en toute modestie dans Une voix humaine, sorte de conversation chaleureuse envers les femmes et toutes les populations assignées et rendues invisibles. Peut-on changer la tonalité de cette conversation ? se demande-t-elle, donner voix aux expériences humaines qui ne sont ni parlées, ni vues. Pour ce faire, ne faut-il pas un changement dans l’organisation ou la structure même de la conversation, qu’elle porte non seulement sur le genre mais aussi sur le soi, les relations avec les proches, l’interdépendance, la morale ?
Avec Carol Gilligan se prolonge une réflexion sur le silence et la parole, sur la différence entre le fait de pouvoir s’exprimer et celui d’être entendue, sur l’écoute radicale comme acte politique. Dès lors, l’écoute est une manifestation de l’éthique du care : faire attention, répondre précisément aux questions, prendre au sérieux et résister au cadre patriarcal de ses propres réponses. Cultiver la voix et l’écoute, n’est-ce pas exercer justement une éthique de la démocratie ? Néanmoins, cela suppose tout un travail sur ce fameux cadre patriarcal, les fenêtres étroites de qui doit être entendu (la voix du père) ou pas, notamment dans les chaînes de grande vulnérabilité exposées dans les deux ouvrages précédents. Penser et ressentir, dire et savoir, autant d’oppositions par lesquelles la voix de l’expérience est perdue ou discréditée, déplacée par une autre voix, détentrice d’une autorité – le patriarcat – que l’on prend pour sienne. C’est dans ce plissement que se tient l’écoute radicale suggérée par Gilligan, « une façon de s’accorder à la voix sourde, sous-jacente, à cette autre conversation qui se joue entre les lignes de dialogue ». L’auteure s’attache ainsi à promouvoir des voix de résistance, dans des situations concrètes et pratiques, une attitude de « sollicitude » envers toutes les positions de vulnérabilité, une éthique attentive aux singularités et non pas impérative et impersonnelle. Se rejouent ainsi les questions un peu plus compliquées qu’il n’y paraît : « qu’est-ce que parler veut dire ? » ; « qu’est-ce que prendre la parole offre comme perspective et à quel coût ? » ; « qui donne ou retire la parole ? ».







![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)




