Parmi les idées reçues les plus tenaces concernant le Moyen Âge, figure en bonne place celle d’un monde violent, dans lequel guerres, rapines et meurtres faisaient loi. On ne peut pas vraiment dire que Game of Thrones ait permis au grand public – conscient néanmoins qu’il s’agissait d’heroic fantasy et non d’histoire – de changer d’imaginaire ou, mieux encore, de réviser ses conceptions. C’est précisément ce à quoi s’emploie magistralement Régine Le Jan dans Amis ou ennemis ? Émotions, relations, identités au Moyen Âge. Cette synthèse est d’une ampleur inédite, d’une amplitude chronologique, spatiale et documentaire époustouflante, comme seuls les historiens les plus aguerris peuvent en produire au terme d’une carrière accomplie.
« En choisissant la perspective de la rationalité », Régine Le Jan rend justice à la complexité des relations médiévales, aux identités plurielles – celles des élites du moins, car les sources et le livre parlent peu du reste de la population, sauf quand il est question des confréries religieuses et des guildes marchandes – et aux émotions individuelles. Là où d’autres ont vu de l’inconstance et de l’impulsivité – de celles que nous prêtons volontiers aux enfants –, elle montre au contraire la place des stratégies d’alliance et la maîtrise par chacun et chacune de son réseau relationnel.
L’historienne nous prémunit d’emblée contre toute tentation évolutionniste qui consisterait à voir dans nos sociétés modernes le point d’orgue d’un processus de « civilisation des mœurs » (on aura reconnu la thèse, souvent critiquée, de Norbert Elias), et un progrès, dans le temps long, du contrôle de nos émotions et de soi par rapport à un passé médiéval considéré comme l’enfance de l’âge, au cours de laquelle les individus auraient été esclaves de leurs passions. Depuis une vingtaine d’années heureusement, l’histoire des émotions dont se réclame Régine Le Jan a remis en cause cette conception « hydraulique » des affects. Mais le refus de l’évolutionnisme rime aussi avec le « décentrement du regard » et consiste, à l’invitation des anthropologues, à se départir de nos catégories de pensée, en particulier de notre conception individualiste de la personne, pour mieux rendre compte du système relationnel de la société étudiée. Régine Le Jan emprunte ainsi à Marshall Sahlins la conception d’un moi disséminé dans d’autres êtres, à la fois coprésents et interdépendants, à Marilyn Strathern et Eduardo Viveiros de Castro leur concept de « personne relationnelle », et à Philippe Descola sa définition d’une ontologie analogiste dans laquelle tous les êtres sont distincts mais liés entre eux par un système de correspondances, pour montrer que les acteurs du haut Moyen Âge agissent toujours selon un rôle défini par une relation de haine ou d’amitié.
Conformément à l’approche « émique » des anthropologues, l’auteure repart dans le premier chapitre des catégories « indigènes », c’est-à-dire des mots employés dans les sources et du sens que leur donnent les acteurs. Amare, notamment, dont viennent à la fois « amour » et « amitié », mais aussi dilectio, affectus ou encore caritas, qui, tous, renvoient au fait d’aimer. Dans un monde chrétien qui ne connaît pas directement la pensée d’Aristote, mais s’appuie plutôt sur Cicéron et saint Augustin, l’amitié est considérée comme une valeur unissant des personnes de bien (le plus souvent des hommes – dont le courage et la maîtrise de soi sont vantés – même si certaines femmes « viriles » comme des abbesses ou des souveraines peuvent aussi entretenir des amitiés). Cette amitié vertueuse – que les médiévaux distinguent de la fausse amitié, feinte ou détournée – n’a cependant plus pour horizon la Cité, mais la recherche du salut, dans le cadre d’une communauté d’égaux en quête d’amour divin. Si les sociétés germaniques sont structurées par la guerre, le christianisme invente donc une « religion de l’amitié » moins tournée vers la chose publique.
L’amour et la haine, à laquelle les termes d’odium et d’inimicitia renvoient, ne relèvent pourtant pas uniquement d’affects privés comme cela est le cas aujourd’hui, mais ont toujours une dimension publique. Leur expression même est ritualisée, que l’on pense au baiser sur la bouche, au serment ou au banquet, forme par excellence de l’amitié entre puissants dans de nombreuses sociétés. Pour l’auteure, on ne peut plus affirmer, comme le faisait Gerd Althoff, que ces gestes auraient été dépourvus d’affect, ni mettre en doute leur caractère émotionnel [1]. La performativité des rites « ne venait pas d’un respect mécanique des codes ni du formalisme de gestes qui obligeraient, mais de l’inversion des affects sanctionnée par des gestes transformateurs ». De même, les changements de rôles ou d’alliances, les revirements ou les trahisons, s’exprimaient publiquement (alors que nous passons aujourd’hui d’un état à un autre sans être dans l’obligation de le faire savoir), comme en témoigne la fausse réconciliation orchestrée par l’évêque de Constance et abbé de Saint-Gall au début du Xe siècle, qui humilie les deux comtes palatins qu’il a invités au banquet.

La haine elle-même s’inscrit dans un jeu mêlant compétition et coopération entre rivaux, que l’auteure nomme « coopétition ». La veuve du comte de Montpellier, opposée aux moines de Conques à propos d’un domaine dont elle revendique l’héritage, finit par conclure avec eux un accord en échange d’une somme d’argent (vers 1030). Ce sont ces « cycles de compétition », dans lesquels pouvait entrer la vengeance, que Régine Le Jan s’efforce de reconstituer aux chapitres 4, 5 et 6 de son livre. Dans une « société de l’honneur » – dont l’acception morale est ici privilégiée par rapport à sa définition institutionnelle –, la vengeance s’apparentait en effet à un instrument de règlement des conflits. La faide, que Charlemagne interdira en 779, désignait ainsi la réparation légitime d’une offense, pouvant aller jusqu’à l’élimination physique du rival ou de l’ennemi. Mais le droit germanique offrait aussi aux parties la possibilité de régler leurs différends au moyen du wergeld (ou « prix de l’homme ») qui mettait un terme au cycle de vengeance. La violence, même extrême, n’avait donc rien d’irrationnel et obéissait à des règles, de même que la passion amoureuse, l’affection conjugale ou l’amitié masculine.
À l’autre bout du spectre, on trouve le don – expression publique de l’amitié – qui unissait les aristocrates laïcs aux communautés monastiques. En donnant leurs biens à celles-ci, les nobles en devenaient les « amis », à charge pour les moines de prier pour leur salut. Leurs noms étaient soigneusement inscrits dans les nécrologes ou libri memoriales, celui de l’abbaye de Reichenau n’en contenant pas moins de 38 000 ! Pour dire la puissance de cette Église vers laquelle affluent tous les dons, mais qui redistribue ensuite ces richesses aux pauvres et soutient le royaume par ses prières, Régine Le Jan emprunte à Ian Wood son concept de « société du Temple ». Mais elle montre bien qu’hors du cloître d’autres formes de proximité ou de « familiarité » ont existé. L’échange de cadeaux, par exemple, était à la fois un support et un symbole d’amitié, dans la mesure où les objets étaient porteurs des identités de leurs donateurs et permettaient la présence de l’ami à distance. La lettre aussi, généralement accompagnée de cadeaux, révélait la proximité, pour ne pas dire l’amitié. Elle avait du reste vocation à être lue devant d’autres, et l’on voit combien public et privé étaient interconnectés.
Au chapitre 6, Régine Le Jan montre bien que les relations pouvaient changer brutalement de nature, et que l’inimitié ou la haine n’étaient en fin de compte jamais loin de l’amitié et de l’amour. Était-ce faute de certitudes et d’institutions régulatrices, comme l’auteure semble le supposer ? Avec la fin de l’Empire, il est vrai que l’État disparaît, et avec lui l’horizon de la Cité, mais le pouvoir autocratique perdure, et la crainte est bien l’émotion politique qui fonde l’autorité. Chez les Mérovingiens, cependant, la grande faide qui débute en 561 affaiblit le pouvoir, et le roi doit compenser en développant « l’intermédiarité », c’est-à-dire en devenant l’arbitre des conflits entre grands. Vers 600, l’idée apparaît en outre que les « leudes » forment une communauté portée par les valeurs de paix et l’amitié, et qu’ils doivent jouer le rôle d’intermédiaires entre le roi, au centre, et les hommes libres, à l’échelle locale. La cour devient alors un creuset pour des personnes aux intérêts divergents, où les nobles assurent l’éducation de leurs enfants et tissent des réseaux. En même temps, toute forme de tension au sein du palais génère du « stress » et de la défiance, susceptibles de libérer les haines.
La nouveauté carolingienne ne réside donc pas dans le fait que les dirigeants entretiennent des liens d’amitié ou que la compétition soit régulée, mais bien dans l’intégration de ces relations à une représentation globale du monde comme un ensemble hiérarchique et unifié, en marche vers le salut. Se fixe alors un modèle d’autorité chrétien dans lequel le roi agit pour la foi et où l’ordre politique tient à l’amour de Dieu. La « familiarité » royale devient, qui plus est, un instrument majeur de gouvernement, dont la traduction matérielle la plus évidente est la distribution de faveurs. Les haineux ou les traîtres sont au contraire privés de leurs biens, comme lorsque Charles le Chauve confisque en 869 l’un des domaines de sa sœur Gisèle parce que celle-ci est mariée à Évrard de Frioul dont il cherche à démanteler les réseaux.
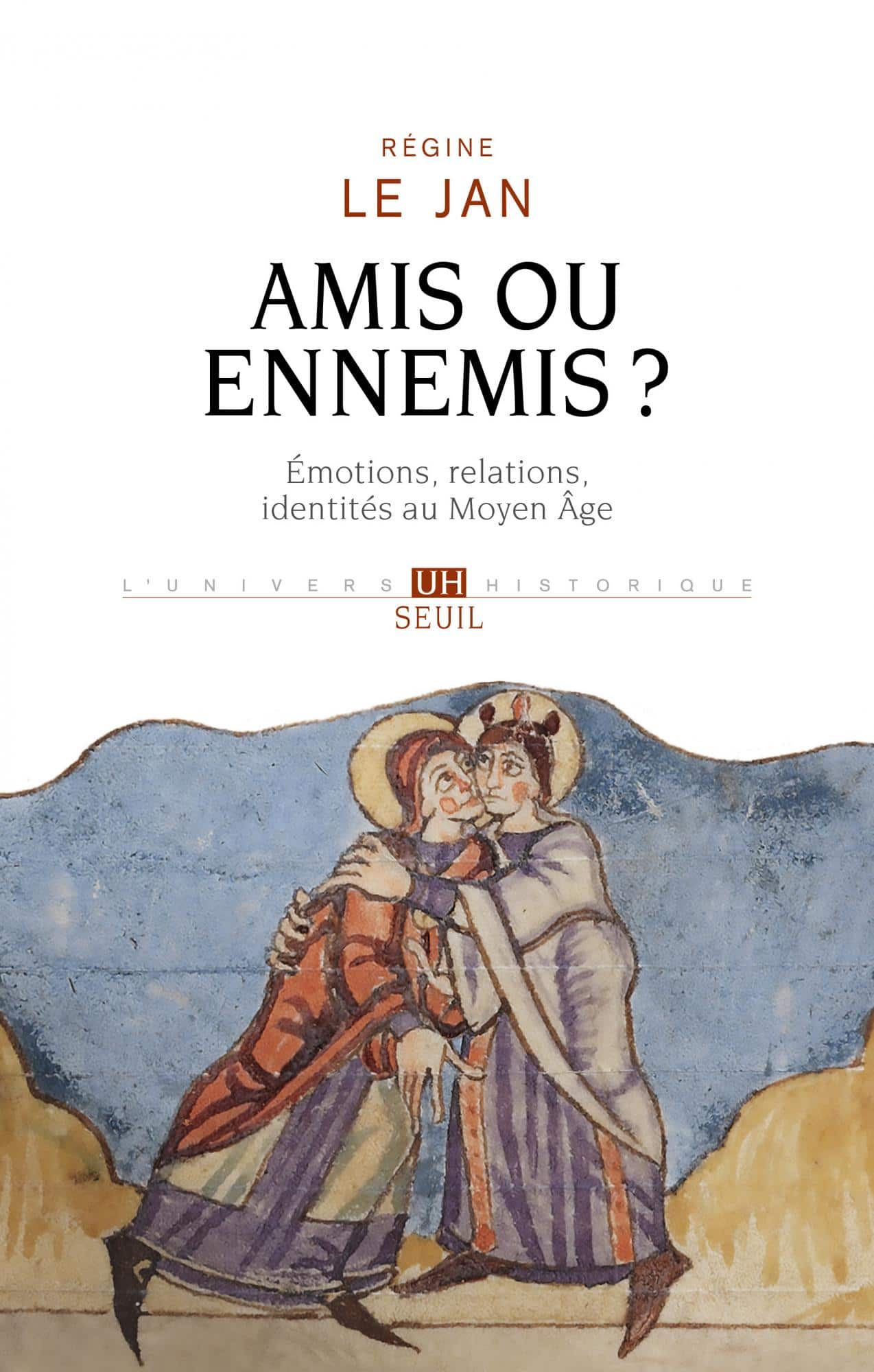
Avec la crise dynastique et la déconcentration progressive des pouvoirs, les princes reprennent à leur compte le projet d’amitié des Carolingiens, mais cette fois à l’échelle locale, dans leurs espaces de pouvoir respectifs. Les puissants recourent ainsi aux démonstrations d’affection, et les liens verticaux se renforcent dans le cadre de l’« amour féodal » qui désigne la fidélité entre le seigneur et son vassal (preuve, au passage, que hiérarchie et amitié ne sont pas conçues comme antinomiques). Les pactes, cependant, sont parfois contrariés, comme celui qui, dans les années 1020, unit le châtelain Hugues de Lusignan à son seigneur Guillaume V d’Aquitaine, qui apparaît dans les sources sournois et dissimulateur. Il faut alors rétablir la paix, un processus dans lequel les moines vont jouer le rôle principal en Francie dans les années 980-1020, tandis qu’en Germanie le roi affronte seul les révoltes et compose avec des rebelles, et que partout dans la chrétienté les femmes font office d’intercesseurs entre le pouvoir guerrier et le pouvoir épiscopal, voire entre le pape et l’empereur.
Dans le dernier chapitre, l’auteure évoque la diffusion au XIe et au XIIe siècle d’une nouvelle culture profane et de nouveaux codes affectifs qui caractérisent à la fois la relation entre le seigneur et son vassal, et celle du chevalier et de sa dame. Or il n’y a rien d’anodin à ce que ce changement se soit produit avec une intensité particulière dans une région – le Languedoc – où l’implantation de l’idéologie royale traditionnelle était faible et celle de l’idéologie grégorienne, au contraire, assez forte : au moment où les contraintes sur le corps et la sexualité se font plus rudes, cet idéal amoureux exaltant la féminité et l’amour hors mariage constitue une « réaction des laïcs face au totalitarisme de l’Église grégorienne qui imposait ses normes et sapait les fondements des échanges traditionnels au sein de l’aristocratie ». Si Régine Le Jan souligne les continuités entre la période carolingienne et la période féodale, elle voit dans la Réforme grégorienne une césure essentielle, marquée par la prétention croissante du pape à détenir une autorité supérieure, la séparation accrue entre les clercs d’un côté, dont la prééminence se fonde désormais sur la chasteté, et les laïcs de l’autre, auxquels obligation est faite de se marier, mais aussi par une exaltation de la parenté spirituelle au détriment des relations charnelles.
Qu’il nous soit permis de penser que la culture affective et le régime émotionnel des élites changent sans doute aussi sous l’effet de la cristallisation des États monarchiques européens. Si, à l’époque carolingienne, il est clair que l’« autorité régulatrice » du roi dessine un réseau de familiers, dont certains sont des parents, d’autres des alliés, il n’est pas question d’un État administratif, peuplé d’officiers aux ordres d’un souverain auquel les sujets eux-mêmes doivent obéissance quel que soit leur rang. Dans ces conditions, la parenté biologique joue un rôle prépondérant et la prolifération des pactes vise précisément à pallier l’absence de réciprocité « naturelle », tout en permettant aux princes de conclure des alliances distinctives. Au XIIe siècle, en revanche, la sphère publique s’autonomise sous l’effet de la redécouverte du droit romain, et s’en détache une sphère privée de la « conscience », adossée à de nouveaux dispositifs institutionnels tels que la supplique ou la confession – même si, faute de documents adéquats, il est difficile de mesurer l’expression de la subjectivité et, plus encore, l’intériorisation des affects. Cela ne veut pas dire que la contradiction entre culture de l’amitié et culture de la vengeance ne soit plus résolue par une « culture de la médiation » et « de l’intercession » héritée du haut Moyen Âge, mais que l’État et le droit constituent désormais la source du lien politique. On se prend donc à rêver d’une synthèse de même ampleur qui couvrirait le second Moyen Âge et ferait état des mutations des pratiques ou des conceptions de l’amitié.
[1] Gerd Althoff, « Du rire et des larmes : pourquoi les émotions intéressent-elles les médiévistes ? », Écrire l’histoire : Émotions, 2, automne 2008.
Arnaud Fossier est Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Bourgogne.












