L’analyse des relations entre deux grands jésuites du XXe siècle, Henri de Lubac (1896-1991) et Michel de Certeau (1925-1986), éclaire les difficiles relations entre théologie et sciences humaines et repose la question de leurs situations respectives dans une société post-chrétienne.
On peut s’étonner que l’on veuille encore, en cette première moitié du XXIe siècle, éclairer le débat entre la théologie (chrétienne) et les sciences humaines. Deux noms peuvent symboliser deux réactions et deux chemins différents, en réponse au défi de ce qui, au-delà d’une confrontation entre théologie et sciences humaines, semblait aboutir, du côté des secondes, à une sorte de mise hors jeu de la théologie, et du côté de la première, à une (sur)vie parallèle derrière une défense du caractère raisonnable de l’acte de croire, à l’issue de ce qui apparaitra peut-être aux historiens futurs comme la suite de la troisième [1] et jusqu’à présent dernière crise entre savoir positif et théologie.
Ces deux noms auxquels le père Carlos Álvarez, jésuite chilien, consacre son livre appartiennent comme lui à la Compagnie de Jésus. L’auteur de La fable mystique I et II (Gallimard, 1982, 2013), Michel de Certeau, est le plus connu, du moins à partir des années 1970, d’un public hors institutions religieuses, de par ses incessants voyages au cœur des sciences humaines et sociales. Si son ancrage d’origine se situe dans l’histoire de la mystique et en particulier celle du XVIIe siècle français, il n’a cessé d’analyser les diverses « formalités » modernes : de la ville à la communication en passant par la psychanalyse. La notoriété d’Henri de Lubac, en revanche, est restée plus confinée, malgré une œuvre profuse de théologie historique [2], bien connue des historiens du christianisme ‒citons simplement les quatre volumes d’Exégèse médiévale (Aubier, 1959-1963) et Corpus mysticum (Aubier, 1944) ‒, dans les milieux ecclésiaux. Un temps interdit d’enseignement à la suite de la publication de Surnaturel. Études historiques (Aubier, 1946), livre dans lequel Lubac présentait une lecture renouvelée du destin théologique de l’homme, caractérisé par la tradition chrétienne non comme « animal rationnel » mais comme « capax Dei », contre ce qui lui apparaissait comme la clôture moderne de l’homme sur lui-même, il fut réhabilité au moment du concile Vatican II et, pour finir, créé cardinal, en 1983, sous le pontificat de Jean-Paul II.
En quoi l’examen de l’histoire des relations entre nos deux personnages peut-il éclairer « le débat entre théologie et sciences humaines », comme l’indique le sous-titre du livre ? Carlos Álvarez ne se résout pas à la sorte de paix westphalienne entre théologie et sciences humaines sous la haute bienveillance de la tolérance neutralisante et du respect des convictions, dont il était question en commençant. Il lui faut la possibilité d’un dialogue, vital si l’on tient à ce que la théologie ne s’enferme pas dans « une vision idéologique et sectaire qui s’éloigne des défis d’une société pluraliste ». Et l’on aurait tort de penser qu’il s’agit là simplement d’une question pour la théologie. Elle touche à la compréhension adéquate des phénomènes de « sécularisation » (terme que Certeau n’utilise que très peu), à celle de la façon dont les sociétés contemporaines font « fonctionner » le « religieux », à la structuration et à l’originalité (à la « légitimité », dirait Blumenberg) du symbolique moderne (de la « déthéologisation » achevée de l’homme jusqu’au, pour certains, « nihilisme actif » contemporain ?). Questions graves qui font que se mêlent au débat entre nos deux protagonistes des auteurs comme Habermas, Taylor, Rosa, Gauchet, Vattimo, Joas et tant d’autres.
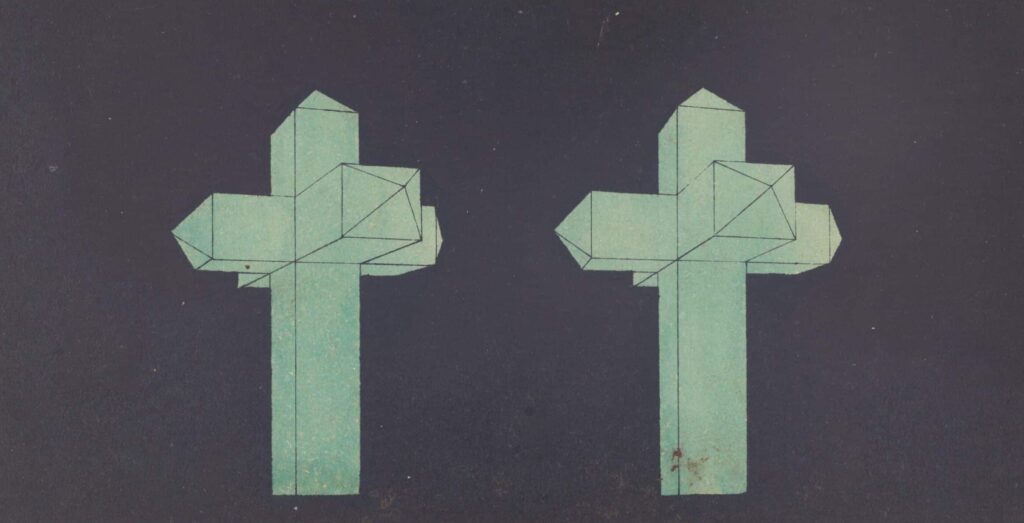
Pour aller vite au centre du livre, sans pouvoir s’attarder sur les scansions, d’abord objet d’un premier repérage dans un article de François Trémolières (cf. Revue d’histoire de l’Église de France, n° 253, 2018), approfondies par Carlos Álvarez dans les relations entre les deux hommes, il faut distinguer deux périodes. Celle des années 1950 jusqu’en 1966, c’est-à-dire les années Christus, revue jésuite de spiritualité fondée en 1954, à la rédaction de laquelle Certeau restera jusqu’en 1966 pour ensuite être nommé dans l’équipe de rédaction de la revue Études, puis dans celle de la grande revue de théologie de la Compagnie, Recherches de science religieuse. C’est le temps de la reconnaissance de la filiation, du lien entre maître et disciple, marquée même par une certaine complicité, comme, par exemple, dans l’entreprise de réhabilitation de Teilhard de Chardin. Puis vient une seconde période, celle de la fin des années 1960 jusqu’à la mort de Michel de Certeau, en 1986 : c’est celle de la réception du concile Vatican II, celle de la crise à la revue Christus provoquée par la parution en 1966 d’un article de François Roustang ‒ qui deviendra un célèbre psychanalyste ‒ « Le troisième homme », qui met en lumière l’existence, entre « progressistes » et « conservateurs », d’un troisième groupe composé de ceux qui silencieusement quittent l’Église, constatant la « perte de pertinence du langage religieux ». 1966, c’est aussi le moment de la suggestion faite aux supérieurs de la Compagnie d’ouvrir un « centre de réflexion et d’action dans le secteur des sciences humaines ». La réaction du père de Lubac est immédiate : la jeune génération des intellectuels jésuites forme une « intelligentzia pulvérisatrice ».
Nous sommes avec ce second temps au centre du livre d’Álvarez. En cette même année 1966, qui semble la date clé, paraît les mots et les choses. Attelé à une thèse d’État sur le jésuite bordelais Surin (1600-1665), Certeau possède une solide formation d’historien, frottée à l’érudition de l’édition de sources auprès de l’historien Jean Orcibal, grand connaisseur du christianisme à l’âge classique. En 1964, il participe à la création par Jacques Lacan de l’École freudienne de Paris. Ouvert aux sciences humaines, qui, ces années-là, à la fois s’institutionnalisent et font l’objet de critiques (Derrida contre Lévi-Strauss), le livre de Michel Foucault est un choc, le futur auteur de La fable mystique y découvre le point de fuite qu’il cherchait, qui relativise les sciences humaines en « opérant » leur archéologie. Elle lui semble ouvrir un espace à l’expression de la foi. Mais, en même temps, et c’est sans doute pourquoi Lubac va tenir le travail de son jeune confrère pour une « trahison », alors même que celui-ci entend explicitement s’inscrire dans la continuité, il prend conscience que, dans la dissémination foucaldienne du sens, se fragilisent tous les concepts utilisés par Lubac pour rendre compte de l’unité de l’Histoire. Une totalisation, une théologie de l’histoire, comme celle magistralement exposée dans Exégèse médiévale, devient impossible. À l’allégorie (l’archéologie foucaldienne « se refuse à être allégorique », voir L’archéologie du savoir, 1969, p. 182), qui permet le passage de l’ancien au nouveau, de l’histoire juive à l’histoire chrétienne, se substituent des « systèmes de dispersion », rendant l’origine inaccessible, « absente », par les glissements successifs des pratiques discursives.
Les grands articles de l’historien Alphonse Dupront, référence étonnamment manquante dans le livre de Carlos Álvarez, confirment Certeau dans l’idée que le sol sur lequel pouvait se déployer la théologie chrétienne s’est dérobé, que le projet du père de Lubac de ressourcement du christianisme contemporain dans la grande Tradition, ce qui sera un des grands objectifs de Vatican II, n’est plus de mise : la critique historique appliquée à la Bible disjoint ce que la Tradition avait réuni, le sens littéral et le sens spirituel ; la sociologie renvoie l’Église aux règles régissant les sociétés humaines ; la psychanalyse, la religion à un processus régressif infantile, etc. Si, pour Lubac, la Tradition, autrement dit le mouvement qui lie ensemble le passé-principe, toujours agissant et jamais passé, et l’avenir, permettait de contester un passé récent, corrupteur d’une dynamique de salut, celui de la moderne invention de la « nature humaine pure », et si le présent, pour l’essentiel résultant de cette corruption, pouvait être replacé dans le grand fleuve, pour Michel de Certeau, il s’agissait désormais d’analyser « le fonctionnement de l’expérience chrétienne » à partir d’une « place devenue particulière », comment « s’articule son opération propre ». Il est question, écrit-il encore, « d’articuler une option singulière (la foi chrétienne) sur des questions générales (sociales, économiques, politiques, culturelles) ». Ces mots, issus d’un article intitulé « La rupture instauratrice », publié dans la revue Esprit en 1971, achèvent d’éloigner Lubac de son disciple, qualifié de « pitre » et de « bateleur ».
D’où toute la problématique qui anime le livre de Carlos Álvarez : le passage du « corpus », celui constitué d’un « langage qu’il faut sauver », avec toute la thématique du sol ecclésial, à la « fable », non pas celle de L’origine des fables de Fontenelle, non pas la fable des Lumières, la superstition qu’il faut vaincre, mais celle qui « fait parler », celle « qui prend en charge les récits des commencements », qui n’articule pas directement des pratiques mais les « autorise », les « permet ». C’est dans ce contexte qu’un dialogue s’opère avec les sciences humaines, non pour tenter de justifier la théologie devant les sciences humaines, leur démontrer qu’elle traite bien d’un objet et qu’elle en dit quelque chose de précis, mais pour traverser les pratiques sur lesquelles elles reposent en marquant les différences qu’elle repère et qui définiraient « l’expérience chrétienne ».
Ainsi, Certeau déporte le « croire » du savoir vers le vouloir, « croire, c’est vouloir croire », ou, plus exactement, un vouloir qui trace son savoir dans le fond de son expérience à la fois individuelle et collective et dans toute l’épaisseur de son histoire. La foi doit rendre raison de ce vouloir, la positivité des sciences humaines ne peut le réduire tout à fait. Non pas à côté des sciences de l’homme, mais avec, la théologie se transforme, consciente de ses opérations (lieu – ecclésial, pratique – l’autocompréhension critique de la « différence chrétienne », écriture – plus celle du traité systématique, mais celle de l’intervention « proportionnée », un mot qui revient quatre fois dans l’article de 1971, dans des situations précises ; voir le premier chapitre de l’écriture de l’histoire). La théologie retrouve alors, dans un monde post-chrétien, sa « fonction » des commencements : marquer la « différence chrétienne », « dire » la singularité d’un « faire », au sein même des pratiques contemporaines.
[1] La première étant la révérence cartésienne devant l’exercice « plus qu’humain » de la théologie (Discours de la méthode), manière de lui donner congé ; la deuxième étant la crise kantienne, qui pourtant semblait « faire une place à la foi », qui étendra son ombre (dans laquelle il faut inclure la récupération anthropologique sans reste du théologique dans l’hégélianisme de gauche), jusqu’à la troisième, au tournant du XIXe et du XXe siècle, dite crise « moderniste », qui verra la théologie aux prises avec les disciplines, alors en phase d’institutionnalisation, des sciences humaines (histoire, sociologie, psychologie, psychanalyse, linguistique, etc.).
[2] Tous les ouvrages d’Henri de Lubac font l’objet, aux éditions du Cerf, dans le cadre d’une impressionnante édition d’œuvres complètes, d’une réédition augmentée de glossaires, dossiers et inédits.












