À l’occasion du Marché de la Poésie 2024, ce numéro d’À l’écoute se propose d’être un lieu de rencontre avec les poètes et poétesses qui, habituellement sédimentés, se retrouvent sur la place Saint-Sulpice à Paris, pour écouter et échanger des paroles, des sourires et quelques vers. Nous vous proposons de découvrir les recueils d’Anne Dujin, Jean d’Amérique, Anne Lorho, Christine Guinard, Laurent Grisel, Blandine Merle et Nicolàs Guillén.
Anne Dujin nous offre un travail remarquablement abouti, dont la simplicité et la fluidité séduisent immédiatement. Elle montre une aisance, dans une langue qui brille par la couleur et la justesse. Quotidienne, la thématique est haussée par le regard. Et c’est d’une sagesse élaborée dans l’écriture même que rayonne le poème. Ces pages respirent une paix neuve, fruit de la méditation du monde. Car si le je laisse place au tu, c’est l’effet d’une pensée à l’œuvre dans un obscur dialogue intérieur. De telle sorte que s’élabore à mesure une sorte de règle pour quelque cloître de plein vent, voulu par une existence qui, « n’ayant pas de noyau », selon le titre, devra se consacrer moins au but qu’à la vérité et à la beauté du chemin. Fragment du poème « Mosaïque » : « Un jour quelqu’un t’invitera toi aussi / à reculer de deux pas, regarder l’ensemble / les fragments aujourd’hui épars et d’autres / que tu ne reconnaîtras pas, dessiner / un motif à la fois familier et inconnu / Et tu seras surprise, quand tout sera fini. » Jean-Marie Perret
Anne Dujin sera présente sur le stand Gallimard (200) le samedi 22 juin à 18 h.
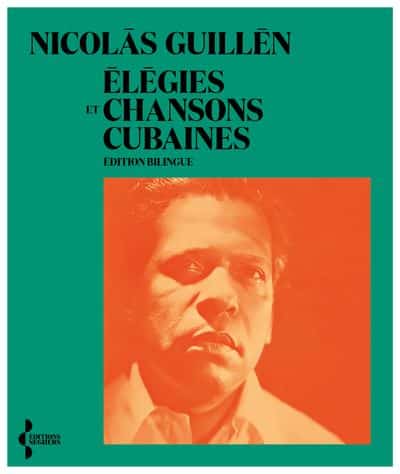
Nicolás Guillén (1902-1989), cubain et mulâtre, ami de Lorca qui sacralisa avant lui les Negros, negros, negros, pareillement engagé dans la défense des humbles et des opprimés, fut encensé par la Revolución de 1959 au point d’être statufié en « poète national », assigné de ce fait au purgatoire. Il nous revient aujourd’hui, avec la vigueur d’une poésie parcourue de son, nom primitif de la salsa. À l’heure où la voix métisse se fait mieux entendre, il peut figurer dignement aux côtés d’Aimé Césaire ou d’Édouard Maunick. Son originalité est d’avoir soumis la lettre au son, oralisant l’orthographe (« tiene de to… te lo da to »), et les premiers « poèmes mulâtres » de ce promoteur du « négrisme » captent avec bonheur ce qui fait l’essentiel de la musique afro-cubaine, nous donnant à entendre ici Sóngoro cosongo, qui n’est rien d’autre que le bruit du bongo (tambour), et là ressassant son negro bembón (« nègre lippu ») que l’édition bilingue fait mieux entendre. Guillén, qui nous a donné Motivos del son et El son entero, est tout entier – à l’écart de sa poésie « engagée » le figeant en poète officiel du castrisme – un poète de belle sonorité au service de l’intense sensualité caraïbe. Et l’on se laissera bercer par ces vers heureusement intraduisibles :
Mayombe – bombe – mayombé…
Sensemayá… sensemayá… sensemayá.
Albert Bensoussan
Il y a ce titre, d’abord. Avec un verbe conjugué à l’imparfait qui provoque l’attente d’une narration. Peut-être le récit de la fin d’un monde, dès lors on veut savoir. Ce verbe revient souvent, la narratrice se « demande ce que cela veut dire ». « On ne sait rien. » D’une image de bougie dans le noir, empruntée à Mahmoud Darwich, l’auteure tire un magma à sculpter ses poèmes. Avec pour thème l’écriture et l’interrogation sur le fait humain.
Tout au long, il est question de sens, celui qu’on cherche – qu’on ne trouve pas, celui qu’on donne – à l’existence, à l’humain, à la fuite du temps –, celui par lequel on vibre. La poésie est un outil semblable au filet du pêcheur. Dans ses mailles, l’auteure retient les mots qui relèvent du chant, de la chair, du suc. Des mots simples, directs, « je m’avance dépouillée ».
Pour dire son questionnement existentiel, la poète ne se retranche pas, elle reste en lien avec les autres – « tous nous brûlons » – , et parce qu’« il faudrait dormir sur soi au bord de l’autre », et « attendre que la vie vienne », le poème a la magie du Phénix, la puissance de l’arbre. Quand le soir tombe, se referme sur nos questions, « nous réunit », on voit le feu autour, la cendre, une greffe. Nous écoutons la narration comme on écoutait autrefois les contes des anciens. Une voix passe dans ces poèmes, la voix intérieure qu’on a crue asséchée, qui fabrique là une image habitée du présent. Marie-Pierre Stévant-Lautier
Christine Guinard sera présente sur le stand Gallimard (200) le vendredi 21 juin à 19 h.
La faim justifie les moyens poétiques. Comme dans « tripes cordées », qui ouvre le dernier-né des livres de Jean D’Amérique, que l’on dirait justement d’un retour au pays natal (Haïti) : « servie la table », bien sûr une blague, énième fois que le repas nous plante, chez nous la coutume veut que dans la salle à manger nos révolutions avortent trois fois par jour ». La phrase non pas coupée, mais coupante, qui ne chancelle pourtant jamais : « combien de fois sur le métier à chuter, ma mère ne remit point d’ouvrage, c’est qu’elle faisait école dans le tracas, et il me semble qu’avant les gouttes liminaires venues huiler mes spasmes contre le trépas, elle maîtrisait déjà la science de pleurer ». Les mots de circonstance, à la limite du criant, vociférant, pas au-delà ni en deçà : « ficelée de pierre, une partition anonyme prend corps dans nos gueules évidées, et toute viande là dévorée, de quel droit la chorale rauque de nos dents pourrait espérer tendresse à mâcher ». La ponctuation qui s’absente ou presque, laissant au poème la possibilité de transformer le tortureux en tortueux, ad libitum : « un flot humain qui court les rues sans marcher sous l’ordre des feux rouges ». Quelque pays parmi mes plaintes est tout sauf plaintif et c’est cela qui fait sa beauté première. La seconde est mélange d’Histoire à vous glacer le sang et d’histoires à vous chauffer les veines, de passé arasé et de futur irisé : « certains jours, une promesse brise la glace ». Le tout est une réponse contenue dans la question, qui est autant interrogation qu’affirmation : « sommes-nous des branches qui ne savent raconter le vent ». Un grave et beau petit livre de l’enracinement-déracinement. Roger-Yves Roche
Le livre se trouvera sur le stand des éditions Cheyne (405).
Un recueil–fleuve. De sa source jusqu’à son embouchure, il nous propose un voyage inattendu. Dès les premiers vers, dès le titre, il s’agit sans cesse de corps et de circulation de mots, jusqu’à ressentir un engagement physique de lecteur. En trois parties dont les émotions vont crescendo, l’ouvrage nous happe corps et biens dans une expérience multisensorielle : on glisse, on saute, on est tiré, poussé, on roule de poème en poème. On est au cœur d’une imagination ô combien créatrice, on accepte le pacte : une logique pure n’est pas de mise, l’onirique est partout. Les « images peintes » et les « paysages syncopés » demandent à être interprétés par chacun. Des images fortes – « les années dans la déchirure / les corps comme on enferme un enfant / la dévoration / sourire minéral » – parfois glaçantes, effrayantes, « l’imminence d’un désastre », ou même des fragments qui « dégoulinent » et mènent au bord de l’écœurement, sont aussi à même de créer de l’espoir, de la douceur « à bas bruit », « à pas menus ». L’œil du lecteur est libre d’aller dans ces pages sans ponctuation ni majuscules. Il y trouve un rythme, grâce à l’usage séduisant d’anaphores, à l’emploi régulier du pronom tu, qui parfois peut valoir un je, qui chaque fois nous saisit. La navigation dans ce livre est d’une totale étrangeté. Les textes creusent la ligne comme une terre, meuble et riche sous nos pieds, « là où tout se ramasse ». Marie-Pierre Stévant-Lautier
Le livre se trouvera sur le stand de La rumeur libre (501).
Une double vision pour commencer : « – un homme (traits indistincts, gestes insistants) grimpe au mur et fait signe à la fenêtre la nuit – / – À l’intérieur, des mains s’agitent, des bras, un corps tout entier, jusqu’à ce que l’ensemble soit bouclé – ». Naître et mourir, second recueil de poèmes de Blandine Merle, fait… naître et mourir de semblables images, tantôt prises côté extérieur, la nuit, la mort, le noir, le silence, tantôt surgies de l’intérieur, ventre plein de vie que l’on devine. Naître et mourir ne fonctionne pourtant pas en opposition, mais en analogie de formes, coïncidence de situations, entrelacs de mots, dits et tus : « Accidentelle : brèche / dans le corps aussitôt renversé / par où s’immisce entre la vie et la mort / la stupéfaction de se tenir entre. » Un monde voit le jour tandis qu’un autre touche à sa fin, sans que ces deux mondes se disjoignent. Restent des sensations, ou des impressions, tout en légèreté mystérieuse : « Plus rien n’existe / que le fait d’être l’égale d’une pomme / soumise aux lois de la gravité. / D’une pomme / qui par conséquent tombe / puis roule / dans le sous-sol gelé de l’hôpital / au milieu d’une tuyauterie irritante / et d’injonctions paradoxales / où son travail (parvenir à maturité) / n’en finit pas. » Roger-Yves Roche
Blandine Merle sera présente sur le stand Gallimard (200) le samedi 22 juin à 13 h.
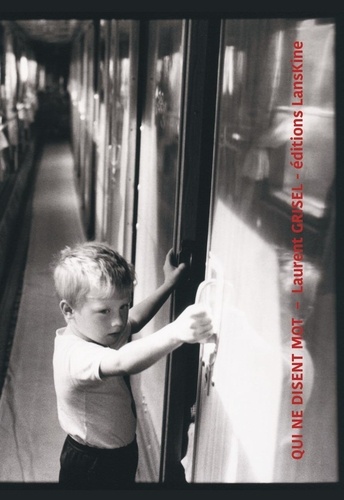
C’est un petit livre (64 pages) qui vaut largement des recueils plus épais tant par la densité de sa matière poétique (en gros, tous les enjeux du monde moderne !) que par la langue à la fois nerveuse et mélancolique qui porte assez à incandescence la rencontre d’un éclat de vie souligné (plus ou moins familier) avec le mystère de la poésie qui lui donne, pour un peu, une seconde chance… Et sous la fébrilité assez vibratoire des poèmes ne se cache pas une attention au monde : elle la porte. Quelque chose comme une compassion non élocutoire, un effort pour réparer la pâte humaine déchirée par tout ce que l’on sait de l’indignité contemporaine. Mais, avec parfois une touche d’humour salvateur ou un clin d’œil aux audaces du surréalisme, Laurent Grisel sait ne pas tomber dans la nostalgie du « c’était mieux avant » (ce qui est vrai en ce qui concerne les rapports humains et la qualité de l’espérance de jours vraiment meilleurs !). Rien donc de démonstratif dans cette poésie fermement engagée – foin, ici, de l’ouvriérisme, par exemple – mais engagée surtout à ne pas s’en laisser conter par l’époque, non plus qu’à se laisser berner par la musicalité des mots ou par la houle plus ou moins analgésique du rythme prosodique aisé. Une solide exigence poétique ! François Boddaert












