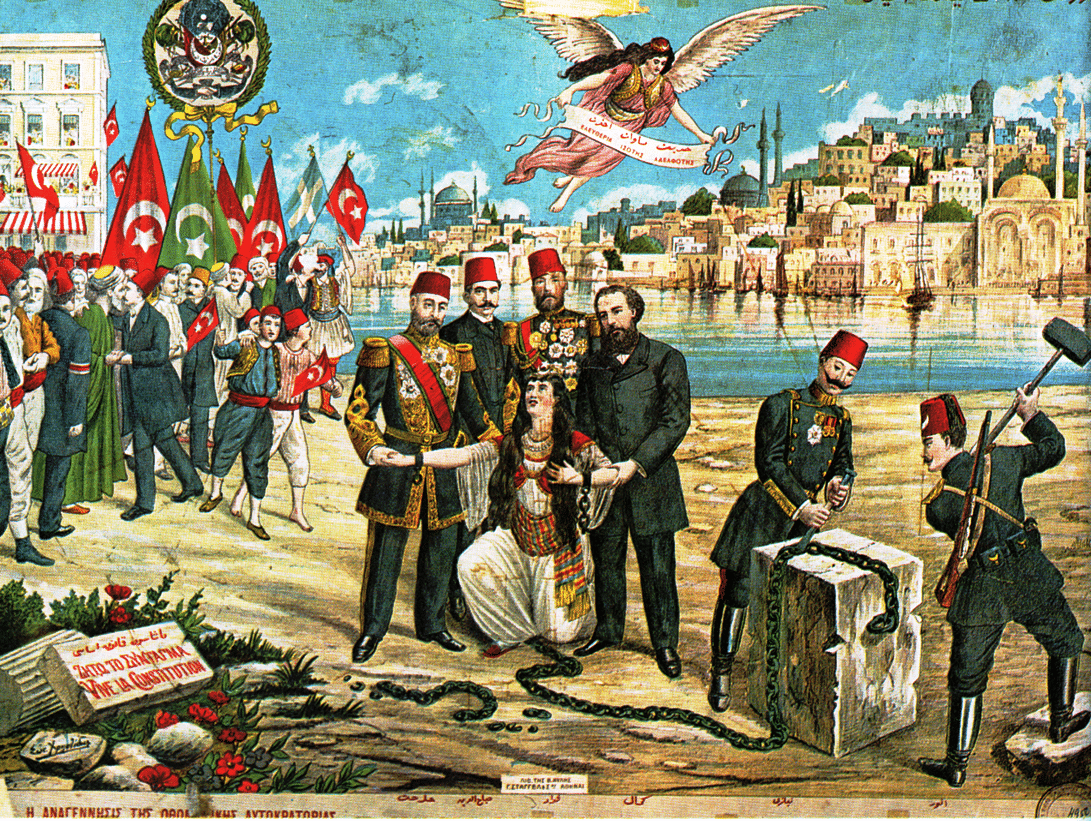Pour la majeure partie du public français, qui dit « Groupov » dit Rwanda. Et plus précisément, pour ceux qui l’ont vu au début des années 2000 lors de sa création, ou plus tard en captation, Rwanda 94. Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants. Le spectacle a fait date dans l’histoire à la fois du théâtre et des tentatives d’affronter et de surmonter, dans le domaine de l’art et de la pensée, ce que c’est qu’un génocide.
Le génocide des Tutsi fait aujourd’hui l’objet, trente après, d’une commémoration plus visible que d’ordinaire, pour des raisons où le politique joue sa part. Parmi les parutions, un ouvrage collectif est intitulé Le choc [1], mot plusieurs fois décliné. C’est par lui que commence le texte de Jacques Delcuvellerie et Marie-France Collard, qui y reviennent sur Rwanda 94, sa préparation et sa réception, y compris au Rwanda. On retrouve ce mot dans le livre que Jacques Delcuvellerie, fondateur et directeur artistique du Groupov, a écrit à l’invitation de Théâtre & Publics, centre de recherches, pratiques et formations théâtrales en fédération Wallonie-Bruxelles : petit livre-bilan d’allure modeste, mais précieux, riche d’informations et de réflexions sur l’intégralité d’un parcours qui excède largement ce spectacle. On y comprend le tournant qu’a été Rwanda 94 dans l’itinéraire du groupe. On y saisit aussi l’extraordinaire aventure collective qu’a été ce parcours, de sa création en 1980 à aujourd’hui.
Rwanda 94. Le choc, le texte, le spectacle
« Il y eut d’abord le choc initial (1994), celui où tout s’origine. » Ainsi débute le chapitre consacré au spectacle Rwanda 94, au mitan du livre. Choc violent dû à une « révolte double », face à l’événement et à son traitement médiatique. Ces deux objets s’imbriquent dans la trame de ce spectacle-monstre affrontant un monstre, où, cinq heures et demi durant, s’enchaînent les formes et les genres les plus divers : long témoignage liminaire prononcé par une survivante (Yolande Mukagasana), « chœur des morts », trame narrative à caractère initiatique – enquête et quête de vérité d’une journaliste au départ intoxiquée par le vernaculaire des médias –, conférence d’historien, litanie de questions en récitatifs, satire politique avec masques bouffons, chant épique et chant de deuil. Le tout rythmé par une partition musicale croisant la composition occidentale ultra-contemporaine de l’Américain Garett List et des mélopées rwandaises – chants de plaintes et de paix inspirés de l’histoire du pays, la plupart composés et savamment interprétés par Jean-Marie Muyango.
Le texte, issu d’une écriture collective in progress signée Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Jean-Marie Piemme, Yolande Mukagasana, Dorcy Rugamba, Mathias Simmons, était mis en scène par Jacques Delcuvellerie. Mobilisant quarante personnes en tournée, le spectacle, multiprimé, a été monté quatre-vingt-seize fois en cinq ans sur trois continents (France, Allemagne, Italie, Suisse, Belgique, Guadeloupe, Québec, Rwanda), suscitant une émotion sui generis et nombre d’éloges enflammés. « Rwanda 94 restera le grand spectacle, indépassable, de la fin du siècle passé », écrivait Georges Banu en 2012 [2]. Le spectacle se tenait plutôt sur le seuil d’un siècle et mettait en place, selon les termes de Philippe Ivernel, un des fidèles accompagnateurs intellectuels du Groupov, une nouvelle « esthétique de la résistance » de filiation brechtienne. Il faisait assumer au théâtre la « responsabilité historique » d’un événement qui, tel était le prérequis de l’entreprise pour chacun, « interpellait la totalité de la famille humaine », formules respectives de Piemme et Delcuvellerie [3]. Là où Banu saluait une grande tragédie à hauteur de l’époque, évoquant la catharsis antique, Olivier Neveux y discerna une « opposition militante à l’idéologie du tragique » [4]. Le spectacle se tenait sur ce seuil-là aussi, en mettant une autre catharsis à l’épreuve, autant qu’à l’essai [5].

C’est à Liège, où le groupe prit naissance, que le spectacle fut donné la première fois en 2000, après une étape intermédiaire jouée à Avignon en 1999, et pour la dernière fois en 2005. On a pu voir encore l’inoubliable finale pour chœur et orchestre, La Cantate de Bisesero, lors des vingtième et vingt-cinquième commémorations : en 2014 à l’Espace 1789, à l’occasion d’un colloque international [6], en 2019 au théâtre Varia à Bruxelles, peu avant la mort de Garrett List, qui en avait écrit l’envoûtante partition. Rwanda 94 ne se produira plus, mais le texte a été édité en français et en kinyarwanda [7], et depuis 2013 sa captation est accessible dans un précieux coffret de 5 DVD, qui contient, outre le spectacle filmé par Marie-France Collard et Patrick Czaplinski en 2005 à Liège, trois documentaires relatifs à sa création, sa réception, son après : Œuvres en chantier. Rwanda 94. Groupov 20 ans (réalisé par Marianne Sluszny et Guy Lejeune, 2000), qui documente sa genèse et cinq ans d’élaboration ; Rwanda. À travers nous l’humanité… tourné par Marie-France Collard lors de la dixième commémoration au Rwanda, où ce spectacle, conçu au départ pour un public occidental, provoqua, on peut l’imaginer, un autre « choc » [8] ; enfin, Bruxelles-Kigali (2011), réalisé par la même lors du procès d’un dirigeant des milices Hutu, en 2009, fait entendre les débats de la cour d’assises de Bruxelles, et, en contrepoint, des survivants forcés de croiser des suspects non jugés. Le coffret contient en outre un texte relatif à l’événement et à la pièce, en français et en anglais, rédigé avec un souci de précision factuelle et verbale qui signe aussi les créations du Groupov.
« Création collective » et écritures d’acteurs
Groupov. Histoire d’un parcours présente Rwanda 94 comme un « aboutissement logique » autant qu’un tournant. Cette aventure scénique et humaine est replacée dans un travail intrépide de très longue durée, marqué au sceau d’une radicalité et d’une réflexivité singulières, qui donnent à ce collectif sa créativité unique, d’une profondeur décapante. Cette elliptique « histoire d’un parcours » n’en donne qu’une idée, à la manière d’un memorandum à l’usage des suivants, « petit conte », agenda collectif et essai personnel à la fois : l’auteur y parle en son nom et pour le groupe, disant alternativement « je » et « Jacques Delcuvellerie ». Au cours de ses quarante ans d’exercice, le collectif Groupov a créé une vingtaine de spectacles, faisant alterner les créations collectives conçues comme des « expériences » éprises d’absolu ou de « nouvelle naïveté » (Francine Landrain), puis des « projets-mondes ». Les mises en scène de textes du patrimoine (Tchekhov, Brecht, Heiner Müller, Claudel, Césaire) sont conçues comme accumulateurs d’énergie et ressourcements, sur fond d’une interrogation continue sur ce que peut devenir le théâtre quand le « monde » lâche et que le langage manque. Jacques Delcuvellerie et Francine Landrain ont longtemps joué un rôle primordial d’auteur, duo tendu qui tourna au duel intellectuel, heureusement surmonté. Mais chaque membre, invité à « l’Écriture Automatique d’Acteur », y a toujours été un auteur effectif et potentiel, et la polyvalence valait aussi pour les tâches de documentation de fond et de communication (Philippe Taszman). Les œuvres des siècles passés sont souvent muées en matériaux, jouant sur des écarts avec la transgression et l’outrance romantique (Sade, Mary Shelley, Kleist) ou les ruptures modernistes (Breton, Joyce, Yeats…). Au montage des spectacles s’ajoutent des « Décalages », exercices collectifs de désaxage méthodique où l’on prend le « chemin de la forêt » : rites d’égarement destinés à faire trembler les frontières du théâtre et de la vie privée, comme sur scène se traversent celles du réel et de la fiction, sans jamais qu’elles s’identifient. Dans cette recherche expérimentale et artistique collective, trois noms constituent des pôles d’inspiration continus et alternés : Brecht, Pasolini, Debord. Mais aussi, selon les périodes, Grotowski, Weiss, Fanon, Anders, Carmelo Bene…
L’inouï et l’héritage
Monde-miniature, ce livre contient une foultitude d’autres noms : les références abondent, jouant de leurs écarts : entre Brecht et Pasolini ou Brecht et Grotowski – Delcuvellerie imagina écrire un jour une étude sur « ce qu’on doit à Grotowski d’un point de vue brechtien » [9]. Car le désir initial du groupe, celui d’une « exploration de l’in-ouï » ou « traversée d’un territoire inconnu », dans un temps de « déréliction », a tourné au « règlement de comptes intime avec l’héritage » : l’inouï faisant ressurgir des passés et apparaître des ancêtres, créer devenait « l’auscultation créative des traces qu’ils ont laissés en nous ». Le groupe se voyait ainsi, à ses débuts, comme un « orphelin de cette dualité lumineuse qui refuse l’amnésie », moderne à la manière hérétique de Pasolini : « Et moi, fœtus adulte, plus moderne que / tous les modernes, je rôde / en quête de frères qui ne sont plus ». Cette quête spectrale est contrebalancée par la présence charnelle de l’acteur, point d’ancrage de ce théâtre sensuel, qui pense le geste comme acte, le jeu comme épreuve, l’événement scénique comme fête, transe pensive, production d’« esquisse épiphanique ». La mobilisation assumée d’un vocabulaire religieux en plein athéisme vindicatif fait même parler à Delcuvellerie, hanté d’« expérience pure » extra-théâtrale, d’« oblation collective » composée d’individualités libres, éveillant ce que Heiner Müller appelait la « nostalgie d’un autre état du monde ». Le Groupov a donc cherché et trouvé ses frères aux « limites du théâtre », dans les performances de foire et de cirque et dans les propositions et pratiques de Grotowski, Schechner, Mnouchkine, Dario Fo, du Squat Theater et du Living Theater… Et à la frontière du musical, chez Kagel, Berio, le premier Velvet Underground, John Cage, Henri Pousseur… La partition musicale, ultra-travaillée, est décisive dans cette énergétique, dès le début et de manière croissante : qu’elle joue sur les legs en mêlant le baroque à la chanson populaire, au rock ou au free jazz, de Purcell à Dylan en passant par Albert Ayler et Archie Shepp, ou qu’elle se hisse au rang d’auteur-acteur avec les créations de Jean-Pierre Urbano et Garrett List. La scène intègre également le cinéma (les « frères » ici sont Fellini et Chaplin) et l’instrument vidéo manié avec maestria par la réalisatrice Marie-France Collard, qui a pris une part croissante aux créations.
Conçus comme d’immenses machineries à faire vibrer, rager, penser, désespérer et jubiler, ces spectacles sont souvent énormes à la mesure de leurs sujets, chronophages et voulus comme tels : préparés cinq ou six ans durant avec sessions exploratoires de documentations, discussions, montage, représentations-tests causant parfois des remaniements tranchants, voire des renoncements, et tout ce que cela suppose de lectures, débats, controverses, explications, déchirures et parfois ruptures, sur fond de fidélités, amitiés, amours au long cours… Intense matière émotionnelle qu’on ne peut qu’imaginer car rien n’en est dit, sauf, de manière poignante, quand est rendu hommage aux disparus, compagnons et partenaires de longue date, comme la grande brechtienne Arlette Dupont, à qui fut consacré un spectacle, et Eric Duyckaerts, irremplaçable partenaire et ami à qui est dit adieu à la fin.

On sent une utopie latente dans ce va-et-vient entre exercices de sortie de soi et du monde et spectacles de grand format qu’on pourrait dire « épocaux » ou « destinaux », à gestation lente, parfois trop énormes et brûlants pour pouvoir se réaliser intégralement. Tel a été le destin de l’immense tétralogie conçue six ans durant par Delcuvellerie, Fare the Well Tovaritch Homo Sapiens, qui, avec ses quatre volets thématiques programmés sur quatre saisons, fut discutée, répartie, préparée par trois binômes, qui finirent par imploser faute d’accord de fond sur sa signification ultime : d’un côté le désespoir voulait être dépassé, de l’autre il devait être assumé. Cette réflexion ironique, pessimiste et jubilatoire à la fois, sur l’extinction annoncée de l’espèce humaine et la vie à vivre, avec retour sur l’histoire mondiale du XXe siècle, portait dans un cas une promesse, dans l’autre elle se refusait à toute promesse. Aucun consensus ne fut trouvé. Mais un de ses volets, rescapé du naufrage, a donné lieu à un nouveau spectacle-monstre, le dernier de ce format, qui en 2010-2013 a remporté un très grand succès : Un Uomo di Meno (« Un homme de moins »). Groupov. Histoire d’un parcours cite un long extrait liminaire de ce texte rescapé, où s’identifient la fin d’un monde et la fin d’un homme ; le « je » de Delcuvellerie se divise en deux personnages qui discutent, se disputent, sur fond de clonage post-humain et d’anthropocène, produisant des effets de vertige et de comique noir.
Le récit de cette entreprise pharaonique et de son abandon, avec l’exposé de ce qu’il en est resté, compose un document d’époque saisissant. L’ensemble porte à une puissance maximale, aporétique et néanmoins féconde le double paradoxe dont le Groupov débutant avait fait son adage : faire « de la maladie une arme », et, selon les termes choisis de Delcuvellerie, « de la solution imparfaite d’une faiblesse ou d’un manque, la ligne directrice d’un petit organon d’une dramaturgie d’aujourd’hui ». Ou, pour le dire dans les termes de Bataille, à qui l’auteur a confié son épigraphe : « laisse le possible à ceux qui l’aiment ». Compter un homme de moins – l’auteur, qui se voit perdre la vie et quitter le monde –, c’est parfaire l’organon et laisser le possible aux vivants. Car, qu’il s’agisse de réparer le mal faits aux morts ou de mourir, ce théâtre se fait « à l’usage des vivants ».
« Petit conte » en cinq « phases »
Le parcours du Groupov est si profus qu’il est difficile de le résumer et le livre lui-même a du mal à le faire dans ses 200 pages, pleines de renvois aux captations et textes que le site (en construction) rend accessibles. Un récit se raconte néanmoins en cinq « phases », après avoir évoqué « l’origine » comme « différence », où la dotation d’un nom se fait dans la dérision : Groupe-off devint Groupov par un effet de « slavisation ludique » et crépusculaire, qui inspira aussi le titre de la pièce Koniec (genre théâtre), « Koniec » étant le mot « fin » des films de l’Est. Dans sa première phase, Groupov s’est conçu comme un « Atelier de recherche permanent sur les restes » (1980-1988) : ceux des modernités livrées à une négativité nouvelle, ceux surtout d’une « représentation » faite pour un Homme qui avait fait son temps.
Que devient le theatrum mundi lorsque le monde et les mots font défaut ? Il joue sur le rien, avant de tenter le tout pour le tout en revoulant un monde. Le premier spectacle du groupe invitait le public à « louer » par petits groupes un acteur pour un moment limité à un prix annoncé, « jugé raisonnable ». Ce qui n’empêcha pas ensuite une partie de l’équipe de monter la Petite trilogie de Heiner Müller et de répondre à une suggestion du théâtre de la Monnaie en montant le lamento de Matériau-Médée et celui de Didon dans un « prologue » au Didon et Énée de Purcell composé par Pascal Dusapin, dont l’exécution fut confiée à Philippe Herreweghe, hybridation qui suscita la surprise chez les habitués de la scène lyrique baroque. La deuxième phase, placée par Delcuvellerie sous le signe d’un « travail dans la vérité », confirme le besoin de se ressourcer dans de grands textes visionnaires (Brecht, Claudel) ; du côté de la création, elle est marquée par le rôle des femmes, autrices et figures d’héroïnes fracassées par leur quête d’absolu, avec Lulu/Love/Life de Francine Landrain, inspiré de Berg/Wedekind/Pabst, et son ironique Penthy Two inspirée de Penthésilée de Kleist ; puis Trash (a lonely Prayer), pièce portée par un texte de Marie-France Collard aux consonances lyriques et pornographiques, qui interroge la zone de contact organique et imaginaire entre instinct de vie et désir de mort. À quoi succéda Dieu, texte de Frédéric Neige.
C’est dans la troisième phase, de 1995 à 2005 – le Groupov s’appelle désormais « Centre expérimental de culture active » –, que se prépare et se joue Rwanda 94, après La Mère de Brecht et avant le Discours sur le colonialisme de Césaire. Elle est marquée par le succès international de Rwanda 94, qui fait et fera date dans l’histoire du théâtre et de la réflexion sur le génocide : sa genèse, ses conditions de possibilité civilisationnelles et politiques, le schisme de l’espèce tel que le vit le survivant et le perçoit le témoin extérieur, quand la scission se joue dans l’ex-empire colonial : écart qui devient criminel dans le contrepoint de Bisesero, lieu à la fois d’une épopée de la résistance collective, celle des paysans des collines qui s’armèrent pour survivre, et du sinistre politique français nommé « opération Turquoise ». La part créative qu’ont prise à ce spectacle un grand nombre de jeunes artistes rwandais, acteurs et choristes comme Carole Karemera et Diogène Ntarindwa, auteurs-acteurs comme Dorcy Rugamba, qui tracèrent ensuite leur chemin entre Europe et Afrique, était un acte puissant, qui donna à la « création collective » un sens de longue portée.
La quatrième phase, celle de la gestation de la tétralogie Fare the Well Tovaritch homo sapiens (Adieu camarade homo sapiens) dont on sait l’issue, voit aussi la création d’Anathème (2005), saisissante performance vocale et musicale basée sur un large choix parmi la masse des textes bibliques – Tanakh et Ancien Testament – où Dieu exhorte les « enfants d’Israël » à exterminer les peuples ennemis ou les menace eux-mêmes d’extermination en cas de trahison idolâtre –, toujours femmes et enfants compris, « jusqu’au nourrisson à la mamelle », en brûlant tout sans restes, ni animaux ni maisons. Leitmotive hallucinants d’échos historiques et contemporains, rythmant des textes dont la poésie archaïque puissante engendre un mélange d’effroi étourdissant et d’hypnose, et pour finir une inquiétante torpeur [10]. Après avoir ainsi questionné le rapport entre violence des monothéismes et destructivité génocidaire, Bloody Niggers de Dorcy Rugamba et Younouss Diallo, mis en scène par Delcuvellerie (2007), évoquait la conquête du monde par l’Occident impérial chrétien, puis le rôle des ex-colonisés dans les dictatures post-indépendances, dans l’esprit des Damnés de la terre.
C’est dans cette quatrième phase que l’histoire du Groupov vire au « petit conte », en se faisant le récit de la « mise à mort » du groupe par privation de fonds : d’abord rationné par le ministère de la Culture belge en 2015, le Groupov a dû renoncer à toute recherche extra-théâtrale, puis, en 2018, à l’ensemble de ses activités. Le récit de cette chute du colosse aux pieds d’argile, d’une ironie amère (« crever coûte cher »), est pleine d’enseignements par les temps qui courent : en France comme en Belgique, un spectacle comme Rwanda 94 n’aurait aucune chance de se monter aujourd’hui. Cette coupure de vivres a laissé le temps au Groupov de monter L’impossible neutralité, inspiré par les bombardements sur Gaza en 2014. « Dernier geste, envers la Palestine cette fois, une autre tentative de réparation symbolique à l’usage des vivants. Pour rien ? » C’est par ces mots que s’achevait la dédicace du livre que m‘a envoyé l’auteur en vue d’un dialogue public au théâtre du Rond-Point (11 mai). À l’heure où j’écris ces lignes, le 7 mai 2024, à près de 35 000 Gazawi tués dont 9 000 femmes et 14 000 enfants, en réponse aux atrocités du 7 octobre 2023, il est difficile de répondre non.

Les enfants jouent
« Au pied du lit de l’agonisant, les enfants jouent ». Tel est le titre de la très brève cinquième phase, consacrée à l’archivage digitalisé de quarante ans de travail. Delcuvellerie imagine comme un dernier rituel l’assignation de fait à une pratique artistique fonctionnelle – « produire des spectacles » – pendant que Sapiens poursuit son autodestruction : The Show must go on ! Mais cette fin sinistre en trompe-l’œil ne saurait recouvrir la puissance vitale explosive et persistante de ce collectif, qui s’impose à la lecture de cette « histoire d’un parcours » : plein de dates, de titres, de tirets, ce petit livre est trempé d’une vie bouillonnante, qui éclabousse son lecteur. Ce rituel d’enfants joueurs avait d’ailleurs été imaginé dès « l’origine ». Dès le début, les enfants jouaient pendant qu’un monde finissait : ce début « d’orphelins tout à fait perdus » qui rêvaient d’in-ouï, et de formes nouvelles pour embrasser « la beauté qui n’a pas encore paru au monde », à la manière de Treplev, le jeune anti-héros de La Mouette. Quarante ans durant, ils ont joué leur jeu trash de prières sans dieu – mais avec rituels ad hoc, sans cesse repensés. Se retournant aujourd’hui sur l’incroyable parcours, ils s’apprêtent à nous dire adieu. Mais ce n’est pas du tout le même adieu qu’au « camarade Sapiens ».
« Tendre vers Brecht » est la devise qui avait permis au groupe, après avoir monté La Mère et s’être enivré de « chants brechtiens », d’« oser la grande forme » et d’ « oser nous affronter au tumulte sanglant du monde actuel », ce monde qui rend l’inhumain possible. Mais tendre vers Brecht, c’est aussi croire aux « bonheurs » dont il avait fait un poème, et se réchauffer à son dernier mot : « Être amical ». Les orphelins perdus demandent plus, toujours plus – car ils donnent plus, beaucoup plus, immensément plus. Qui ne sait pas recevoir cesse un jour de donner. Mais ce cadeau énorme a été reçu – comme le dit le ton vibrant, exalté, de nombre d’articles intégrés au livre, animés d’une gratitude euphorique qu’on voit rarement s’exprimer dans la « critique théâtrale » avec une telle ardeur. L’histoire du Groupov est celle d’une extraordinaire intensité au long cours, c’est aussi celle d’une exceptionnelle générosité, presque extravagante. C’est qu’en jouant et jouant encore, en s’égarant rituellement dans les « forêts » et « clairières » de « l’expérience pure », « sur la limite, vers la fin », les enfants perdus ont trouvé une vérité simple : celle dont parle Nazim Hikhmet, cité en épigraphe du chapitre brechtien : « Les chants des hommes sont plus beaux qu’eux-mêmes ».
Cherchant les mots pour définir l’acte théâtral comme « esquisse épiphanique », Delcuvellerie dit la même chose autrement : « ce rêve d’émerveillement-naissant par un acte vivant qui advient ici/maintenant, rien d’autre, de toute ma vie, ne m’a jamais paru plus beau, plus rare et plus nécessaire dans la promesse qu’engage, en principe, toute représentation théâtrale ». Rien de plus beau, ajoute-t-il plus loin, car rien de plus menacé par la « spectacularisation généralisée » qu’engage le fait de vivre ensemble dans ce monde ; secrétant la violente nostalgie d’un monde autre – qui parvient parfois à exister sur scène, quelques heures ou instants, ici et maintenant.
[1] Annette Becker, Stéphane Audoin-Rouzeau, Samuel Kuhn, Jean-Philippe Schreiber (dir.), Le choc. Rwanda 94 : le génocide des Tutsi, Gallimard, 2024
[2] Georges Banu, « Le théâtre de la pensée », préface de Jacques Delcuvellerie, Sur la limite, vers la fin. Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à travers l’aventure du Groupov, Alternatives théâtrales, Hors-série 10, 2012, p. 13. Alternatives théâtrales avait consacré en 2001 un riche numéro à Rwanda 94. Le théâtre face au génocide / Groupov, récit d’une création (67-68) ; voir aussi dans son numéro sur la Choralité de 76-77 le texte très éclairant de Martin Mégevand sur les chœurs dans Rwanda 94.
[3] J.M. Piemme, dans Rwanda 94. Le théâtre face au génocide, op. cit ; J. Delcuvellerie, « La représentation en question », dans Laure Coret (dir.), Rwanda 1994-2004 : des faits, des mots, des œuvres, L’Harmattan, 2005, p. 131.
[4] Olivier Neveux, « Les noms qui sauvent ». Une opposition militante à l’idéologie du tragique » (à partir de Rwanda 94 du Groupov), in Paul Van den Berghe, Christian Biet et Karel Van Vanhaesebrock (dir.), Œdipe contemporain ? Tragédie, tragique, politique, L’Entretemps, p. 241-256
[5] Voir J. Delcuvellerie et M.-F. Collard, « Rwanda 94. Une tentative de réparation symbolique », in Le choc. Rwanda 94 : le génocide des Tutsi, op. cit., p. 262-288. Et, pour plus de précision, dans les actes du colloque évoqué à la note suivante, « Dans certaines conditions… (catharsis/génocide) », p 481-490. J’ai repris la notion de catharsis sous condition en lisant Imre Kertész dans Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, Armand Colin, 2015
[6] Rwanda 1994-2014 : histoires, mémoires, récits, actes du colloque coorganisé en 2014 à Versailles-Saint-Quentin, Paris-Diderot et ENS-Ulm par Virginie Brinker, Catherine Coquio, Alexandre Dauge-Roth, Nathan Réra, François Robinet, Les Presses du réel, 2017. Une demi-journée avait été consacrée au théâtre, où étaient intervenus Elizabeth Applegate, Jacques Delcuvellerie, Carole Karemera, Isabelle Lafon, Dorcy Rugamba, Armelle Talbot, Ariane Zaytzeff.
[7] Version française : Groupov. Rwanda 94. Éditions théâtrales. Passages francophones, 2002
[8] Version longue inédite. Voir sur cette réception les deux textes mentionnés note 4 et Laure Coret, « Rwanda 94 au Rwanda, dix ans après », in Rwanda 94-2004. Des faits, des mots, des œuvres, op. cit., p. 149-158
[9] Nota Bene conclusif de l’article « La résistible ascension du gladiateur », Études théâtrales, 26, 2003.
[10] Anathème (traduction du hébreu herem), mis en scène par Delcuvellerie, avec partition musicale (voix et orchestre) de Garret List et Jean-Pierre Urbano, a été donné au festival d’Avignon en 2005 et au Théâtre National de Bruxelles en 2006, où il a été enregistré en live sur deux CD, sous le titre Anathème. La traduction des textes bibliques est celle de Lemaistre de Sacy (1667), née dans l’héritage de la contre-réforme catholique, comme l’explique le livret de 30 pages qui accompagne les DVD, avec un choix de photos du spectacle et du décor : montage visuel réalisé par Marie-France Collard à partir des séries de la Yosemite Valley peintes par Albert Bierstadt, jouant sur ses variations lumineuses.