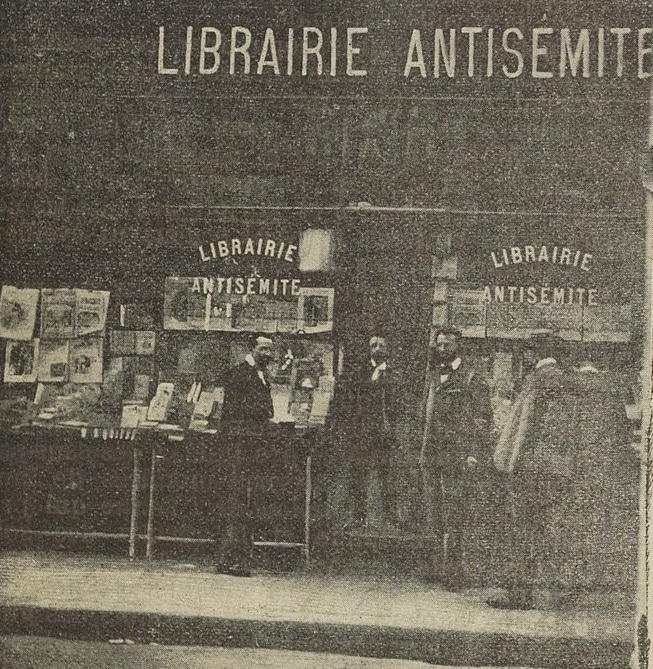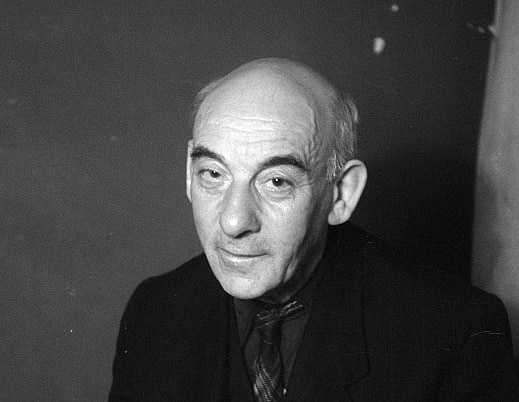Dans le cadre de ses recherches doctorales, l’anthropologue Violaine Baraduc s’est intéressée pendant douze ans aux femmes reconnues coupables de participation au génocide des Tutsi rwandais. Dans le premier livre qu’elle a tiré de ses enquêtes, Tout les oblige à mourir, elle revisite à l’échelle de la famille et au prisme de ce qu’elle nomme « l’infanticide génocidaire » les massacres qui ont eu lieu d’avril à juillet 1994. Les enfants du Rwanda héritant de « l’identité ethnique » de leur père, la chercheuse entend montrer comment ce « crime féminin, commis par des femmes hutu mariées à des hommes tutsi », a constitué la modalité de réaffiliation au foyer hutu par laquelle ces dernières, au prix de leur propre destruction en tant que mères, ont répondu à l’injonction génocidaire. Un travail monographique titanesque, mais dont certaines conclusions posent question. Notamment la reconstitution du « passage à l’acte » et des logiques d’action de ces femmes à partir de « ressorts affectifs » qui, face à la justice rwandaise et sa politique d’incitation à l’aveu, au pardon et à la réconciliation, auraient continué de guider leur allégeance au groupe familial hutu.
Dans les dernières décennies, de nombreux auteurs ont voulu mettre en lumière l’engrenage intellectuel et les précédents historiques qui ont mené à la mise en application d’un programme d’extermination des Tutsi. Violaine Baraduc insiste peu, quant à elle, sur la légitimation idéologique de la mise à mort par les tueurs. Elle dévoile plutôt, à mesure que l’étau se resserre autour de deux mères hutu et de leurs enfants tutsi, le jeu de contraintes à l’intérieur desquelles s’entremêlent les ressources matérielles et interpersonnelles, les configurations familiales et l’intime.
Difficile, pour bien saisir la singularité de cette démarche, de ne pas revenir en détail sur les cas de ces « infanticides génocidaires », concept qui mêle le contexte de la mise à mort, la mise à mort elle-même et l’action de la justice. La première de ces mères, Patricie Mukama, a empoisonné deux de ses quatre filles, âgées d’environ quatre et six ans. Bien qu’elle ait toujours maintenu, devant les juridictions rwandaises gacaca, que ses filles étaient mortes du choléra, elle a été condamnée en 2009 à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour infanticide. Dès le début du génocide, dans sa région de Karongi, sur les bords du lac Kivu, elle avait été harcelée et brutalisée par des igitero (groupes d’assaillants) à la recherche de son mari tutsi. Cinq ou six jours avant la mise à mort des deux fillettes, celui-ci, abandonnant tout espoir de survivre aux massacres, s’était pendu dans la cuisine de la maison familiale. Le lendemain, les igitero qui le traquaient y avaient fait irruption et menacé de déterrer son corps pour le profaner. Dans la foulée, Patricie Mukama avait rejoint avec ses quatre enfants le domicile voisin de sa sœur aînée, Julienne Mukarugerero. Hutu, celle-ci vivait avec sa fille et ses deux fils, également de père hutu, et nés respectivement en 1971 et en 1976. Par la suite, Patricie Mukama s’était sentie de plus en plus pressée par sa sœur de se réfugier ailleurs, voire de livrer ses filles aux tueurs. Alors enceinte de neuf mois, elle avait été débusquée au bout de trois nuits par des igitero, puis conduite devant une fosse avec ses enfants. Elle était parvenue à racheter leurs vies, non sans avoir été battue, mais, faute d’argent, elle n’était dès lors plus en mesure, seule, de soudoyer les tueurs pour les convaincre, momentanément, de renoncer à exécuter ses filles. Lorsque ces igitero s’étaient emparés de la génisse de Julienne Mukarugerero, celle-ci leur avait indiqué l’endroit où se cachaient sa sœur et ses nièces. De nouveau conduites devant la fosse, elles avaient été sauvées in extremis par des voisins qui s’étaient cotisés pour négocier le prix de leurs vies avec les tueurs. C’est vraisemblablement le jour suivant que Patricie Mukama amorça un projet de suicide collectif. Elle commença par faire ingérer de la mort aux rats à ses deux filles, déclenchant une agonie d’une vingtaine d’heures, au terme de laquelle elle demanda à ses deux neveux de l’aider à enterrer les corps. Le lendemain, elle accoucha. Quelques jours après, elle entreprit de se mettre en chemin vers le lac Kivu, pour s’y jeter avec sa fille de quinze ans, sa fille de deux ans et son nourrisson. Le jour du départ, elle réussit finalement à trouver refuge chez un enseignant hutu auquel son mari avait fait le don d’une vache par le passé, et elle survécut avec ses trois enfants restants.
La seconde mère, Béata Nyirankoko, originaire du Bugesera, purge depuis 2010 une peine de trente ans de prison pour infanticide. Devant la justice rwandaise, elle a reconnu qu’elle a tenté sans y parvenir de noyer ses deux fils dans la rivière Nyabarongo, vers le 12 juin 1994, avant de les abandonner à leur sort sur le bord d’un chemin le jour suivant. À l’instar de la première femme, elle avait été traquée par des igitero, qui avaient fait irruption dans la maison du voisin hutu chez qui elle avait furtivement trouvé refuge avec ses deux fils dans la soirée du 10 avril. Contre de l’alcool, celui-ci avait monnayé leurs vies et celle du mari de Béata Nyirankoko, caché, sans que sa femme le sache, au même endroit. Les assaillants avaient néanmoins promis de revenir ou de laisser à d’autres la tâche d’exécuter les enfants, âgés à l’époque de cinq et douze ans. Le mari de Béata Nyirankoko avait disparu quelques heures plus tard dans des circonstances jamais élucidées, pendant qu’elle s’était réfugiée chez un voisin, au domicile duquel elle avait ensuite passé une à deux semaines. C’est entre le 17 et le 24 avril qu’elle avait rejoint de nuit le foyer de ses parents, situé à plusieurs heures de marche. S’y trouvaient sa fille, née en 1987, mais aussi ses frères, qui participaient aux massacres. Sept jours après être arrivés, les deux garçons avaient été emmenés à la rivière Akanyaru par des igitero, qui les avaient finalement épargnés après avoir reçu une somme d’argent relativement importante des grands-parents, tenus en outre de fournir trois bidons de bière aux autorités locales.
Face à l’arrivée du FPR (Front patriotique rwandais, dirigé par l’actuel président Paul Kagame), à la mi-mai, Béata Nyirankoko avait finalement décidé de suivre son groupe familial dans sa fuite vers le Zaïre. La sommant avec de plus en plus d’insistance de tuer ses fils, son père et ses frères menaçaient de la dénoncer, ou de se charger eux-mêmes de la besogne. En arrivant dans la ville de Gitarama, d’où son mari était originaire et où elle pouvait être reconnue, elle décida de passer à l’acte, avant de poursuivre sa route vers le Zaïre, où elle arriva à la fin du mois de juin avec le reste de son groupe. Revenue au Rwanda en 1997, elle déclara aux autorités que ses fils avaient été identifiés comme Tutsi à un barrage, avant d’être découpés à la machette sous ses yeux.

Ces deux monographies s’inscrivent dans une configuration d’enquête dont l’ethnographie filmée a constitué le dispositif central. Entre 2011 et 2014, Violaine Baraduc a coréalisé avec Alexandre Westphal un long-métrage documentaire, À mots couverts, portant, depuis la prison où elles étaient détenues, sur huit femmes condamnées dans la foulée des événements de 1994 pour leur participation au génocide. Invitée à projeter son documentaire par divers directeurs d’établissements pénitentiaires y voyant une occasion de « sensibiliser les prisonniers à l’aveu », la chercheuse a créé, sans l’avoir anticipé, des opportunités de prise de parole et d’échanges qui, explique-t-elle, ont eu une grande « force heuristique ». Violaine Baraduc a estimé que, ne faisant que répéter la confrontation judiciaire, le procédé consistant à interroger les prisonnières condamnées par les juridictions gacaca sur leur « parcours génocidaire » s’était avéré infructueux. À partir des échanges entre prisonnières, des archives judiciaires qu’elle a consultées et des entretiens qu’elle a réalisés par la suite, elle parvient dans Tout les oblige à mourir à éclairer de façon saisissante l’entremêlement dans un même processus des mécanismes de l’aveu, des modes d’élaboration des récits des personnes incriminées, et des rouages du système judiciaire.
L’autrice explique que la criminalité féminine est restée dans l’ombre de la criminalité masculine jusqu’à ce que les collectes d’informations à l’échelle locale, en préparation, à partir de 2002, des juridictions gacaca ne rattrapent un nombre important de celles qui s’étaient livrées à des actes de torture et à des actes dégradants sur les cadavres. Ne s’attendant plus à devoir répondre de leurs actes, beaucoup imaginaient encore moins que des témoignages faisant état de crimes intrafamiliaux, voire d’infanticides, seraient portés à l’attention des tribunaux.
Dès 1994, le gouvernement issu des rangs de la rébellion du FPR entendit traduire en justice tous les « génocidaires » et œuvrer à la réconciliation nationale. Les criminels hutu réfugiés dans les camps au Zaïre furent invités à revenir au Rwanda pour y répondre de leurs actes, tandis que ceux qui n’avaient pas pris part aux massacres étaient assurés qu’ils ne seraient pas inquiétés. Dans les semaines suivant l’attaque du camp de Mugunga par les forces rwandaises, du 14 au 17 novembre 1996, 600 000 des 750 000 réfugiés recensés par les organisations humanitaires retournèrent au Rwanda. La trace des 150 000 Hutu manquant à l’appel a été perdue, et il ne fait aucun doute qu’un nombre important d’entre eux ont été liquidés sur place.
Si la nature du crime d’infanticide tout comme la catégorisation de la peine censée lui correspondre sont difficiles à établir, c’est qu’elles entrent difficilement dans les trois catégories de criminels établies par les autorités rwandaises dix ans après le génocide : premièrement, les responsables, planificateurs et leaders, meurtriers de renom, tortionnaires, violeurs et personnes ayant dégradé des cadavres ; deuxièmement, les meurtriers ordinaires et assaillants ayant visé à tuer sans y parvenir (première sous-catégorie) ainsi que les assaillants n’ayant pas visé à tuer (deuxième sous-catégorie) ; et enfin, les pilleurs. Parallèlement, le gouvernement incitait les personnes ayant participé au génocide à avouer leurs crimes, à se repentir et à demander pardon aux victimes. Ce fut tout d’abord le cas dans les prisons, où des clubs furent créés, avant que la même loi ne promeuve « la procédure d’aveu, du plaidoyer de culpabilité, du repentir et d’excuses ». Les peines prévues étaient moins lourdes pour les personnes ayant avoué leurs crimes avant d’apparaître sur une liste de suspects que pour celles passées aux aveux après que leur nom y figure ; les peines les plus sévères étaient réservées à ceux qui refusaient de passer aux aveux.
Mais cette catégorisation des criminels ainsi que les échelles de leurs peines ont ensuite connu d’autres modifications. En 2007, date de l’abolition de la peine de mort (qui n’était plus appliquée depuis 1995), les personnes ayant dégradé des cadavres sont passées dans le premier sous-groupe de la catégorie 2, les tueurs ordinaires dans le second. Violaine Baraduc cite la thèse de l’historien Rémi Korman, qui rapporte que, dans le cadre de la conférence internationale sur le génocide organisée en 1995 au Rwanda, la question fut posée, mais jamais intégrée aux différentes versions de la loi gacaca, d’inclure dans la catégorie 2 « la trahison de position de confiance », impliquant le clergé, les époux et les parents.
Dans un tel cadre juridique, « l’étude de l’infanticide génocidaire n’est pas simple, car elle suppose que le crime ait été compris et identifié par ceux qui y ont survécu, ceux qui ont pu le constater, voire même par celles qui l’ont commis, puis qu’il ait été porté à la connaissance des autorités administrative ou judiciaire ». L’autrice considère ce phénomène comme « paradigmatique », non seulement parce qu’il conduit « immanquablement à une restructuration familiale », mais aussi parce qu’il « éclaire à l’échelle la plus réduite les difficultés de surmonter un tel événement, dans un contexte où tout est amplifié par l’intimité des rapports entre bourreaux et victimes, ainsi que par le poids des liens rattachant chaque individu à un groupe, à un territoire, mais aussi à une lignée ».
Comme le montre Violaine Baraduc, la collecte d’informations mise en branle par le gouvernement recueille les signalements de rescapés ou de citoyens épris de justice, autant qu’elle canalise des rancœurs ou offre un cadre juridique dans lequel les uns et les autres espèrent trancher des litiges qui n’ont pas forcément à voir avec le génocide. Aussi ces informations proviennent-elles d’une pluralité d’environnements sociaux (la cellule, les prisons, mais aussi la famille) et reposent-elles sur des témoignages susceptibles de permettre l’identification ou la localisation de restes humains.

On voit ainsi que la dénonciation de faits entraîne d’abord la réélaboration de récits davantage que le passage aux « aveux ». Patricie Mukamana est dénoncée en 2007 par une voisine, qui met aussi en cause sa sœur, et donne plusieurs versions successives de la mise à mort et de l’enterrement des fillettes. Dans le cas de Béata Nyirankoko, c’est son fils aîné, Moïse, marginalisé économiquement et socialement, désaffilié aussi bien de sa lignée maternelle que de sa lignée paternelle, non reconnu administrativement comme rescapé du génocide, qui, en 2007 ou 2008, adresse une lettre aux juridictions gacaca avec le soutien de son frère Alphonse.
Tenues de répondre des actes dont elles sont soupçonnées, les personnes mises en cause incorporent dans leur récits la mémoire collective orientée depuis les plus hautes sphères de l’État vers la souffrance commune et la réconciliation. Leurs explications incluent également leur compréhension des modes de catégorisation des crimes dont elles sont susceptibles d’être reconnues coupables. L’autrice décortique avec perspicacité, dans le cadre juridique, ce qui relèverait du déni ou du mensonge, du calcul ou de normes de langage, le procès étant « par excellence le lieu d’expérimentation des récits, à partir duquel le passé des acteurs et des actrices est aménagé et revu ».
Béata Nyirankoko a reproduit le discours de la réconciliation rwandaise, qui réincorpore Tutsi et Hutu au sein d’une même appartenance nationale, les premiers comme victimes de la furie génocidaire et les seconds de l’emprise d’une « mauvaise politique », voire du Diable. « Je souhaitais juste retrouver la paix que les enfants m’avaient arrachée, car moi aussi on voulait me tuer », a-t-elle fini par rétorquer aux juges sans mettre en cause le rôle de ses frères et en insistant au contraire sur celui d’un groupe de miliciens extérieurs à la famille. Violaine Baraduc relève que la peine qui lui a été infligée n’est pas conforme à la catégorisation des crimes, puisque qu’elle ne correspond pas à la catégorie 2 dont elle a été reconnue justiciable, à moins de supposer que les juges ont estimé qu’il s’agissait d’un crime hybride (terme que l’autrice n’emploie pas) et qu’ils ont été saisis d’effroi (patriarcal) face au cas d’une mère tentant de prendre la vie de ses propres enfants. Patricie Mukama a maintenu depuis sa première comparution en 2007 la version selon laquelle ses fillettes étaient mortes du choléra. Les juges considérant que sa sœur, Julienne Mukarugerero, et ses deux fils masquaient volontairement les circonstances exactes dans lesquelles les fillettes avaient perdu la vie, tous les quatre ont été condamnés à la même peine, quinze ans de réclusion, à l’issue du second procès en appel en 2009. À partir de ce moment-là, Julienne Mukarugerero a cessé d’adresser la parole à sa sœur, qu’elle a rendue responsable de la dislocation de la famille, au grand désarroi de Grâce, la fille de Patricie Mukama, qui juge que sa mère doit se réconcilier avec sa sœur et que toutes les deux sont tenues de s’accorder le pardon mutuel, car « c’est le Diable qui était monté sur la Terre ».
Violaine Baraduc offre un éclairage particulièrement intéressant sur ce que l’on serait alors tenté de nommer « le travail de l’aveu ». Entre reconstitution des faits, rationalisations et justifications, une subjectivité émancipatoire peut jaillir ou rejaillir dans le dialogue qu’entretiennent les accusées, qu’il soit public (face aux juridictions gacaca), semi-privé (au sein des clubs d’incitation aux aveux, ou en situation d’entretien avec l’anthropologue) ou intime. C’est en 2014, plusieurs années après son procès, que Patricie Mukama a fini par reconnaître, en prison, dans le cadre des activités du club « anti-crime », qu’elle avait empoisonné ses deux filles. Elle a expliqué à cette occasion que c’était la pression exercée par sa sœur, ajoutée à son refus de la soutenir et notamment de lui fournir de la nourriture, qui l’avait poussée à agir. Patricie Mukama se libère ainsi d’un poids moral, mais doit faire face à l’animosité de sa sœur. L’aveu engendre chez elle une remise en contexte du récit des événements qui, nous dit Violaine Baraduc, révèle de la sorte la centralité de la configuration familiale.
Le cas de Béata Nyirankoko étant différent de celui de Patricie Mukama (puisque ses enfants ont pu témoigner de la tentative d’infanticide à laquelle ils ont échappé), c’est en entretien qu’elle a divulgué les affres de son union avec le père, dévoilant l’influence des liens conjugaux et de parenté dans le déroulement des événements de 1994. Rejetée à plusieurs reprises par son mari, notamment durant toute la période où elle était enceinte de leur fille, elle n’avait jamais été acceptée par sa belle-famille tutsi. Quant à sa famille hutu, elle avait manifesté des signes d’hostilité envers son mari, d’autant plus que le foyer était démuni. C’est à partir de ces éléments que Violaine Baraduc fait apparaître le postulat épistémologique central de sa thèse : « l’histoire de l’aveu éclaire l’histoire du meurtre, l’un et l’autre engageant les mêmes ressorts affectifs ».
D’après Violaine Baraduc, le fait de se soustraire aux accusations ou de se murer dans le récit victimaire répondrait à des logiques de protection individuelle qui masquent des dynamiques intrafamiliales. Pour exhumer les temporalités dans lesquelles se sont inscrits « les meurtres », elle s’appuie tout particulièrement sur l’expression « ne plus avoir de marché » (kubura isoko en kinyarwanda), répétée maintes fois par Patricie Mukama et dont elle interprète progressivement le sens. Reprenant les analyses de José Kagabo et de Claudine Vidal, selon lesquelles, dans la société rwandaise agnatique et virilocale, les femmes et leurs enfants perdaient « toute trace de l’origine maternelle », Violaine Baraduc explique que les femmes hutu, après avoir perdu leur mari, ont été « tenues de se réinventer dans la plus totale urgence » et n’avaient guère « d’autre choix que de rechercher le soutien de leur famille d’origine ». De là viendrait la contrainte de « se désaffilier de leurs enfants, après une première désaffiliation d’avec le mari, même symbolique ».
Dans le sillon des travaux de Jean-Pierre Chrétien et de Rémi Korman, qui, entre autres chercheurs, avaient décrit l’appropriation sociale et donc subjective et aménageable des « identités ethniques », Violaine Baraduc montre que c’est au cours de cette phase de réaffiliation que s’est opéré le tri entre enfants « sauvables », car non perçus comme tutsi, et enfants « tuables ». Dans le cas de Patricie Mukama et dans ceux que l’autrice rapporte brièvement à la fin de son livre, la sélection semble avant tout « fortuite ». L’exemple des enfants de Béata Nyirankoko est en revanche paradigmatique : Sarah, qu’elle a emmenée avec elle au Zaïre, a été élevée par ses grands-parents maternels et entretenait avec eux des liens affectifs forts, à la différence de ses frères, dont même les noms de baptême reflétaient les tensions au sein du couple formé par leurs parents. Ces femmes « démonétisées » (« qui avaient perdu leur marché »), conclut l’autrice, ont été « remises au cœur de la famille par le projet génocidaire, se trouvant chargées de défaire celle qu’elles avaient créée ».
Le cœur de la thèse de Violaine Baraduc peut être discuté de plusieurs façons. On peut considérer qu’en insistant sur la structure patrilinéaire de la société rwandaise dans le contexte d’extermination des Tutsi, l’anthropologue inscrit le génocide dans une logique à la fois transactionnelle et fonctionnaliste (au sens sociologique). Elle se demande ainsi dans la conclusion du livre si ces infanticides sont un « paradigme du patriarcat », ou un « paradigme du génocide ». Faire de la « démonétisation » de ces mères isolées et appauvries le ressort de leur réaffiliation implique de considérer leurs enfants comme une monnaie d’échange et leur capital. La dimension fonctionnaliste de la thèse réside dans l’idée que le projet génocidaire assigne un rôle aux mères qui sacrifient leurs enfants. Celles-ci s’en acquittent, de telle façon que la logistique génocidaire accomplit une fonction de restructuration ethnique en extirpant les enfants tutsi des familles mixtes. Le danger extrême et le resserrement des contraintes matérielles et interpersonnelles créent dans le même temps des tensions fonctionnelles dans l’accomplissement du projet infanticide. L’autrice prend bien garde, par ailleurs, de souligner les différences entre les deux cas étudiés, et ajoute à ses deux enquêtes monographiques des références aux « parcours miliciens » de femmes de pouvoir ayant perpétré des infanticides.
Néanmoins, montrer comment ces contraintes fonctionnelles s’articulent avec des choix et une forme de rationalité individuelle relève d’un équilibre descriptif difficile à tenir. À propos du cas de Béata Nyirankoko, l’autrice écrit par exemple que « ce tri entre enfants « tuable » et « sauvable » témoigne d’un engagement pouvant être qualifié de « volontaire » dans le génocide, en dépit des contraintes ayant pesé sur elle ». Dans le même passage, elle explique que cette femme, ses frères et ses parents avaient les moyens de faire survivre Moïse et Alphonse, et que « dans ce cas, c’est bien l’idéologie génocidaire qui est à l’origine de la pression exercée par ses frères sur leur sœur ». La décision de Patricie Mukama serait pour sa part « contrainte », dans la mesure où elle aurait agi par « peur panique », étant avant tout sans ressources et « subordonnée » au fort caractère de sa sœur aînée.
Les choix rationnels que Violaine Baraduc prête aux protagonistes relèvent ainsi parfois de déductions fragiles, qui ne permettent guère de dévoiler leur subjectivité intime ou de leur imputer des décisions individuelles, par exemple quand elle se demande si Patricie Mukamana a tué ses filles « pour répondre à ce qu’elle croyait être la demande de sa sœur » et qu’elle tend à penser qu’elle a, « avec ce sacrifice », « négocié une nouvelle place » auprès de celle-ci.
L’anthropologue entend jusqu’à « isoler les causes exactes de chaque infanticide » et, par exemple, éclairer dans cette perspective « la cause du basculement [de Patricie Mukama] qui jusque-là avait essayé de faire survivre tous ses enfants ». Il n’est guère aisé finalement de faire la part des choses entre ce qui relève de « causes », de « critères de décision » et de « facteurs », catégories d’analyse que Violaine Baraduc utilise parfois de façon interchangeable. Même réinscrites dans un cadre chronologique pertinent, celles-ci restent des éléments de contexte, que l’on retrouve en fait comme motifs, raisons ou justifications dans les récits des deux mères. « L’aveu » combine certes une part de rationalisation forcée et une forme « libérée », mais c’est fondamentalement l’argument selon lequel l’histoire de l’aveu éclaire l’histoire du meurtre qui pose problème. Les configurations de la violence ne s’inscrivaient-elles pas dans un contexte plus imprévisible encore que celui décrit par Violaine Baraduc, et, de là, les narratrices sont-elles seulement en mesure de restituer le rôle exact des aléas et la totalité de leurs réactions jour après jour, voire heure par heure ?

Englobé dans des jeux de langage, l’intérêt qu’il y a à se présenter comme victime est sûrement pour une part stratégique, mais, simultanément, la confusion, l’imprécision, ou une limite à la capacité de rendre compte de ses propres actes, indiquent bien des formes de division subjective qui échappent aux narratrices. Violaine Baraduc n’y est pas forcément sensible, par exemple lorsqu’elle demande à Béata Nyirankoko, l’interrogeant au sujet de sa fille : « comment une personne qui n’a pas été pourchassée peut-elle être rescapée du génocide ? ». Ou quand elle écrit à propos de Patricie Mukama : « La régularité de son récit concernant les circonstances de la mort de son mari tranche aussi avec la confusion qui caractérise le plus souvent ses déclarations et son attitude, tout particulièrement celle dont elle fait preuve quand elle parle du meurtre de ses fillettes. « Parler de cette histoire me détruit », m’a-t-elle dit un jour. » Fallait-il alors reconstituer le fil d’une agonie de vingt heures, comme l’a entrepris l’anthropologue, dans un va-et-vient entre le possible impact psychique sur la mère et l’hypothétique récapitulation clinique des effets du poison sur les organes de ses filles ? Ces scansions tenant davantage de dérives psycho-analysantes et autres supputations pharmacologisantes, elles se révèlent hors de propos.
Les explications confuses des unes et des autres reflètent donc peut-être tout à la fois l’éclipse des horizons d’intelligibilité et la rupture de leur permanence en tant que sujets, durant les semaines de violence et de danger extrême de 1994. C’est la piste que Violaine Baraduc ouvre à plusieurs reprises – sans toutefois l’explorer davantage –, notamment lorsqu’elle estime finalement que le « renoncement à ses fils » de Béata Nyirankoko ne doit pas être vu « comme la conclusion d’une suite d’actions motivées par le calcul et l’intérêt » et qu’elle insiste au contraire sur la réactivation de « dispositions identitaires des acteurs sociaux » par « la propagande génocidaire, la guerre et la généralisation des massacres ». « Autrement dit, conclut-elle, il faudrait penser le processus de désaffiliation, dont l’infanticide est le point d’orgue, comme une suite continue d’actions et de prises de décisions mobilisant avant tout le sens pratique des agents en situation d’immense tension, et très dépendante du contexte de l’action. »
En effet, Violaine Baraduc est loin de prétendre que les acteurs étaient capables de se représenter la somme et l’étendue des formes de danger auxquelles ils faisaient face. Mais pourquoi alors analyser l’absence de scansions repérables comme indice contenu dans les récits spontanés de Patricie Mukama à la lumière de son « inconscient linguistique » ? Cet indice est peut-être d’une autre nature, surtout s’il est mis en relation avec sa présentation de soi comme victime d’une violence continue depuis 1994. Une telle piste est en effet susceptible de révéler une autre forme de subjectivité : la perception d’un continuum à l’intérieur duquel les formes de la violence, les façons de faire face et les différences de situations deviennent indissociables. La reconstitution des événements, aussi attentive soit-elle à la chronologie, ne reflète pas forcément l’appréhension désarticulée et fluctuante de ce type d’expérience extrême – et peut sans doute conduire à trop isoler ces « infanticides génocidaires » de cette succession de violences à visages multiples.
Toutes ces perspectives auraient permis d’insister davantage sur les moments où les deux mères évoquent la mise à mort de leurs enfants comme un moyen de leur épargner de pires souffrances : mourir de faim ou découpés à la machette. Comment comparer les cas étudiés par Violaine Baraduc à la situation de mères tutsi esseulées d’enfants de pères hutu1, aux suicides collectifs de familles, ou encore aux infanticides commis par des pères ? Alors que l’épigraphe de l’ouvrage reprend un passage de Médée dans lequel la mère mythique échafaude le projet de tuer ses enfants pour « ne pas laisser [ses] petits se faire massacrer par une main plus ennemie », Violaine Baraduc se contente de parler indifféremment de « double meurtre », de « projet de meurtre », de « projet criminel », du « projet génocidaire sélectif », ou encore du « basculement dans la criminalité génocidaire », comme si elle reproduisait l’impensé juridique de la loi et des juridictions gacaca. Même si elle dévoile la part contrainte de ces mises à mort, les considérer sous le seul angle du mécanisme de reformation du groupe patriarcal hutu conduisait forcément à adjoindre à « infanticide » l’adjectif « génocidaire ». Faire ressortir le geste de protection aurait fait disparaître ce dernier qualificatif et, plus encore, la division mère hutu/mère tutsi.
Un détour par l’historiographie de la Shoah est sur ce point éclairant. Dans son étude sur la chasse aux Juifs cachés en Pologne du côté aryen après la liquidation des ghettos et les déportations dans les camps, Jan Grabowski 2 a décrit un ensemble de comportements protecteurs, depuis la mise à mort d’enfants promis à une agonie atroce, jusqu’au dépôt d’un tout-petit au physique « neutre » devant le domicile d’un couple polonais dont les parents savaient qu’ils ne pouvaient pas procréer, en passant par le sacrifice d’un membre d’une fratrie pour que les autres aient davantage de chances de survivre dans leur fuite collective. Pris dans un sauve-qui-peut permanent, les parents n’ont fait que réagir perpétuellement, sans jamais pouvoir anticiper les conséquences de leurs actions. Que dire de Vladek et Anja Spiegelmann, Juifs polonais survivants de la Shoah3, dont le fils, Richieu, âgé de cinq ans en 1943, fut empoisonné par la tante à qui il avait été confié, avant que celle-ci ne prenne sa propre vie et celle de ses deux enfants, afin de leur éviter à tous d’être envoyés dans un camp d’extermination ? On pense encore à Calel Perechodnik4, policier juif du ghetto de Lodz, qui, prévenu de la date de l’aktion, prévoit d’emmener ses enfants au départ du train, pour les soustraire à la déportation au dernier moment et ensuite les cacher « en sécurité », mais finit par assister impuissant à leur départ pour Treblinka. Il écrira dans son journal, retrouvé en 1945 dans les décombres : « Suis-je un meurtrier ? »
Ces remarques n’enlèvent rien à la richesse extraordinaire de l’enquête ethnographique de Violaine Baraduc et à sa façon stimulante de proposer une explication anthropologique et microhistorique des massacres de 1994. On peut tout de même se demander, d’un point de vue explicatif précisément, si le concept d’infanticide génocidaire doit vraiment être « vu comme l’épicentre du phénomène génocidaire : à la fois le point par lequel la violence se lit, et celui où elle est ressentie le plus violemment ». On sait combien le concept de « zone grise » a été utilisé à mauvais escient dans les sciences sociales et en histoire, lorsqu’il a visé à expliquer toutes sortes d’ambivalences et d’ambiguïtés en situation de domination. Dans la mesure où l’horizon promis aux Tutsi était l’exécution, à l’instar de celui promis aux Juifs, il aurait peut-être été opérant. À une exception près dans les cas rapportés par Violaine Baraduc, les mères hutu ayant sacrifié certains de leurs enfants ont continué de protéger les frères et sœurs qui leur avaient survécu. De cette façon, elles n’ont plus jamais cessé d’être « génocidables » ou « tuables ».
- La question des enfants de père tutsi sous la protection de leur mère hutu présente des similitudes avec les cas d’enfants non catégorisés racialement comme juifs par les nazis, mais à la charge du parent juif restant, et dont le statut de Mischlinge, réévalué au gré des circonstances et à la discrétion des bourreaux, avait parfois mené à leur extermination. ↩︎
- Jan Grabowski, Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, Indiana University Press, 2013. ↩︎
- Art Spiegelman, Maus, Flammarion, 1998. ↩︎
- Calel Perechodnik, Suis-je un meurtrier ?, traduit par Aleksandra Kroh et Paul Zawadzki, préface d’Annette Wieviorka et Jacques Burko, Liana Levi, 1995. ↩︎
Vincent Bloch, enseignant à la New York University, est sociologue et anthropologue. Il est notamment l’auteur de La lutte. Cuba après l’effondrement de l’URSS (Vendémiaire, 2018)