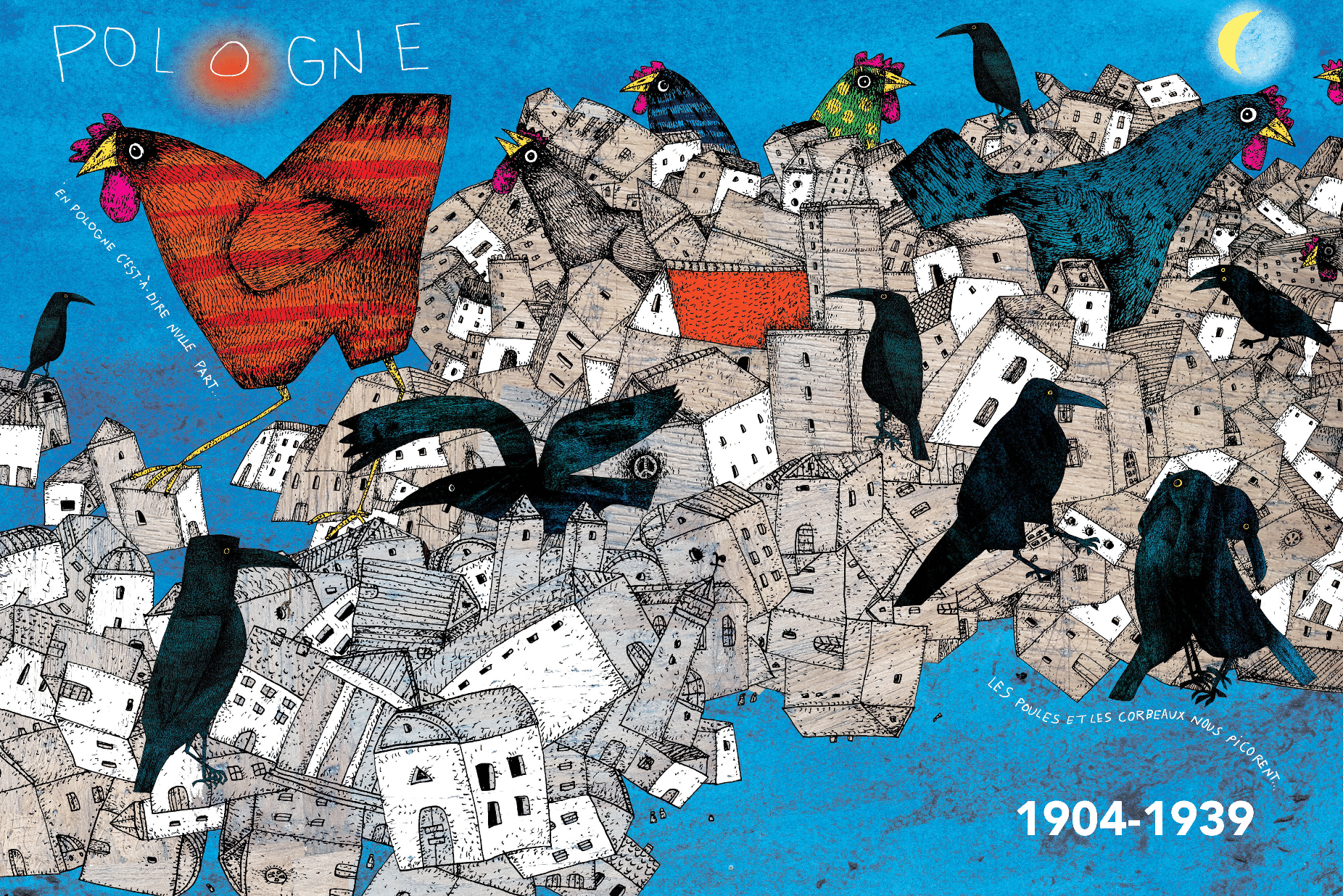Si vous avez l’envie, bien compréhensible, de fuir votre pays pour partir en voyage, lisez d’abord Renoncer aux voyages. Savante, puisant autant à la littérature qu’à la philosophie ou aux sciences sociales, cette enquête philosophique de Juliette Morice fait le tour de la question et analyse une pratique à la fois louée et décriée.
Le voyage offre toutes les promesses du « ressourcement », de la « découverte de l’autre », du « changement d’air et de décor » où le plaisir hédoniste rencontre l’espoir d’un approfondissement personnel. Aujourd’hui démocratisé grâce aux vols low cost, le voyage est devenu une norme sociale. Parallèlement, il n’a jamais été autant remis en cause. Ciel sillonné d’avions, États autoritaires auxquels les touristes donneraient une caution, lieux défigurés, situation coloniale du vacancier servi, sentiment nauséeux de participer à une industrie de la fausseté, l’authenticité ayant disparu.
Voyager serait aisé mais, paradoxalement, impossible. Faudrait-il rester chez soi et se condamner au familier ? Est-ce bien le moment de cesser d’aller à la rencontre de l’inconnu ? Notre rapport au voyage semble avoir tous les traits de l’époque. La philosophe Juliette Morice bat en brèche notre narcissisme : rien de nouveau sous le soleil, le voyage pose problème depuis longtemps. Son livre distingue plus particulièrement deux interrogations récurrentes : à quelles conditions le voyage est-il un moyen de connaître le monde ? Y a-t-il un bon et un mauvais voyage ?
Chez les philosophes, le refus du voyage repose sur une critique du mode de connaissance qui le sous-tend. Voyager, c’est faire confiance à ses sens, le regard au premier chef, et le voyageur acquiert des connaissances grâce à un processus d’induction qui se passe d’outils théoriques. Montaigne recommandait une solide formation pour le jeune voyageur. Mais, face à l’inconnu, le voyageur procède toujours par des tâtonnements tous azimuts, sans méthode. Kant écrit ainsi : « Grand merci au voyageur purement empirique et à ses récits, spécialement quand il s’agit d’arriver à une connaissance cohérente, dont la raison doit se servir pour confirmer une théorie ! » Pourquoi voyager alors que l’on peut, comme celui qui ne sortit jamais de Königsberg, lire des récits de voyage ? Si le but du voyage est la connaissance du monde, méditer sur les récits des autres paraît plus rationnel, et moins dangereux. Encore faudrait-il pour cela qu’il y ait des voyageurs. L’autrice développe ce « paradoxe kantien qui rendait la pratique du voyage à la fois nécessaire et dispensable. Lire des récits de voyage, puiser son savoir du monde chez d’autres auteurs, c’est concevoir la possibilité d’une expérience indirecte du monde, c’est-à-dire d’un voyage par l’intermédiaire des autres ».
La dimension cognitive du voyage est d’autant plus problématique qu’elle repose sur des récits. Sans surprise, ce livre analyse des textes philosophiques mais aussi d’écrivains, de Chateaubriand à Nicolas Bouvier. La question du point de vue s’impose donc, et avec elle celle de la fiction : a beau mentir qui vient de loin. L’autrice rappelle que l’opposition entre philosophe et voyageur était déjà forte du temps de Bougainville. Avant d’appartenir à cette catégorie haïe par l’auteur de Tristes tropiques, l’explorateur écrivait : « Je suis voyageur et marin ; c’est-à-dire, un menteur, et un imbécile aux yeux de cette classe d’écrivains paresseux et superbes qui, dans les ombres de leur cabinet, philosophent à perte de vue et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations. » À la mise en doute de la véracité des récits de voyageurs à la fin du XVIIIe siècle, succède le voyage romantique. Celui-ci déplace la question en mettant en avant « l’authenticité d’une expérience de voyage », et non plus la véracité des informations rapportées. Plus proche de nous, l’ethnographie, Lévi-Strauss en tête, a dénoncé l’incapacité du voyageur à énoncer autre chose que des trivialités ou des clichés. L’autrice suggère que l’opposition entre penseurs et voyageurs redouble celle des philosophes et des écrivains. Vincent Debaene, dont L’adieu au voyage est cité (Gallimard, 2010), a retracé cette dynamique historique conduisant l’ethnologue à damer le pion à l’écrivain voyageur. L’approche scientifique aurait graduellement « dépossédé » la littérature de son potentiel cognitif. En formulant une méthodologie scientifique robuste et une écriture correspondante, l’ethnologie aurait détruit le récit de voyage comme outil de connaissance du monde.

À cette condamnation de l’utilité du voyage se superpose une question morale : il y aurait un bon et un mauvais voyage. Le voyageur qui va lentement, par gradation, aurait-il une supériorité sur l’instantané des avions ? La chercheuse explore en phénoménologue le voyage à pied, en train, en automobile, à bicyclette… À travers cette étude des modalités de mettre le corps en mouvement, l’ouvrage se livre à une critique en règle de la doxa « alternative » ou « contre-culturelle » selon laquelle certains voyages seraient plus « authentiques » que d’autres. La question reste un grand classique des conversations de backpackers en pays lointains. Untel voyage à pied depuis deux ans. Un autre a eu la chance de se faire kidnapper quelques jours par des paysans kurdes. Mais une autre encore a pris du peyotl avec de vrais Amérindiens, etc. Dans cette grande foire aux vanités et au jeu de distinction radical chic, il y a toujours meilleur voyageur que soi. Comme Juliette Morice est sérieuse, elle s’est abstenue de citer le guide de voyage de la Molvanie, livre où l’on peut lire la phrase suivante : « Si vous n’avez pas dormi entre deux poubelles dans une rue malfamée de Lutenblag (la capitale), vous n’avez pas vu la Molvanie. » En somme, sur ce gradient, plus le voyage se rapprocherait de l’aventure, donc du risque, particulièrement celui de mourir, plus on se rapprocherait du vrai voyage. L’aventure, l’ennui, le sérieux de Jankélévitch est ici abondamment cité et on trouve des analyses pénétrantes des textes de Nicolas Bouvier et de son goût pour la mise en danger, symptôme d’une certaine idéologie viriliste. Le risque, avec tout ce qu’il a de bien réel et concret, se présente comme le signe de l’aventure, antidote supposé au tourisme dont le tracé balisé signalerait la fausseté. Mais ce « tourisme de l’aventure » a sa vanité : rechercher l’imprévu se révèle forcément contradictoire.
Modulation sur la question du vrai et du faux voyage, une autre interrogation se fait jour : qu’est-ce qui distingue le bon du mauvais voyageur, c’est-à-dire le voyageur du touriste ? Selon Juliette Morice, le touriste se repère grâce à trois stigmates : « attachement à l’image (surtout photographique), pratique du vandalisme, recours au guide ». Tout de suite, on imagine un idéal-type de touriste de classe moyenne occidentale, selfie stick au bout du bras face à quelque pyramide, courant à la première boutique de souvenirs. Nerval avait une autre allure. Las ! Il est aisé de démontrer que Victor Hugo (vandale autoproclamé) ou Chateaubriand donnèrent dans ces pratiques, nullement réservées au touriste contemporain. Accumulation matérielle (Elgin et ses marbres…), focalisation sur le pittoresque et le monumental au détriment des populations locales. Plus profondément, dans sa volonté d’échapper aux sages repères fixés par les guides, le touriste est fatalement attiré par l’endroit non touristique… qui le devient par sa seule présence. Le voyageur se retrouve « prisonnier d’une double contrainte, condamné ou bien à renoncer au voyage, ou bien à devenir ce qu’il ne veut pas être : un touriste ». Ici, le propos s’appuie sur l’anthropologue Jean-Didier Urbain dont on recommande le salubre travail de relativisme et de démystification. Résumons-le trivialement par : « Le touriste c’est l’autre du voyageur. » Le touriste, c’est celui qui ne fait pas un vrai voyage. Bien malin celui qui déterminera les signes de cette vérité, comme le fait remarquer l’anthropologue. Le vrai voyage n’existe pas plus que le bon voyageur. Tous des touristes !
En somme, le récit de voyage se serait vu supplanté par les sciences sociales, et la distinction entre touriste et voyageur aurait tout d’une opposition factice. On hasardera pourtant qu’en voyage certains voient différemment mais surtout mieux que d’autres. Prenons, par exemple, les récits de voyage politique, absents de ce livre. Ce sont souvent des moments de lucidité, ou d’aveuglement. Quand Trotski raille les « touristes radicaux » parcourant l’Union soviétique de la fin des années 1920, il vise les intellectuels occidentaux incapables de voir au-delà des mensonges qu’on leur sert. À l’inverse, certains voyageurs, par culture politique, appartenance de classe, ou les deux, surent discerner la vérité du régime ou, si l’on préfère, du pays. Pensons à André Gide ou Panaït Istrati, dont les récits de voyage révélèrent l’envers du décor. À la même période, Georges Duhamel écrivit un récit laudateur sur la Russie soviétique (Le voyage de Moscou, 1927) tandis qu’Ella Maillart (Parmi la jeunesse russe, 1932) publiait le récit de ses randonnées dans un Caucase peuplé de sympathiques prolétaires… Quatre voyages dans les mêmes lieux (parcours fléché par les autorités oblige) et à la même période. Quatre récits sans doute rédigés avec une égale sincérité. Les deux premiers dirent la vérité, les deux autres passèrent à côté. Ajoutons que Gide et Istrati, dénués de toute méthode autre que littéraire, surent aller au fond des choses, avec exactitude. Il n’y a peut-être pas de voyage faux ou vrai, mais seuls certains permettent une connaissance de la vérité.
La facticité est donc la notion centrale de cette question du voyage. Qui à l’étranger n’a jamais éprouvé la démoralisante sensation d’être soit face à du carton-pâte, soit face à de l’identique ? Analysant la notion d’exotisme, la chercheuse y voit le signe de ce qui a disparu, qui nous est extérieur, mais que l’on saisit pourtant. L’exotisme apparaît et signale un « vrai voyage », mais il est toujours situé dans le passé, quand il n’y avait pas encore de touristes. C’est le costume traditionnel porté par une vieille dame dans un village balkanique, ou une fête religieuse qui aurait perduré au fond d’une vallée italienne. Survivances au sein d’un monde censé être de plus en plus uniforme. D’où la mélancolie de tant de voyages où, peut-être, les kilomètres sont avalés pour rejoindre une époque révolue, pure, et plus précisément pure… de touristes. Le voyageur se mord la queue.
Face à ce constat, tout au plus pourrions-nous, selon Juliette Morice lisant L’Afrique fantôme de Leiris, élaborer une éthique du voyage qui commencerait par admettre l’impureté constitutive de tout voyage. Continuer à partir donc, car la chose reste possible et peut avoir une valeur, mais sans perdre de vue que nous balancerons toujours « entre déception et espoir renouvelé de parvenir à ‘’toucher’’ quelque chose . Cette condition incertaine, précaire, fragile et toujours en mouvement n’est-elle pas la plus lucide et la plus sage qui soit, pour n’importe quel voyageur ? ».