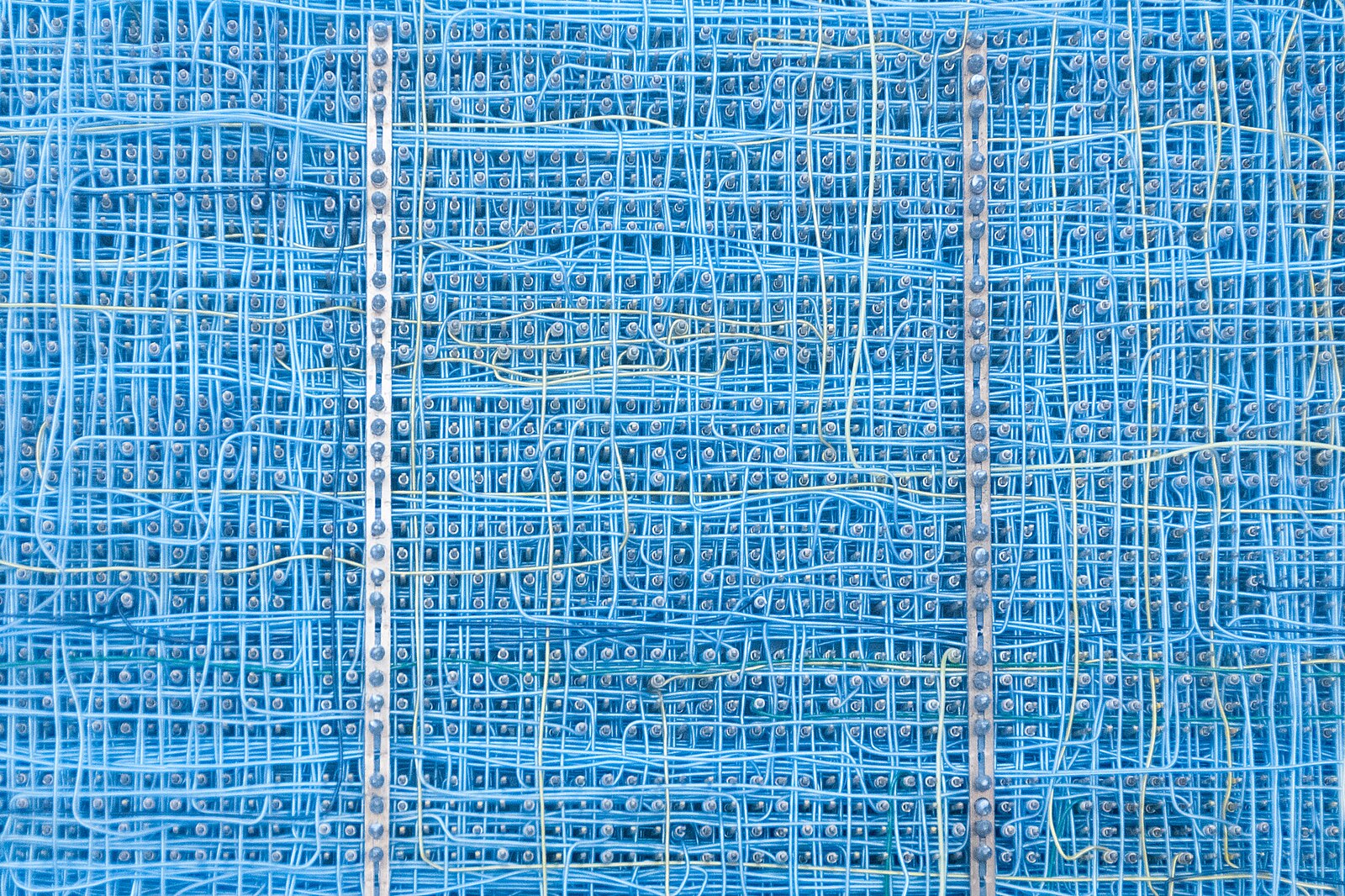Considérée d’un simple point de vue quantitatif, l’actualité éditoriale a pris une impressionnante dimension homérique. Le phénomène n’est pas spécialement européen ni même occidental. On aurait pu croire qu’il pourrait prendre la forme d’un rejet d’une culture occidentalo-centrée et donc coloniale, et l’on découvre dans les îles de la Caraïbe un usage anticolonial du personnage du vieil aède aveugle.
Issu d’un colloque universitaire, le livre dirigé par Claire Lechevalier et Brigitte Poitrenaud-Lamesi n’est pas une énième contribution savante à la « question homérique ». Même s’il s’ouvre sur un précieux entretien avec Pierre Judet de la Combe, récent auteur d’une passionnante traduction de l’Iliade, il s’inscrit plutôt dans le champ des études de littérature générale et comparée. L’intérêt d’un tel livre tient à la multiplicité des approches dont il rend compte. Cela va de la bande dessinée et du cinéma modernisant les figures des héros épiques jusqu’à des ouvrages de vulgarisation scolaire et à la rêverie de poètes caribéens reprenant à leur compte la figure d’Homère lui-même.
Qui s’intéresse à Homère peut encore le faire comme d’un magnifique champ de recherches dans lequel reste une abondance de pépites à trouver et à faire briller. On peut y consacrer beaucoup d’énergie sans forcément en faire l’objet d’une thèse universitaire. La démarche de Claire Lechevalier et ses collaborateurs est inverse : au lieu d’étudier ce que nous pouvons avoir à dire d’Homère, regarder ce qu’Homère fait dire à un certain nombre de nos contemporains dans les divers médias. Non pas chercher à apprendre ou à comprendre quelque chose d’Homère, mais envisager ce que l’insistance sur la référence homérique peut nous aider à comprendre de nous-mêmes.
Toute une part de la littérature occidentale est issue d’une réflexion sur Homère. Ce peut être aussi direct que chez Joyce. Ou bien de façon indirecte et néanmoins reconnaissable, comme dans la lignée Énéide–Divine Comédie-Comédie humaine. Ou encore, plus vaguement, sur le mode d’une métaphore de ce que l’on cherche à formuler. Hegel voyait ainsi dans sa Phénoménologie de l’esprit une « odyssée de la conscience ». Le lecteur peut à chaque fois se demander ce qui reste d’Homère dans tel usage qui en est fait. Celui de Virgile est très clair mais avec Dante ce n’est déjà plus qu’un moment somme toute assez bref de l’Odyssée : la conversation avec les morts. Même l’Ulysse de Joyce s’éloigne beaucoup de l’Odyssée puisqu’il n’en retient que les quatre chants qui importaient à Victor Bérard, ceux où le héros raconte aux Phéaciens ses voyages extraordinaires (pour reprendre le titre générique des romans de Jules Verne).
On peut aller plus loin et dire avec Luciano De Crescenzo, auteur de vulgarisations pour adolescents, que l’Odyssée est « le point de départ de tous les feuilletons télévisés, la matrice de tous les romans d’aventures, le prototype de toutes les séries ». Ulysse est à chaque fois un vero fico (« un type super »). Il y aurait lieu de s’offusquer de la démagogie du propos s’il n’était un exact résumé de l’attitude générale qui a conduit à l’inflation éditoriale (lato sensu) censée faire connaître à notre belle jeunesse les noms de quelques-uns des héros mythiques.
Les références contemporaines à Homère peuvent être assez lointaines ou partielles. C’était déjà le cas avec Dante. La présence du vieil aède a souvent eu quelque chose de fantomatique, à la ressemblance peut-être de sa vie personnelle. Une des caractéristiques de son œuvre est l’existence de diverses portes qui auraient pu être ouvertes par sa postérité et l’ont été parfois – ou pas. On peut ainsi imaginer une rencontre entre le fils de Circé (que l’on fait donc procréer pour l’occasion) et celui de Pénélope. Lors de la visite aux morts du chant XI, Tirésias raconte à Ulysse ce que nous allons lire dans la suite de l’Odyssée puis (121-137) ce qui se passera ensuite et qui n’a pas été écrit : sa fin heureuse après une longue marche, une rame sur l’épaule, vers des contrées qui n’ont jamais vu la mer et où l’on ne connaît pas le sel, jusqu’au jour où quelqu’un l’interrogera sur l’usage de cette étrange pelle à grains. À la fin de l’épopée (XXIII, 267-284), Ulysse raconte cette prophétie à son épouse retrouvée. Ces quelques vers pourraient constituer l’amorce d’une nouvelle épopée. Il n’est donc pas surprenant que les poèmes homériques aient pu susciter des œuvres littéraires procédant par excroissance d’un thème relativement mineur dans l’épopée. Ainsi du Télémaque de Fénelon.

Un des étonnements que provoque ce Besoin d’Homère tient à la prise de conscience de l’énorme quantité d’ouvrages récents inspirés de près ou de loin par l’Iliade ou l’Odyssée. Cet étonnement s’affaiblit quand on pense au considérable poids éditorial des ouvrages scolaires ou parascolaires. Dès lors qu’il faut que les collégiens (mis désormais dans la quasi-impossibilité d’étudier le grec) aient entendu parler d’Ulysse, de Polyphème, d’Achille, on fait proliférer les ouvrages « pour enfants » et les versions édulcorées de « l’épopée du retour » ou de celle « de la guerre ». Les deux tiers de l’Odyssée passent à la trappe et les vulgarisateurs massacrent le reste. Ulysse est comparé aux divers Superman des comics. Ce faisant, ils obéissent aux injonctions ministérielles de faire moralisateur et bête. L’important ne doit pas être l’Iliade ou l’Odyssée mais des histoires de héros dont il faut se demander s’ils sont vraiment héroïques, quelques noms propres dont on doit savoir un ou deux traits, ceux qui peuvent être partagés avec tous ceux des héros actuels. Ce qu’il est convenu d’appeler des mythes
Trois chapitres de ce Besoin d’Homère étudient de près ces ouvrages, leurs caractéristiques communes, les instructions officielles qui les valorisent. Leurs auteurs parviennent à garder la tête froide mais ne peuvent masquer ce que la situation en la matière a d’affligeant. Leur objectivité universitaire renforce le sentiment d’épouvante devant un tel amoncellement de bêtise, puisque les collégiens n’aspirent qu’à cela et sont évidemment incapables de lire un livre dans lequel les enfants grecs apprenaient à lire.
Du côté de la littérature italienne, la démarche est un peu différente. Au lieu de s’adresser exclusivement à des adolescents puérilisés, des auteurs célèbres comme Luigi Malerba s’efforcent de formuler les jugements moraux que nous pouvons porter désormais sur le comportement de ces brutes en qui la tradition s’est efforcée de présenter en héros.
Affligeante aussi, quoique d’une autre manière, est la conception que les Américains se font des études antiques, telle que la perçoit (et la déplore) l’écrivain et universitaire Daniel Mendelsohn. Les cours doivent prendre la forme de conversations à bâtons rompus dans lesquelles on échange sur l’impression que laisse tel personnage épique dont on ne se donne pas la peine de préciser ce qui lui advient dans l’épopée et qui est certes moins intéressant que sa posture de genre. Bien entendu, tout cela est fondé sur les traductions de quelques brefs passages qui posent des problèmes actuels sur lesquels on pourra discuter, passages qu’aucun étudiant n’est censé lire en grec, cette langue si peu moderne. Face à cela, la nostalgie européiste de Daniel Mendelsohn a quelque chose de rassérénant.
Tandis que, dans les pays fiers de leur héritage culturel venu de l’Antiquité, l’Homère scolarisé est réduit à quelques scènes et personnages transformés en stéréotypes, la démarche est tout autre, et enthousiasmante, chez des poètes caribéens comme le Prix Nobel Derek Walcott. Plutôt que de ressasser la caricature de quelques personnages, ces poètes s’intéressent à la figure d’Homère, à sa position fondatrice.
On pourrait évidemment se demander pourquoi ces auteurs se sont intéressés à des classiques gréco-latins plutôt qu’à des traditions amérindiennes, africaines ou asiatiques. Ce ne peut être seulement parce que le calypso est une danse à deux temps de la Jamaïque et des Antilles. C’est aussi que cette figure du canon occidental est un poète à propos de qui se pose la question de l’origine de la littérature avec l’oralité. Il intéresse dans la Caraïbe parce qu’est en cause son auctorialité plus qu’à cause des histoires qu’il raconte à propos de tel ou tel héros épique. Il est l’étranger par excellence, dans la mer des Caraïbes comme il put l’être en Méditerranée. On peut même le présenter en train de chanter. Sa voix mise en scène devient alors comparable à celle de Shéhérazade.
On peut n’être pas convaincu par cette vision de l’aède à qui est déniée la qualité d’auteur, même si elle est actuellement dominante dans les milieux universitaires. Il faut néanmoins lui reconnaître une puissance herméneutique et la démarche de Derek Walcott est en elle-même très séduisante. Quant à ce livre qui voit un « besoin d’Homère » dans l’actuelle inflation éditoriale, il montre en acte que l’usage de la focale homérique peut être un bon outil pour y voir plus clair dans notre temps.