Signe des temps, de la fin de la période estivale ? Cette nouvelle livraison a une saveur politique. On s’y interroge sur l’écologisme, le séga à Maurice, la politique chinoise en Afrique, en même temps qu’on lit des textes de Mo Yan ou Osamu Dazai.
Dominique Meens écrit d’une île, probablement Oléron. Il va à l’écriture comme on va à la pêche à pied – titre de son livre –, quand l’océan se retire. Il arpente ainsi, au fil des phrases et des jours, des rivages où il ramasse, en fouillant et creusant sous les mots, des fragments de pensée, des sensations, des échos de la nature où les oiseaux et leur chant tiennent une place incontournable. Ceux-ci viennent d’ailleurs régulièrement rythmer le livre par de larges séquences « plumes et poils » où l’auteur excelle dans la description sur le vif à tel moment de l’heure et de la saison. Les matériaux qu’il collecte, dans sa propre sensibilité, celle des autres et dans la vie, avec ses déchets, il les rassemble sur la page en une sorte de mosaïque ou plutôt en un labyrinthe, car il y a chez cet auteur un désir d’égarement, de mise en déroute de la logique banale pour des chemins de traverse : se perdre pour mieux se trouver.
L’écrivain s’abandonne volontiers à la digression, pouvant soudain interrompre sa phrase en plein milieu pour repartir, en échappée, sur autre chose. Son livre est constitué de réflexions – sur de nombreux sujets : la société, la psychanalyse, la philosophie, le langage –, de poèmes, de descriptions, de citations, de notes de lectures, de promenades qui s’imbriquent les uns dans les autres, avec des incursions en Hongrie et sa langue. Du « voir-dit » de Guillaume de Machaut, Meens reprend à son compte le « voir » dans le sens d’un « voir vivre, agrippé au faux vrai ». Ce « faux vrai », qui n’est pas sans rappeler, avec des nuances, le « mentir vrai » d’Aragon et qui s’autorise « le soutien du rêve, soit donc de la métaphore, de la métonymie, de toutes les échappées que permettent les phrases », est aussi un « savoir-vivre ». Il s’oppose aux postures et impostures du « vrai faux » dont notre époque est si friande, en littérature comme ailleurs. Alain Roussel
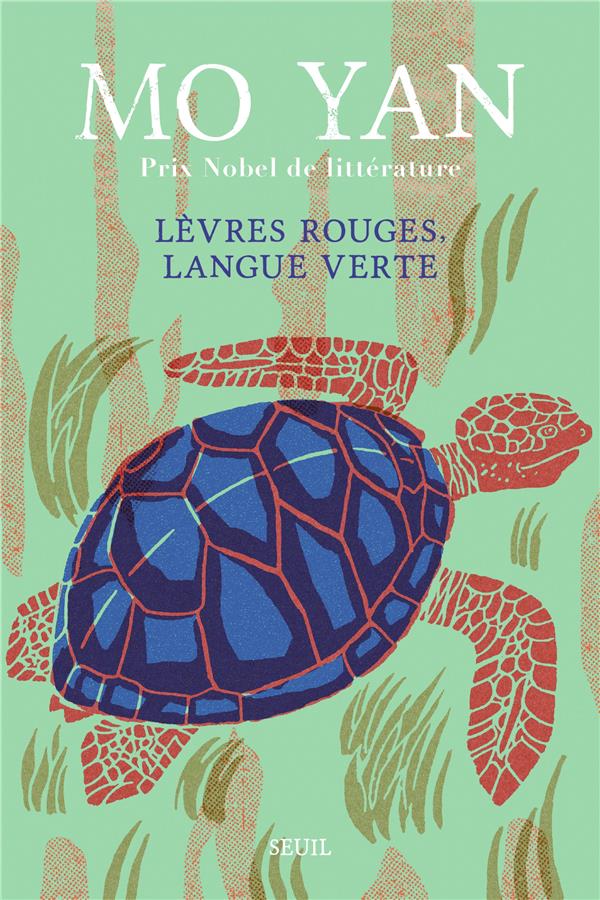
Cela fait longtemps que j’ai envie de dire tout le mal que l’on peut penser des livres du Prix Nobel chinois, prix qui apparaît de plus en plus comme une récompense purement diplomatique du jury suédois, non à un écrivain majeur, mais à la Chine toute-puissante.
Cette série de onze nouvelles parues entre 2011 (la huitième) et 2020 (les trois plus longues, dont celle qui donne son titre au recueil) me donne l’occasion attendue. Dans cet ensemble disparate, un seul texte, « Grande paix sous le ciel », qui date de 2017 sans que soit mentionné, par exception, son lieu de publication, et a été traduit par Chantal Chen-Andro, présente un intérêt littéraire. C’est une sorte de fabliau paysan qui raconte sur le mode plaisant la mésaventure d’un gosse de village qui se fait mordre par une grosse tortue lors d’une partie de pêche plutôt illicite. Tandis qu’on tente de libérer le doigt du petit que l’animal a englouti et ne veut pas lâcher, une altercation se déroule entre voisins alarmés ou goguenards et autorités (des gendarmes balourds), dans une atmosphère vaudevillesque qui rappelle les plus faciles des contes de Maupassant.
Le reste se partage entre d’insupportables exercices d’autocélébration (comment le célèbre Mo Yan, gloire nationale, a été reçu ici ou là par des notables obséquieux, festoyé, encensé malgré son extrême modestie, toujours soulignée avec de gros sabots) et d’interminables récits nourris de ragots sur telle ou telle personnalité locale, souvent à la limite de la vieille haine recuite et de la délation, spécialité chinoise.
Le seul mérite de ces textes venimeux, c’est de rappeler par des exemples concrets que les horreurs du maoïsme ne se limitèrent pas aux hautes sphères mais que la méchanceté, la violence, la corruption, l’abus de pouvoir, à l’époque notamment des Gardes rouges, sévissaient du haut en bas de l’empire. Aucune révélation là-dedans, et une prudence remarquable concernant les orientations politiques de la Chine actuelle. Pour vivre heureux, affirmons que l’heure des exactions, sous le nouveau Mao, est révolue. Maurice Mourier
Artiste et anthropologue, Caroline Déodat entend extirper le séga mauricien de « l’éternel présent de la tradition » où l’ont enfermé les mises en scène produites par la « trame coloniale » et esclavagiste, « une certaine ethnologie » puis la production patrimoniale qui s’est imposée avec la construction nationale mauricienne. Qu’est-ce que le séga ? demandera-t-on peut-être. Ensemble de chants et danses initialement pratiqué par les personnes réduites en esclavage à Maurice, il tirerait son nom du portugais « chéga », signifiant « Viens ! » (« Arrive ! ») ou « Ça suffit ! ». Le premier volet de l’étude retrace, de 1715 à 1964, le façonnement de cet objet fantasmagorique à l’usage du plaisir des Blancs : élaboration d’un savoir racial sur la « danse des Noirs » excluant ses pratiquants de l’humanité, puis re-création comme un « folklore créole » hors histoire et hors société, enfin mise en scène touristique du « séga typique » servant des objectifs nationaux. La mise en visibilité du séga coïncide alors avec la mise sous silence de ses acteurs.
Le second volet répond à cette problématique en s’appuyant sur l’observation et sur des archives sonores pour aborder les poétiques de trois ségatiers et ségatière, Ti Frer, Fanfan et Josiane Cassambo, nés respectivement en 1900, 1930 et 1945. La recherche se met à l’écoute du contexte comme « assemblage » cacophonique fait de subjectivités en performance festive et de leur couverture par des représentations altérisantes. Malgré ces dernières, en leur « foisonnement énonciatif » et leur résistance au dicible, ces « mascarades polyphoniques » parviennent à déjouer, ne fût-ce qu’un temps, l’œil du pouvoir. Catherine Mazauric

La présence chinoise en Afrique est l’un des grands bouleversements géopolitiques du monde contemporain. Elle est observée de près, notamment par les Français, qui comparent parfois cette « Chinafrique » à l’ancienne « Françafrique ». Le géographe Xavier Aurégan, qui réfute d’ailleurs ce terme au nom de la diversité des acteurs chinois et africains, propose un nouveau décryptage de ce sujet tellement protéiforme qu’il tend à résister à l’analyse.
Comment en effet synthétiser les relations de la Chine avec les 54 pays qui composent l’Afrique ? « Plus l’échelle est grande, plus les relations Chine-Afrique se complexifient et plus l’on perd de vue les potentielles stratégies globales des autorités africaines comme chinoises. Moins l’échelle est grande, moins les détails, les enjeux locaux et les pratiques africaines sont perceptibles », constate l’auteur. De fait, son texte n’évite pas complètement l’écueil et alterne des passages très (trop ?) généralistes et des focus sur des cas très (trop ?) détaillés.
On retiendra néanmoins une perspective historique intéressante, depuis les liens idéologiques du Parti communiste chinois avec les mouvements de libération africains dans les années 1960 jusqu’à la quête de matières premières, de nouveaux marchés et de soutiens diplomatiques qui caractérise la stratégie chinoise à partir des années 1990. Une stratégie dans laquelle le « retour de l’idéologie » se fait nettement sentir depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping. On retiendra également le recensement détaillé des différents acteurs chinois et des liens économiques multiformes qu’ils tissent avec le continent africain : une décomposition des relations qui rend bien compte de toute leur complexité. On retiendra enfin la conclusion de l’auteur qui voit dans l’Afrique un laboratoire des nouvelles ambitions internationales de la Chine, un terrain d’expérimentation qui permet à Pékin d’extra-territorialiser sa croissance, d’exporter son modèle de gouvernance et d’influencer les normes internationales. Si la théorie d’une relation « gagnant-gagnant », promue par Pékin, est aisément réfutée pour les pays africains à quelques rares exceptions près, la politique africaine de la Chine pourrait néanmoins avoir conféré « au continent africain le poids qui lui revient légitimement au sein des relations internationales ». Séverine Bardon
Dazaï Osamu, écrivain adulé par la jeunesse nippone d’après-guerre pour sa révolte suicidaire contre une société traditionnelle dont la faillite de 1945 vient de mettre au jour les tares, était comme une figure littéraire quasi sacrée pour la jeunesse cultivée, particulièrement les anciens étudiants de l’université de Tôkyô spécialisés en littérature française et fascinés par les « décadents » de la fin de notre XIXe siècle, près de vingt ans après sa mort en 1948.
Le paradoxe, pour le résident français que j’étais vers 1960, c’est que les pratiques sans concession d’une forme d’hyper décadence non point jouée mais vécue par Dazaï et par ses disciples, dont Mishima, se conformait pourtant à la forme la plus traditionnellement japonaise du « double suicide », que l’auteur pratiqua deux fois. La première dès les années 1930, autour de ses vingt ans, en compagnie d’une jeune amante qui, elle, ne survécut pas à l’aventure commune, faisant du garçon, à nos yeux d’Occidentaux – mais pas dans la mentalité japonaise –, une sorte de meurtrier par accident. La seconde en 1948 précisément, « réussie » cette fois-ci puisqu’elle les tua tous les deux, sa nouvelle partenaire, beaucoup plus jeune, et lui, à trente-neuf ans.
Dazaï aussi est un « francisant », il a commencé de brillantes études de littérature française à l’Université Impériale après avoir rompu avec sa riche famille du nord, mais très vite la drogue, l’alcool, l’engagement politique dans le parti communiste clandestin, font de lui un « raté » revendiqué, et ses écrits autobiographiques, tout en défiant la censure, ne sont qu’une sorte de journal de bord de son autodestruction programmée.
L’intérêt de la présente édition des deux derniers livres de Dazaï, dont le second est inachevé, et qui datent l’un et l’autre de l’année ultime, 1948, réside à mon avis plus dans l’extrême lucidité de l’écrivain sur lui-même, dans le maniement de l’autodérision en particulier, que dans leur qualité proprement littéraire. Déchéance d’un homme est une analyse factuelle et glaçante, très classique de forme, des étapes d’un effondrement dont le récit sincère et poignant ne saurait susciter que l’effroi. Quant à Goodbye, c’est une pochade sinistre qu’on peut trouver, au choix, tragicomique ou indigente. Documents sociologiques essentiels que ces deux textes, sur un certain nihilisme japonais engendré par la défaite mais aussi bien lié à une sensibilité locale, bien attestée par ailleurs, pour le pessimisme radical et « la mort volontaire » à laquelle notre ami Maurice Pinguet a naguère consacré un ouvrage magistral (La mort volontaire au Japon, Gallimard, 1984). Maurice Mourier
L’écologisme n’est pas l’écologie. C’est une approche théorique, morale et politique des rapports entre les humains et leur environnement. Pour restituer la grande diversité de ce courant, le politiste Jean Jacob a choisi de présenter une collection de portraits très didactique qui débute avec Henry-David Thoreau et Gandhi pour se terminer par le pape François et Edward Goldsmith, le fondateur de la célèbre revue britannique The Ecologist, en ménageant une bonne place aux penseurs et militants français.
On y croise des penseurs empreints de christianisme, comme Ivan Illich et Bruno Latour, des figures de l’écoféminisme, comme Vandana Shiva et Françoise d’Eaubonne, ainsi que de nombreux militants politiques, comme Murray Bookchin et René Dumont. Chaque portrait campe l’auteur dans les débats de son époque, retrace son parcours et présente à grands traits sa pensée, non sans pointer à l’occasion les lacunes, les angles-morts et les incohérences – et l’écologisme ne manque pas d’incohérences, entre scientisme et mysticisme, entre les appels à la démocratie horizontale et à la régulation centralisée, entre les descriptions détaillées de la complexité du vivant et les projets de refonte générale de la société, ou encore entre l’éloge de la sensibilité féminine et l’exigence d’une stricte égalité des genres. Le propos est vif et informé. On peut simplement regretter que l’introduction et la conclusion ne proposent pas de réflexion d’ensemble. Thibault Le Texier













Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.