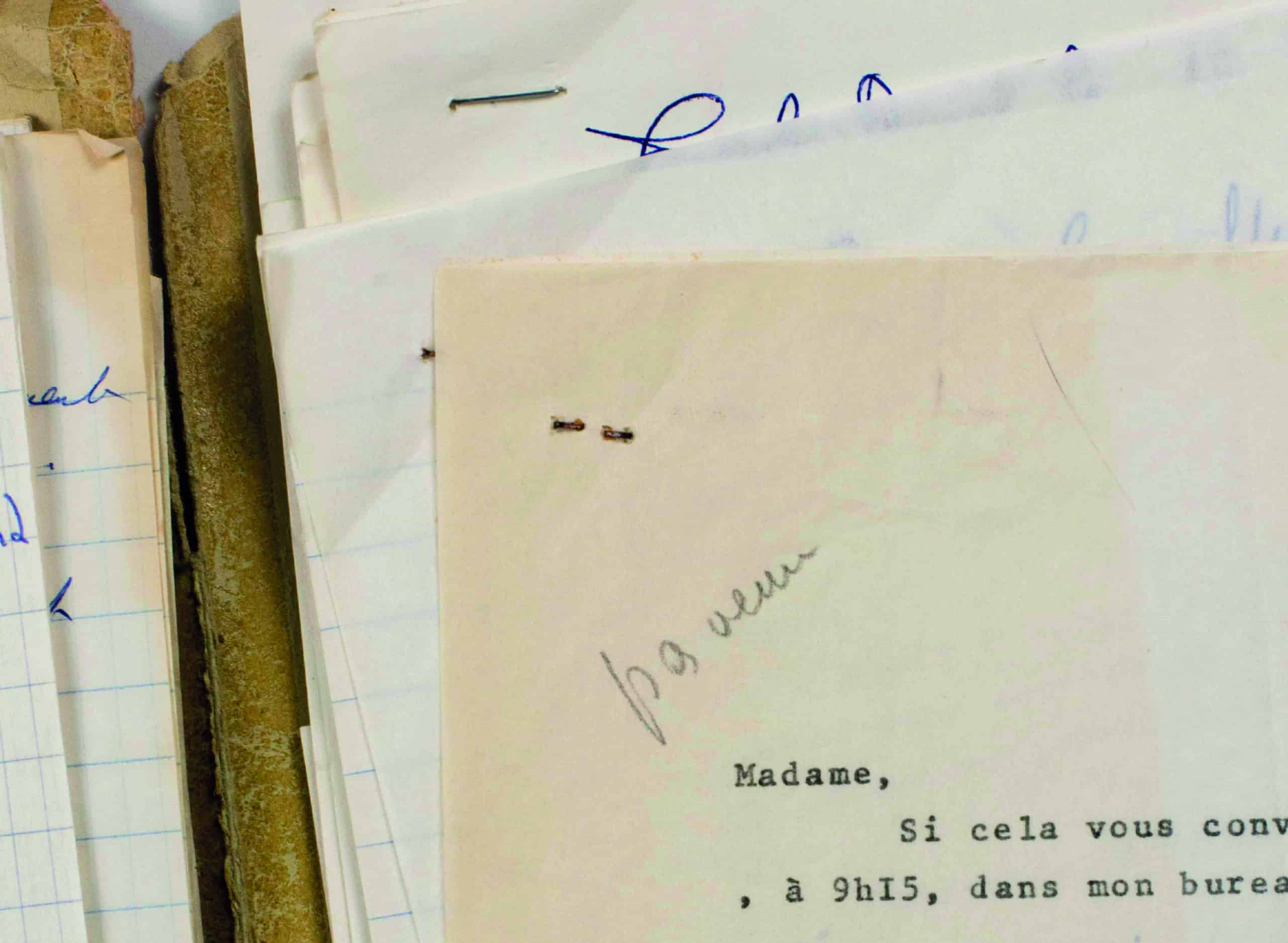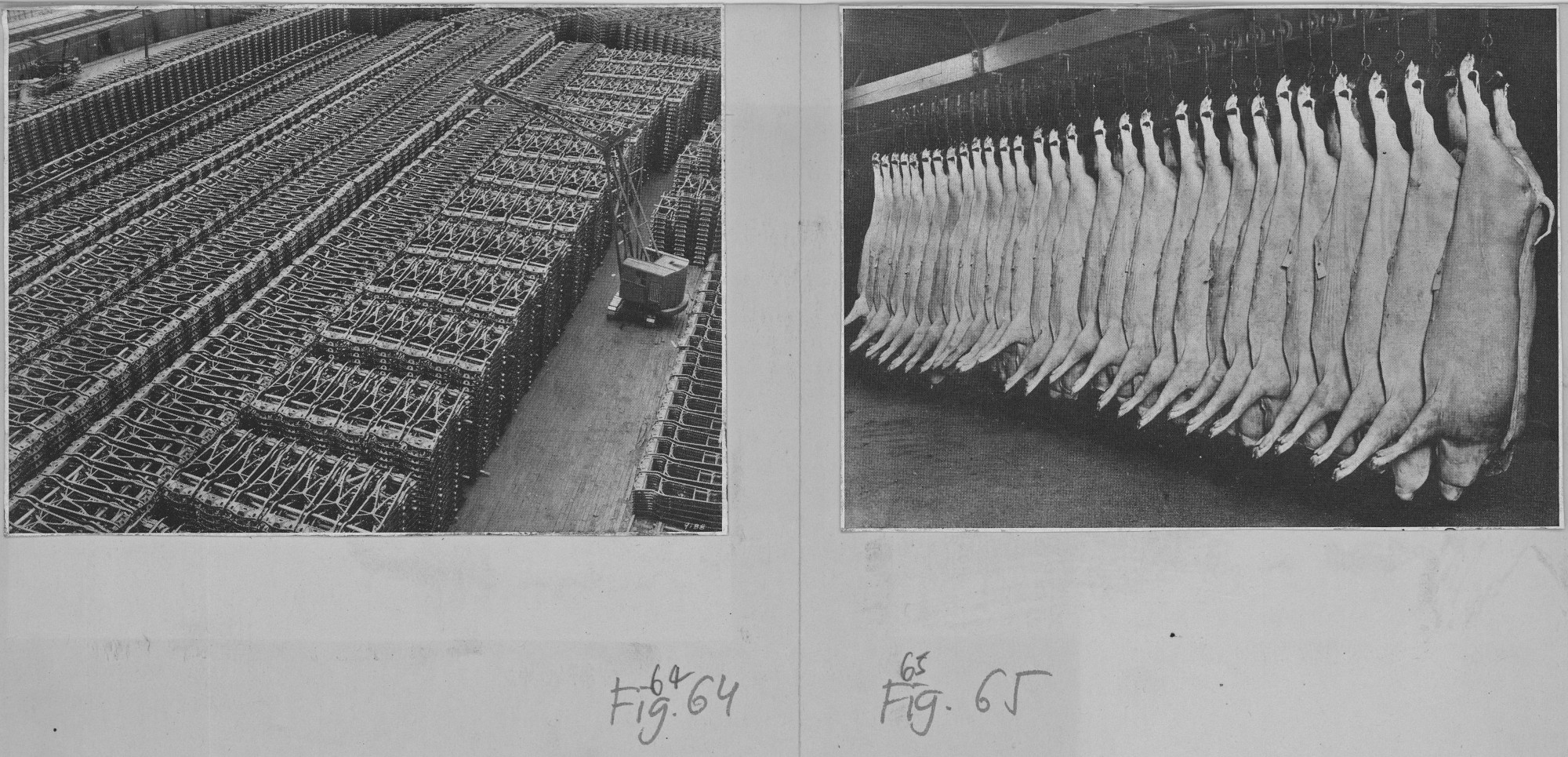Islam et capitalisme de Maxime Rodinson (1915-2004) est sans doute l’œuvre majeure de cet historien, qui fut également linguiste et sociologue. En dépit de sa très grande connaissance des textes de l’islam et de l’histoire des sociétés musulmanes, il ne saurait être qualifié d’islamologue à la manière de ceux qui, aujourd’hui, font d’un islam essentialisé la matrice explicative des comportements individuels ou collectifs.
Avec autant d’érudition que de précision, Maxime Rodinson nuance, contextualise, n’hésite pas à souligner les ambiguïtés et les contradictions. C’est ce qui fait tout l’intérêt d’un livre paru pour la première fois en 1966, en pleine période de décolonisation, et qui pourrait donc sembler aujourd’hui inactuel. Les révolutions arabes de 2010-2011 ont confirmé au contraire, écrit Alain Gresh dans la préface à cette réédition, que la culture islamique pouvait nourrir quantité de projets politiques et économiques.
La question sur laquelle réfléchit Rodinson est double. Pourquoi, se demande-t-il, le capitalisme a-t-il « triomphé à l’époque moderne en Europe et pas (entre autres) dans les pays musulmans ? » Et pourquoi « le capitalisme européen a-t-il envahi si facilement le monde musulman ? ». L’islam, se demande-t-il également, pourrait-il devenir « le drapeau de la construction économique socialiste dans les pays musulmans ? ». Exclu du Parti communiste français en 1958, Rodinson n’en continuait pas moins de s’affirmer marxiste. Les sociétés, selon lui, ne se bâtissent pas autour de significations, comme le soutenaient les structuralistes, mais autour de tâches essentielles qui permettent la survie et la perpétuation de l’existence. Elles ne sont pas non plus le produit d’idées ni de dogmes ou de croyances, même si « toute activité humaine passe par l’esprit humain ».
Le « sociologue islamisant » entend combattre ici la thèse développée par Max Weber dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, qui, selon une lecture vulgarisée, fait du protestantisme le facteur explicatif de la naissance et du développement du capitalisme moderne en Europe mais aussi aux États-Unis. En fait – mais Rodinson n’en tient pas compte –, Max Weber affirmait dans ses textes épistémologiques que sa thèse n’en excluait pas d’autres, y compris celles de Marx, qui pouvaient être invoquées de façon simultanée ou alternative pour expliquer le capitalisme. Plus généralement, Rodinson entend montrer la fausseté du présupposé selon lequel les hommes ou les sociétés d’une époque ou d’une région obéiraient strictement à « une doctrine préalable, constituée en dehors d’eux ».
Rodinson commence par examiner différentes prescriptions codifiées dans le Coran, que l’historien lit comme un texte écrit en son temps, et dans la Sunna, c’est-à-dire dans les traditions qui rapportent ce que le Prophète « est censé avoir dit ou fait ». On cite souvent la condamnation, dans plusieurs passages du Coran, d’une pratique appelée ribâ, mot qui signifie accroissement, mais dont on ne sait pas exactement à quoi il renvoie. Certains y ont vu l’interdiction, au-delà du prêt à intérêt, de la recherche du profit et du capitalisme alors que ni le Coran ni la Sunna ne se sont prononcés sur le capitalisme, totalement étranger à l’époque où ces textes ont été écrits.

Quant à l’idéal de justice prêché par le Coran, mais également par d’autres doctrines religieuses, ce n’est pas celui de la pensée socialiste moderne. Le Coran, écrit Rodinson à qui l’on doit un Mahomet qui a fait date (Seuil, 1968), est « l’œuvre d’un homme inspiré par certains idéaux propres à son époque ». Les prescriptions coraniques n’ont pas fait obstacle au développement du capital commercial et du capital financier dans le monde musulman médiéval. La société mecquoise où est né l’islam était déjà un foyer de commerce capitalistique. Plus tard, il s’est toujours trouvé des docteurs de la loi pour en proposer des lectures compatibles avec la recherche du profit. Ainsi, par exemple, de la supposée condamnation, toute théorique, de la bid’a ou « innovation » par rapport aux pratiques n’existant pas à l’époque du Prophète. Même dans l’Arabie saoudite où le wahabisme, interprétation particulièrement rigoriste de l’islam devenue idéologie officielle, condamnait les bid’a, les dirigeants politiques n’avaient rien trouvé à redire contre l’introduction du téléphone et de la radiodiffusion ni même contre la présence sur leur sol des installations les plus modernes liées à l’industrie pétrolière qui procure la plus grande partie de ses recettes au budget du pays.
Au-delà de la référence aux textes doctrinaires, ce que Maxime Rodinson nomme l’ « opinion vulgaire » a souvent mis en cause la nonchalance des musulmans, leur fatalisme et leur absence de rationalité qui feraient obstacle à l’esprit d’initiative et à l’élaboration des institutions nécessaires au développement du capitalisme. Dans un ouvrage ultérieur, La fascination de l’islam (Maspero, 1980, repris en poche à La Découverte, 2003), Rodinson montrera que cette vision de l’homo islamicus alterne, selon les circonstances et les images que les Occidentaux vont chercher en Orient, avec la représentation d’un Oriental barbare et ennemi farouche. Les stéréotypes ne reculent pas devant les contradictions.
La rationalité, prétend-on, est propre à la « mentalité collective européenne ». « Le Coran, soutient au contraire Rodinson, est un livre sacré où la rationalité tient une très grande place. Allah ne cesse d’y argumenter, d’y raisonner ». Le verbe ‘aqala, qui signifie « lier des idées ensembles, raisonner, comprendre un raisonnement intellectuel », revient environ cinquante fois dans le Coran. Quant à la doctrine de la prédestination, elle a toujours été tempérée voire contredite par d’autres sentences incitant à l’action. En outre, on trouve des textes insistant sur la prédestination dans le judaïsme comme dans le christianisme. Le Prophète lui-même a mené une vie extrêmement active de chef politique et de chef de guerre. Le fatalisme nonchalant attribué à l’Orient musulman, le fatum mahumetanum (écrivait Leibniz) de fidèles avant tout soumis à Dieu, ne rend nullement compte de l’islam historique, lequel, dans la ligne de son fondateur, a toujours exhorté à l’action dans le monde. « Le devoir des chefs de la communauté était de conquérir, de défendre, d’administrer, aidés par les membres de cette même communauté. Tout cela était action, action rationnelle, calcul et prévision, ordonnance des moyens en vue d’une fin terrestre, quoique satisfaisant la Volonté divine. »
S’il est vrai que le dynamisme des entrepreneurs musulmans a longtemps été faible, cela est dû, comme au Japon et en Chine, aux résistances devant l’introduction brutale par l’étranger de comportements économiques, de modes de relations sociales et d’attitudes radicalement nouveaux, mais aussi et surtout à la colonisation. Il ne faut pas oublier les « entraves placées sur l’entreprise indigène », comme lors des accords commerciaux imposés par l’Europe à l’Empire ottoman et à l’Iran : les taxes à l’importation y étaient réduites à presque rien alors que les exportations étaient lourdement taxées. Quelques années plus tard, à la suite de l’économiste franco-égyptien Samir Amin, on parlera à ce propos d’échange inégal.
Le monde musulman a ses spécificités, mais il ne saurait échapper, conclut Maxime Rodinson, aux lois générales de l’histoire humaine. Son avenir est un avenir de luttes, qu’on pourra tenter d’apaiser, mais jamais supprimer. Dans ce contexte, rien n’assure que la force mobilisatrice de l’islam, facteur d’identité nationaliste, joue nécessairement en faveur de la « construction socialiste », bien au contraire. Cependant, avec ou sans islam, « il vaut la peine de lutter pour une humanité sans exploitation et sans oppression ». Le message profondément humaniste d’un Rodinson laïque, curieux et respectueux des croyances humaines, vaut d’être entendu.