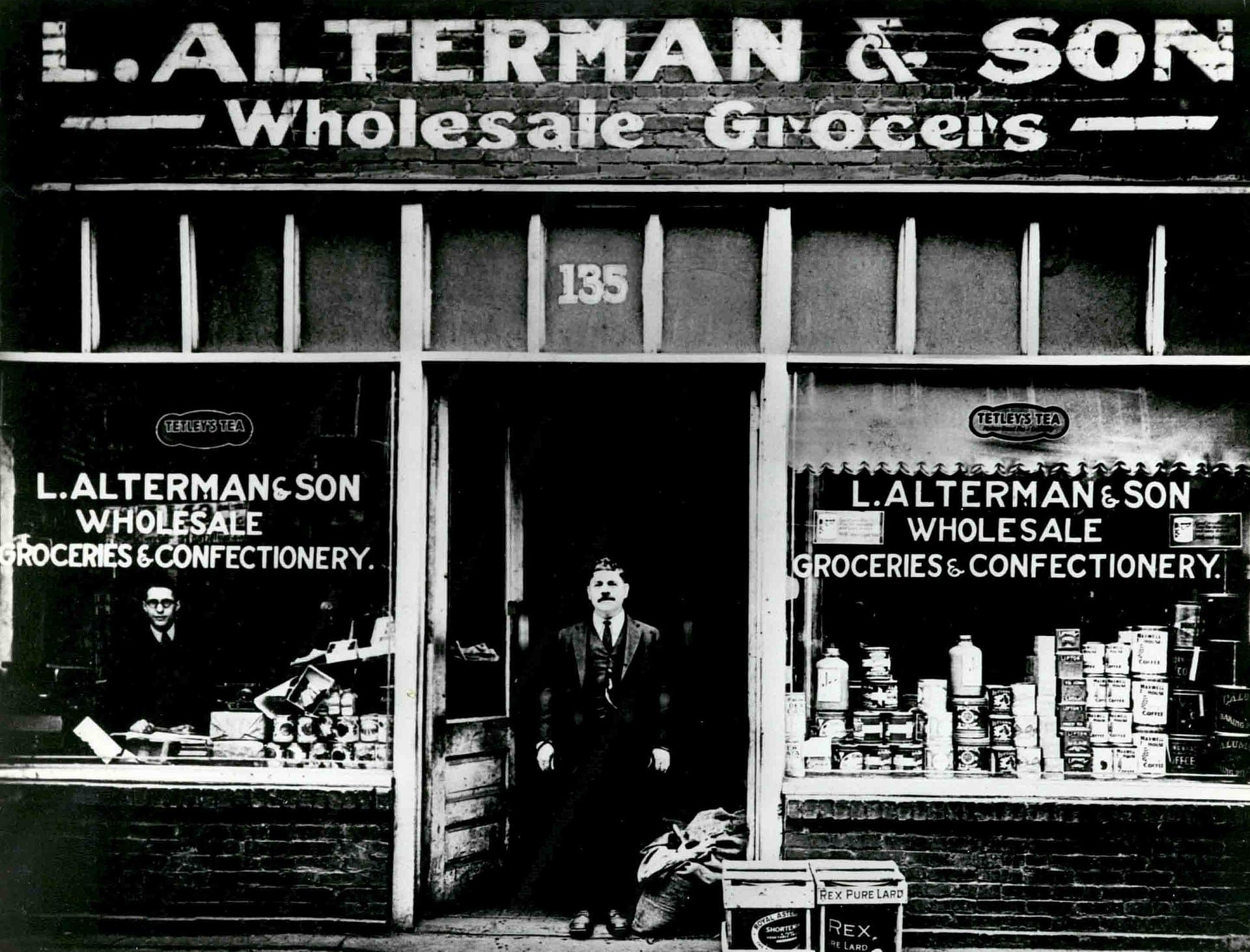De nombreux livres paraissent sur la mer, et ils ont beaucoup à nous apprendre tant les récentes avancées de l’archéologie, de l’ethnographie et de l’histoire, en particulier sur le versant économique et commercial des eaux, sont indéniables. Les croiser permet de renouveler les approches et autorise de vastes synthèses. Même la philosophie emprunte son inspiration à l’immensité liquide. Trois livres, de David Abulafia, d’Alessandro Vanoli et de Corine Pelluchon, attestent de cette richesse d’analyse et changent notre regard sur la mer.
David Abulafia, historien anglais qui avait déjà publié le superbe ouvrage La Grande Mer. Une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens, complète le tableau en fournissant une remarquable évocation des océans dont il étudie le développement historique et humain. Son approche s’éloigne de l’histoire militaire pour examiner de près les échanges commerciaux et culturels, comme le faisait Fernand Braudel. Il n’adhère pas non plus au déterminisme géographique, en retraçant l’aventure maritime que des navigateurs courageux, pour ne pas dire téméraires, ont entreprise à toutes les époques. Cet ouvrage est une synthèse impressionnante. Abulafia nous invite à une circumnavigation du globe en son entier, avec des explications claires, nourries d’anecdotes et d’observations pertinentes.
L’immense océan Pacifique qui couvre un tiers de la planète a vu s’épanouir une « extraordinaire culture maritime échelonnée sur plusieurs millénaires ». Dénués de bandes côtières, de grands ports, de longs fleuves, les peuples navigateurs étaient comme « les Berbères Touaregs avec le désert ou les Incas avec la montagne ». Les obstacles ne pouvaient être surmontés qu’« à force de connaissances, de détermination et de confiance ». L’auteur reconstitue le formidable périple de ces populations, en particulier des Lapitas qui apparaissent au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Plus près de nous, avec des connaissances maritimes étonnantes, les Polynésiens atteignirent les limites de leur expansion au XIVe siècle après J.- C. Leur installation prit trois mille ans et couvrit une distance de 5000 kilomètres.
L’océan Indien est évidemment tout différent car ses rives « connectées » en ont fait un réseau commercial. En cela, il se rapproche davantage de la Méditerranée, à ceci près que le cycle de la mousson obligeait à des navigations saisonnières. David Abulafia ne néglige pas la mer Rouge ni le golfe Persique et leur histoire antique. Madagascar est un cas à part car, longtemps inhabitée, sa faune se développa un peu comme en Australie, « indépendamment de celle de la planète ». Le fameux « oiseau Rokh » de Sinbad pourrait bien être le souvenir d’un « oiseau-éléphant ». L’historien évoque aussi le grand royaume de Shrivijaya sur l’île de Sumatra dont le souverain ne se baignait que dans de l’eau de rose.
À propos de l’Atlantique, Abulafia s’interroge tout d’abord sur une possible « lingua franca atlantique protoceltique » au cours du Ier millénaire, puis aborde la navigation grecque avec le courageux Pythéas qui « découvrit » les Îles Britanniques au IVe siècle avant J.-C. en partant de Marseille. Peut-être a-t-il même pénétré en mer du Nord, soupçonné qu’il est d’avoir fait de l’espionnage commercial à propos de l’ambre… Suivent les pirates saxons, les Frisons, les Vikings et les moines irlandais comme saint Cormac qui dut faire demi-tour dans l’Atlantique à cause d’un banc de méduses rouges. Évidemment, les moines pouvaient difficilement faire souche sur les îlots qu’ils abordaient. Bjarni Herjolfson, un Islandais, n’a pas laissé son nom dans l’histoire. Et pourtant, il a sans doute aperçu le premier le nord du continent américain, vers 985, mais, le jugeant sans intérêt, il n’a pas débarqué !
L’histoire de la Ligue commerciale hanséatique fut l’objet d’interprétations différentes. Bismarck la valorisa pour compenser la prestigieuse épopée maritime anglaise, le IIIe Reich la considéra comme un modèle de pureté raciale et de volonté de conquête, la RDA insista sur le caractère « bourgeois » des villes qui s’opposaient aux princes locaux. Aujourd’hui, la Hanse est présentée comme « un modèle d’intégration régionale » quasi précurseur de l’Union européenne ! Cependant, au XVIe siècle arrivèrent de rudes concurrents : les Anglais et les Hollandais alors qu’au sud, dès le XVe siècle, le prince Henri le Navigateur allait ouvrir au Portugal les eaux de l’Atlantique.
Ainsi, les trois grands océans qui « font l’objet chacun d’histoires largement distinctes, du moins jusqu’à la fin du XVe siècle » occupent une large place. Toutefois, comme l’indique le titre de son livre, David Abulafia n’oublie pas les mers presque fermées, « sortes d’alter-Méditerranées », telles la mer de Chine méridionale, la mer des Caraïbes et la Baltique « dont l’histoire est liée de façon étroite à celle des océans, dans lesquels elles déversaient respectivement soie et épices, sucre, en échange d’esclave et grain, poisson ou ambre ».
La seconde partie s’intitule « Dialogues océaniques ». La connexion des océans s’achève dès le XVIe siècle. Évidemment, les navigateurs européens, qui pensaient atteindre l’Asie en traversant l’Atlantique, s’aperçoivent, quand ils rencontrent l’Amérique, qu’il existe d’autres océans et qu’il convient de trouver des passages. Les « découvreurs » ne trouvent pas un monde immobile. Abulafia explique que, dans le « Nouveau Monde », des îles comme les Caraïbes étaient colonisées depuis… le Ve millénaire ! « avec des vagues de peuplement arrivant périodiquement d’Amérique du Sud ». L’isolement des habitants n’est pas de mise : les Aborigènes canariens, les Tainos caribéens, les Tupinambas brésiliens se connaissaient. Et quelquefois « les découvreurs » se rencontrent. Ainsi, en 1498, les commerçants arabes qui naviguaient dans le sud-est de l’Afrique croisent la route de Vasco de Gama qui se frayait un chemin vers l’océan Indien. la découverte « n’était donc pas un phénomène purement européen ». Abulafia rend compte des flux incessants : Christophe Colomb est stupéfait de constater que des perles de verre et des pièces de monnaie échangées par ses hommes, le 13 octobre, soit le lendemain de son arrivée aux Bahamas, se retrouvèrent, deux jours plus tard, transportées en canoé sur l’île Fernandina au sud de l’archipel…

Si le nombre de marins est faible, la puissance de feu des canons des Européens, « armes de destruction massive », effraie. Les relations sont vite tendues entre Européens et natifs. La brutalité des « découvreurs » déconcerte à tel point que l’historien affirme que les Portugais faisaient preuve d’une « incapacité répétée à réfléchir avant d’agir ». Pour preuve, au début du XVIe siècle, alors que le sultan de Zanzibar ne s’est jamais opposé à eux, ils capturent trois vaisseaux et tuent son fils, tout en réclamant un tribut annuel d’or et de moutons ! Nonobstant, l’océan Indien doit être partagé car y naviguent jonques javanaises, boutres arabes et galères de combat ottomanes.
La soif de l’or et l’esclavagisme de cette « époque atroce » sont sans limite. Las Casas, le grand défenseur des Indiens, raconte la déception des esclavagistes arrivés aux Bahamas constatant que des raids antérieurs ont fait disparaitre la population. Quelquefois, le hasard joue son rôle : les Bermudes, qui n’avaient pas d’habitants indigènes, se peuplent en 1609 à la suite du naufrage d’un navire anglais pris dans un ouragan. Certains marins et passagers, séduits par l’île, préfèrent y rester plutôt que de gagner la Virginie.
Au terme du livre de David Abulafia, le lecteur ne peut manquer d’avoir une autre perception de notre planète qui est avant tout un immense océan, traversé de multiples routes maritimes qui ont fait l’histoire de notre Terre pas si terrienne. Alessandro Vanoli, historien et spécialiste de la Méditerranée, a une approche toute différente. Son Histoire de la mer est une encyclopédie maritime thématique, dont les chapitres recouvrent l’histoire du monde, composés de courts articles portant sur des domaines variés aussi bien naturels qu’historiques ou culturels. Le livre s’ouvre sur la géologie et la tectonique des plaques avec, dans les abysses fracturés, d’où jaillit une eau réchauffée par le magma, de petites crevettes et des moules sans bouche. Il se termine sur « la mer redécouverte » avec la musique, la peinture, le sport et… les migrants, puis « la mer menacée » avec la chaleur, la surpêche, la pollution. Entre-temps sont passés en revue, en fonction des époques, les grands ports : Pise, Gênes, Venise, Amsterdam ; les routes maritimes et les vents ; les animaux : morues, morses, anguilles ; les batailles, d’Actium à Lépante ; les grands navigateurs, y compris le fameux Chinois Zheng He. Les légendes ne sont pas omises avec les sirènes, les dieux de la mer, le terrible Kraken et le mystérieux Hollandais volant. Quelques faits pittoresques sont mentionnés. En 1992, un navire, l’Ever Laurel, perdit trois conteneurs dans le Pacifique. Ils contenaient 28 000 canards, tortues, grenouilles, castors en plastique pour amuser les enfants dans leur baignoire. Ce fut une aubaine pour les spécialistes des courants marins. En effet, ces jouets de bain se retrouvèrent en Alaska, en Amérique du Sud, en Australie et même en Écosse. On calcula qu’il fallait trois ans pour boucler le circuit des courants marins. Surtout, « on se rendit compte que les océans étaient bel et bien tous reliés entre eux ». Ce qui donne raison à David Abulafia ! Ajoutons que l’ouvrage est joliment écrit.
Dans L’être et la mer, la philosophe Corine Pelluchon nous invite quant à elle à modifier notre point de vue sur notre condition. Reprenant les bases de l’existentialisme mais en en modifiant substantiellement la portée, elle pose la question : « Pouvons-nous accepter notre finitude si nous n’avons aucune idée de l’infini ? », et propose de penser notre condition humaine par l’intermédiaire de la mer. L’eau, comme l’existence, n’est pas rassurante, et témoigne du décalage entre notre moi et le fait d’être au monde. L’eau est « un élément de notre existence, mais aussi un milieu étranger et ambivalent ». La mer nous fait aussi sentir notre précarité : « Nous vivons d’eau mais nous ne vivons pas en elle. La mer n’est pas un milieu que nous pouvons habiter ». La mer est donc idéale pour penser notre existence : « Ainsi la plongée dans la mer était une plongée dans le sans-fond de l’existence, où l’on est face à soi-même et face à l’abîme ». Toutefois, elle n’est pas qu’une vaste étendue, indifférente et hostile, qui nous ferait sentir seulement notre insignifiance et notre néant.
Corine Pelluchon pointe ce qui est peut-être la faiblesse de l’existentialisme sartrien, qui postule la force d’une volonté capable de compenser une indétermination humaine fondamentale et un sentiment d’absurde pour s’arracher à une vie inauthentique et accéder à une conscience qui appelle à la liberté. Ce volontarisme, propre à l’existentialisme athée, est remplacé chez Corine Pelluchon, non par une transcendance divine comme chez Kierkegaard, mais par « un monde commun qui est composé de l’ensemble des générations ainsi que du patrimoine naturel et culturel et qui dépasse notre vie individuelle ». Or, ce monde commun n’est pas terrestre mais liquide : « La plupart du temps, nous voguons sur les flots, la direction que nous prenons nous faisant oublier la profondeur de l’abîme au-dessus duquel notre frêle esquif se déplace. Ainsi tout projet est une flottaison. […] Nous ne voyons que les vagues, ces ondulations que produisent les évènements au sein desquels notre histoire est mêlée à celle des autres, tout en demeurant dépendante des éléments ».
Le fait d’être ainsi « embarqué » n’empêche pas de prendre conscience, à partir de la découverte d’autres existants, de la « prodigieuse richesse du monde » et des « capacités d’adaptation des vivants ». Leur fragilité et la nôtre peuvent nous inciter à assumer nos responsabilités. C’est ici que prend toute sa valeur le sens de l’« existentialisme écologique » car, la mer étant la proie d’une multitude d’atteintes, il est urgent de la protéger. Si l’homme libre toujours chérira la mer, ces trois livres nous incitent à la connaître mieux et à la respecter davantage.