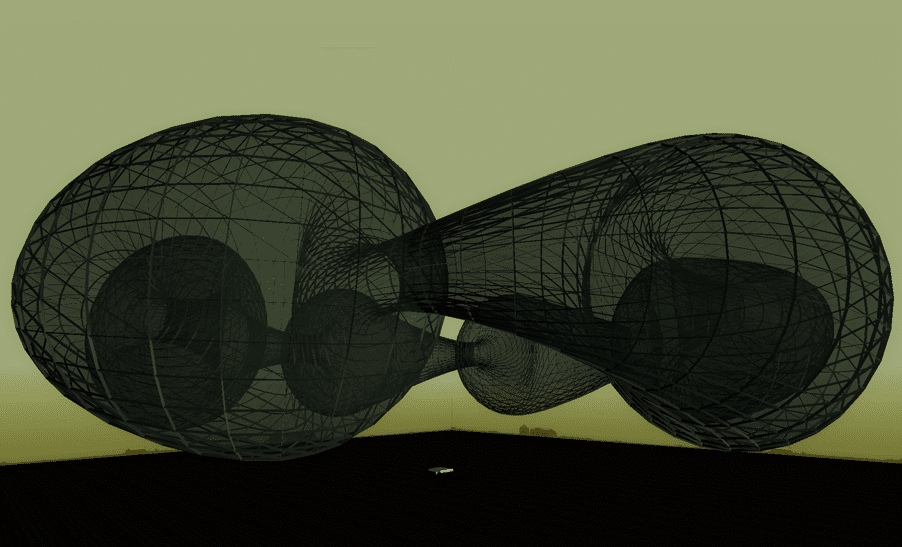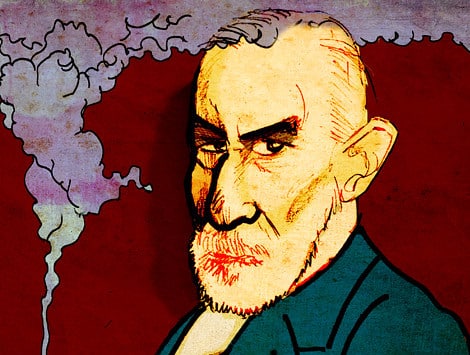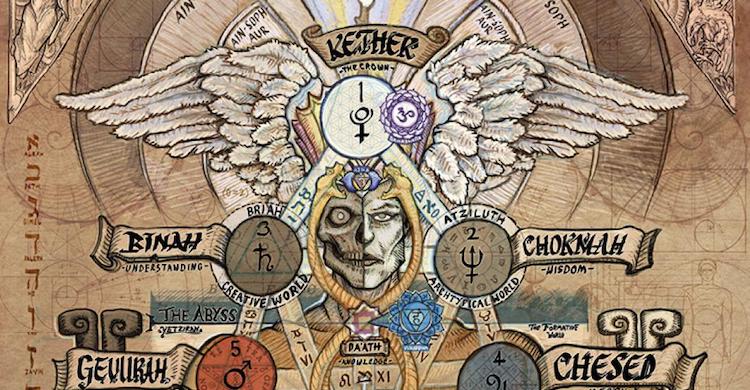Notre ami et collaborateur Michel Plon nous a quittés au milieu de l’été, le 6 août, à l’âge de 84 ans. Comme notre journal, la psychanalyse française aura été marquée par le passage de cet esprit éclectique et malicieux. Le psychanalyste Bertrand Ogilvie lui rend hommage en retraçant son parcours intellectuel.
C’est avec une grande tristesse que je me résigne à parler de Michel Plon, désormais, en son absence. Sa voix et son léger accent conservé du sud de la France, son humour et son ironie caustique, sa distance élégante à l’égard de tous les consensus trop rapides, son regard acéré sur la situation politique et culturelle, son sens des enjeux, sa manière d’aller chercher chez chacun de ses interlocuteurs et dans chacune de ses lectures le meilleur, l’angle incisif qui permettait de dégager une perspective, une ouverture, une avancée, son oreille toujours attentive, en alerte…. tout cela constituait son style propre, qui s’incarnait tant dans sa pratique d’analyste que dans ses différents écrits et dans les propos que nous échangions régulièrement.
Psychanalyste depuis les années 1980, il avait acquis son expérience clinique pendant dix-sept ans à la consultation de pédopsychiatrie de l’hôpital Casanova de Saint-Denis en compagnie de Claude Halmos, d’Alain et de Catherine Vanier. En 1988, il assuma une tâche de supervision à l’École expérimentale de la Neuville, prenant la succession de Françoise Dolto, et cette aventure dura une trentaine d’années. En tant qu’analyste, il participa à de nombreuses activités, rencontres, journées d’études, colloques, revues, animés par tout ce que le milieu analytique de ces années connaissait de plus créatif, mais il n’appartint à aucune association en particulier, tout en en fréquentant plusieurs. Bien loin d’être le signe d’un désengagement, cette familiarité à distance était l’expression même de tout le parcours intellectuel de Michel.
À l’origine chercheur puis directeur de recherche au CNRS, il associa toute sa vie des activités d’écoute analytique avec une intense activité d’écriture dans le domaine de la psychanalyse sans doute mais aussi de la littérature et de la politique. Cofondateur de la revue Essaim avec Éric Porge, il fut un collaborateur régulier de La Quinzaine littéraire, où Maurice Nadeau l’avait invité à suivre les parutions de psychanalyse, puis d’En attendant Nadeau, qui releva le défi de sa continuation. Il multiplia aussi les traductions de textes théoriques, historiques et littéraires à partir d’une langue qui lui était chère, l’italien. Fin connaisseur de cette civilisation, de sa culture comme de son histoire politique la plus récente, il représentait un véritable pont entre ces deux mondes si proches et à la fois si distincts.
C’est l’ouverture de sa culture qui lui permettait d’être aussi averti des urgences institutionnelles et intellectuelles, comme le montre sa participation à l’un des ouvrages clefs de l’histoire institutionnelle récente des rapports entre le monde de la « santé mentale » et les exigences gouvernementales, le Manifeste pour la psychanalyse (La Fabrique, 2010). Héroïquement, Michel y prenait le parti, dans la droite ligne des positions freudiennes, de dénoncer le non-sens de toute institutionnalisation pour la pratique de la psychanalyse, mais cela ne l’a pas empêché d’être sensible ensuite au danger de la diffusion hétérodoxe et aberrante, voire sectaire, de la référence au freudisme par des myriades de pratiques de développement personnel, dérive qui pose aujourd’hui, avec encore plus d’acuité, le problème que signalait déjà en son temps Serge Leclaire.

Le grand public le connaissait comme l’un des deux auteurs, avec Élisabeth Roudinesco, d’un Dictionnaire de la psychanalyse (Fayard) sans cesse réédité, qui avait fait date, après le grand classique Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. Ouvrage qui ajoutait à un examen renouvelé des concepts fondamentaux de cette pratique un nombre considérable de notices consacrées à l’histoire de son invention, aux auteurs de cette saga et au contexte historique qui l’avait vue naître. Au fondement de ce travail de mise à la disposition du public des repères fondamentaux de la psychanalyse, on pouvait trouver tout ce qui avait fait les axes de ses premières recherches. Auteur d’un livre remarqué, La théorie des jeux. Une politique de l’imaginaire, paru chez Maspero en 1976, il s’était inscrit au cœur du combat théorique de l’époque contre les formes les plus sophistiquées et les plus biaisées que la pensée conservatrice bourgeoise s’efforçait de déployer contre les avancées de la pensée critique. En politique, il s’agissait de rabattre Marx sur un humanisme de bon aloi. En théorie, il s’agissait de se passer de l’inconscient qui menaçait le primat de la conscience toujours prête à effacer de la scène publique les excès qui ne cessent de déborder la vie humaine.
Au carrefour de ces deux perspectives, Michel Plon, lecteur d’Althusser, compagnon de travail de Michel Pêcheux qui dans le même temps développait une des théories les plus originales du discours, auditeur de Lacan, repéra dans la « théorie des jeux » de von Neuman et Morgenstern, aujourd’hui quelque peu oubliée, mais toujours active souterrainement, les impasses et les impostures de ce projet de constituer un outil mathématique permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. Remontant à des intuitions leibniziennes, ce modèle d’analyse de tout comportement humain, individuel ou collectif comme d’un jeu opposant des partenaires et susceptibles d’être ramené à une série de « coups » et de « décisions » « rationnelles » faisait abstraction de la manipulation qui était à l’origine de l’ensemble du processus et qui reposait sur l’omniprésence invisible d’un maître du jeu qui s’effaçait dans le déploiement fantasmatique de ses calculs. C’est cet effacement que le livre de Plon analysait en montrant sa capacité à effacer d’un même geste l’antagonisme fondamental inhérent à toute société de classe, cette lutte-de-classes dont l’époque ne se privait pas de mettre en avant la puissance de détermination dans les processus sociaux et plus généralement dans l’Histoire, cette lutte entre « humeurs opposées » que Machiavel déjà avait analysée. Machiavel que Michel Plon lisait depuis longtemps et dont il avait traduit l’un de ses plus éminents commentateurs, Quentin Skinner.
À la lecture de ce livre, Lacan avait réagi. Dans une lettre adressée à Michel le 17 mai 1976 (conservée dans les archives d’Élisabeth Roudinesco), il faisait part de ses réserves. Habité lui-même par le souci de donner forme mathématique à sa théorie de l’inconscient, il voyait bien néanmoins que la « théorie de jeux » n’allait pas tout à fait dans la même direction. Mais il ne pouvait se résoudre à la situer du côté de l’imaginaire, fidèle qu’il était au galiléisme qui voit dans les « petites lettres » du livre de la Nature un texte qui finalement nous est destiné. Dans ce miroir que la science nous offre, par rapport auquel Michel Plon s’efforçait de montrer que la lutte politique était ce réel qui en griffe le tain, Lacan préférait situer « la lutte-des-classes » du côté de l’imaginaire (« c’est la lutte-des-classes qui devient le symptôme lié à mon imaginaire ») et concéder seulement à Michel que la cybernétique était une tentative de la bourgeoisie de se débarrasser de l’inconscient. Mais elle n’était pas seule tentée par ce déni : « La cybernétique, n’est pas de l’ordre de l’imaginaire, si mon idée d’imaginaire a quelque fonds. C’est plutôt une tentative de se débarrasser de l’inconscient – tentative non sans consistance. L’inconscient est poème […] Sans doute la précipitation de la bourgeoisie à happer la cybernétique est-elle liée à la tentation d’échapper au poème […] Ce qui ne veut pas dire que le prolétariat soit plus ouvert au poème ». Mettant sur le même plan tous les névrosés (névrosés de tous les pays, unissez-vous !?), il précisait : « Pour situer les choses « politiquement », l’inconscient est de l’ordre du petit capital. Les prolétaires ont des névroses, tout comme les bourgeois. Chez les eux [sic] comme chez les autres, j’ai ressenti l’inconscient comme un capital ». Aussi comme on le sait, ne croyait-il pas trop à la révolution. Ils avaient au fond raison tous les deux. « Vous avez un espoir. Moi pas. Votre Lacan. »
Espoir ? Plutôt qu’une opposition entre pessimisme et optimisme, sans grande pertinence conceptuelle (rappelons-nous la fameuse formule de Gramsci, auteur bien connu de Michel, qui s’efforçait de la court-circuiter en la dialectisant), il est plus intéressant de se demander ce qu’il est possible de reprendre et de prolonger aujourd’hui de ces analyses « situées ». Disons, pour faire court, qu’en effet la dimension de l’imaginaire continue de faire des ravages en politique en imposant la préoccupation obsédante de l’identité à celle de l’égalité. Ce qui montre certes que le prolétariat n’est pas « plus ouvert au poème ». Mais pas moins non plus. Pour longtemps ? Michel, à la fin de sa vie, était parfaitement conscient qu’il ne verrait pas l’issue de ce dilemme.
Bertrand Ogilvie est psychanalyste et professeur de philosophie émérite à l’université Paris 8.
Retrouvez les articles de Michel Plon.