Au XXIᵉ siècle, l’écologie telle qu’elle se conçoit dans les Nords s’est développée autour du « grand partage » entre nature et culture, théorie qui s’est largement imposée comme un nouveau postulat dans les débats contemporains. Pour comprendre les problématiques écologiques, leurs conséquences comme leurs genèses, il faut multiplier les approches, trouver les nœuds dans lesquels s’intriquent une multiplicité de systèmes de domination et d’exploitation. Explorons ici les propositions de la nouvelle revue Plurivers et des dossiers de Critique et Prismes.
Métavers, Multivers, les préfixes qui nous projettent dans des espaces autres, ailleurs et au-delà du monde terrestre donnent le vertige. La revue Plurivers, parue au printemps 2024, ne se range pas dans cette typologie. D’une certaine manière, le projet propose d’exploser la géographie de la théorie écologique, telle qu’elle a été définie depuis les Nords. La première page renverse les perspectives, le monde tel qu’on le représente en Europe est retourné. Les cartes et les territoires se redistribuent et l’œil doit s’y habituer. Plurivers promet d’orienter les déboussolé·es avec un « Guide de navigation » : pour penser l’écologie, il va falloir réapprendre à voir le monde, s’essayer à le lire différemment.
L’influence d’Édouard Glissant se fait sentir, ce qui signifie aussi qu’on ne trouvera pas de définition univoque du Plurivers. Aventurez-vous plutôt dans les pages, le mot se révèle dans la multitude des textes qu’accueille la revue. Tous convergent vers un projet commun, celui de proposer « une critique politique et épistémique de la modernité occidentale » où l’on pense depuis « un pluriversalisme qui prend en compte la multiplicité des façons d’être et de faire monde ».
Publiée par les éditions du commun qui s’associent à l’Observatoire Terre-Monde, la revue, dont le premier numéro est sorti en février 2024, se situe au croisement des disciplines et des espaces. L’écologie s’envisage au pluriel pour penser la diversité de ses enjeux. L’équipe éditoriale [1] donne le coup d’envoi en posant une première problématique : « Peut-on décoloniser le changement climatique ? ».
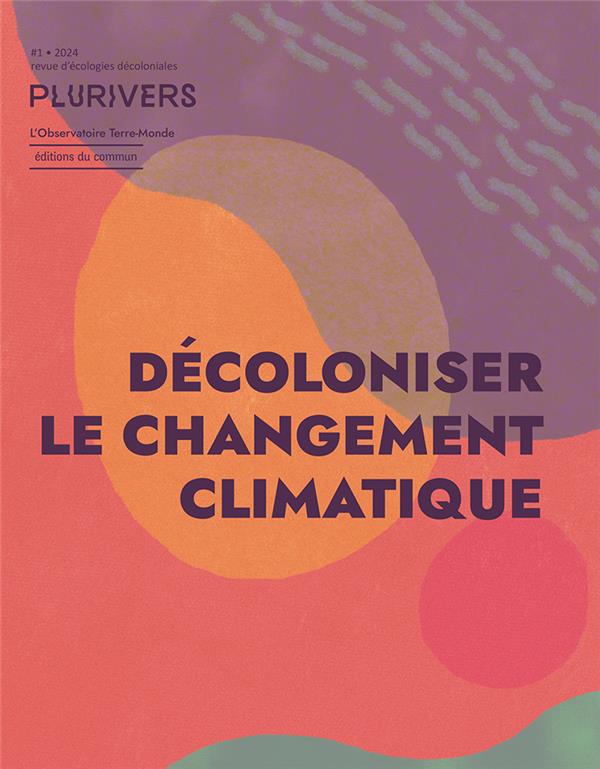
On comprend que la dimension éditoriale s’intègre à ces enjeux, ce qui fait de cet objet un lieu de recherche théorique et pratique de la « décolonisation épistémique ». Plurivers assemble des textes en français, en anglais, en espagnol et en créole et se met au défi au fil des livraisons de « permettre l’accès à un large lectorat tout en proposant un décentrement par rapport à l’usage des langues dominantes ». Les pages s’organisent selon un découpage particulier : une bande latérale est réservée aux références et les deux autres tiers au texte. S’il y a un côté pratique, on peut aussi le comprendre comme une manière de suivre la construction d’un discours, qui suit une progression accompagnée des auteur·ices et non pas par-dessus, comme un aboutissement.
Bien que le comité éditorial soit composé exclusivement de chercheur·euses relié·es à des universités occidentales, la revue essaie d’élargir les horizons au-delà de l’académie. Espace hybride, Plurivers pratique le métissage des formes de savoir, tout en maintenant une attention quant à la « positionnalité » des auteur.ices, qui se présentent dans un texte précédant chaque article.
Pour explorer les sujets que recouvre le thème du premier numéro, Plurivers interroge les rapports entre colonialité, justice et changement climatique, diffuse des témoignages sur les luttes face aux désastres climatiques coloniaux, notamment lors d’un entretien avec des activistes et chercheur·euses du collectif A4. La décolonialité et les réparations forment le dernier volet, où l’on rencontre la figure de Danyel Waro, chanteur et poète martiniquais et celle d’Arturo Escobar, chercheur et activiste colombien avec qui partager les façons de rêver dans le Plurivers. Les voix féminines et masculines alternent dans un équilibre que reflète la composition de l’équipe éditoriale.
La revue se veut être un processus, un espace d’essai pour enrichir les théories sur l’écologie depuis les perspectives qu’offre l’approche décoloniale. Un défi à relever pour sortir des oripeaux de la production de savoir académique et de ses relais dits « légitimes ». Dans le champ universitaire, elle pourrait être un lieu où renoueraient aussi les sciences humaines et sociales avec celles du vivant et des techniques. Et en dehors de l’académie, on espère découvrir des profils variés, sollicités dans la multitude de sphères que comprend la société.
Quoi qu’il en soit, Plurivers se distingue déjà dans le petit monde des revues écologiques et promet d’être un « lieu-commun », « un monde où il y a de la place pour plusieurs mondes ». Un projet palpable, localisable, et dont l’objet revue constitue déjà un pas dans le concret. L’Observatoire du décolonialisme a quelque chose à se mettre sous la dent, et il y a de la mâche.

Avec son titre rouge sur fond vert à en faire plisser les yeux, Prismes pose les jalons d’une théorie éco-critique. La première génération de l’école de Francfort est sur le pont aux côtés de Marx et de ses héritiers, pour chercher « un renouvellement écologique de la Théorie critique ». Partant du constat que les pensées marxistes et marxiennes restent sous-estimées dans la théorisation de l’écologie en Europe, on peut y lire la traduction d’un texte de Kohei Saito qui insiste sur le Marx botaniste et le concept de « métabolisme ». Agrémenté d’une riche bibliographie, ce numéro s’adresse aux initiés, mais, une fois refermé, on se dit qu’on devrait relire Le Capital, enfin, pour celles et ceux qui l’auraient déjà lu.
De son côté Critique examine la verve nouvelle avec laquelle l’écoféminisme fait son retour au début du XXIᵉ siècle. L’idée du « grand partage » dualiste entre nature et culture est remise sur le métier. Ainsi l’article de Germana Berlantini, qui coordonne le dossier, considère que les travaux de la sociologue Geneviève Pruvost, de Marta Mies et Veronica Bennholdt sur « le féminisme de subsistance » déplacent le dualisme entre nature et culture au profit d’une approche marxiste qui distingue nature et économie. Un article très bien construit pour saisir la genèse de ce mouvement, la place qu’il occupe dans le courant écoféministe et les objections qu’il impose à l’approche cosmologique de Latour et Descola. Le concept de cosmologie ne reste pas dans l’impasse de la métaphysique abstraite mais s’entend comme un « système d’intimité » au plus proche du travail domestique, des savoirs-faire et des usages. Si ces résultats ne sont pas applicables partout, ils rappellent à juste titre que les interdépendances sensibles entre humains et non-humains s’appréhendent dans leur contingence et leur contextualité.
Dans Prismes, un article revient sur l’idée latourienne qui posait l’impossibilité de penser une politique de la nature. Jean-Baptiste Vuillerod montre que des auteurs comme Adorno et Horkheimer n’établissaient pas une rupture stricte entre la société et la « nature », concept qu’il réinvestit pour ouvrir de nouveaux problèmes théoriques dont on a plaisir à suivre le cheminement. Sous un autre angle, Carl Cassegard réfléchit à la distinction entre dialectique et dualisme en organisant un dialogue autour des désaccords entre les éco-marxistes (Foster, Burkett) et les penseurs de l’école de Francfort (Adorno, Horkheimer). Ces deux auteurs font aussi l’objet d’une relecture pour essayer de penser la « domination de la nature » et des corps. Cependant, mais c’est aussi le propre de ces théories, on manque de voir de quels corps il s’agit, bien que l’on se doute qu’ils appartiennent aux strates exploitées. C’est ce qui fait l’intérêt des approches écoféministes et des contributions de Plurivers, qui se situent au croisement des systèmes de domination fondés sur le genre, la colonialité et la classe. L’écoféminisme se recycle aussi, un avertissement que formule Émilie Hache lorsqu’elle évoque sa récupération capitaliste dans un entretien pour Critique. Deux revues pour renouveler la problématisation de la crise climatique en essayant de se situer au plus près du monde visible, quotidien, minuscule comme nous invite à le faire Donna Haraway.
[1] Elle se compose d’Aude Chesnais, docteure en sociologie, Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS, Erwan Molinié, doctorant à Paris-Cité, Sela Sheikh, maîtresse de conférences en politique internationale, et Marie Thiann-Bo Morel, docteure en sociologie de l’environnement.












