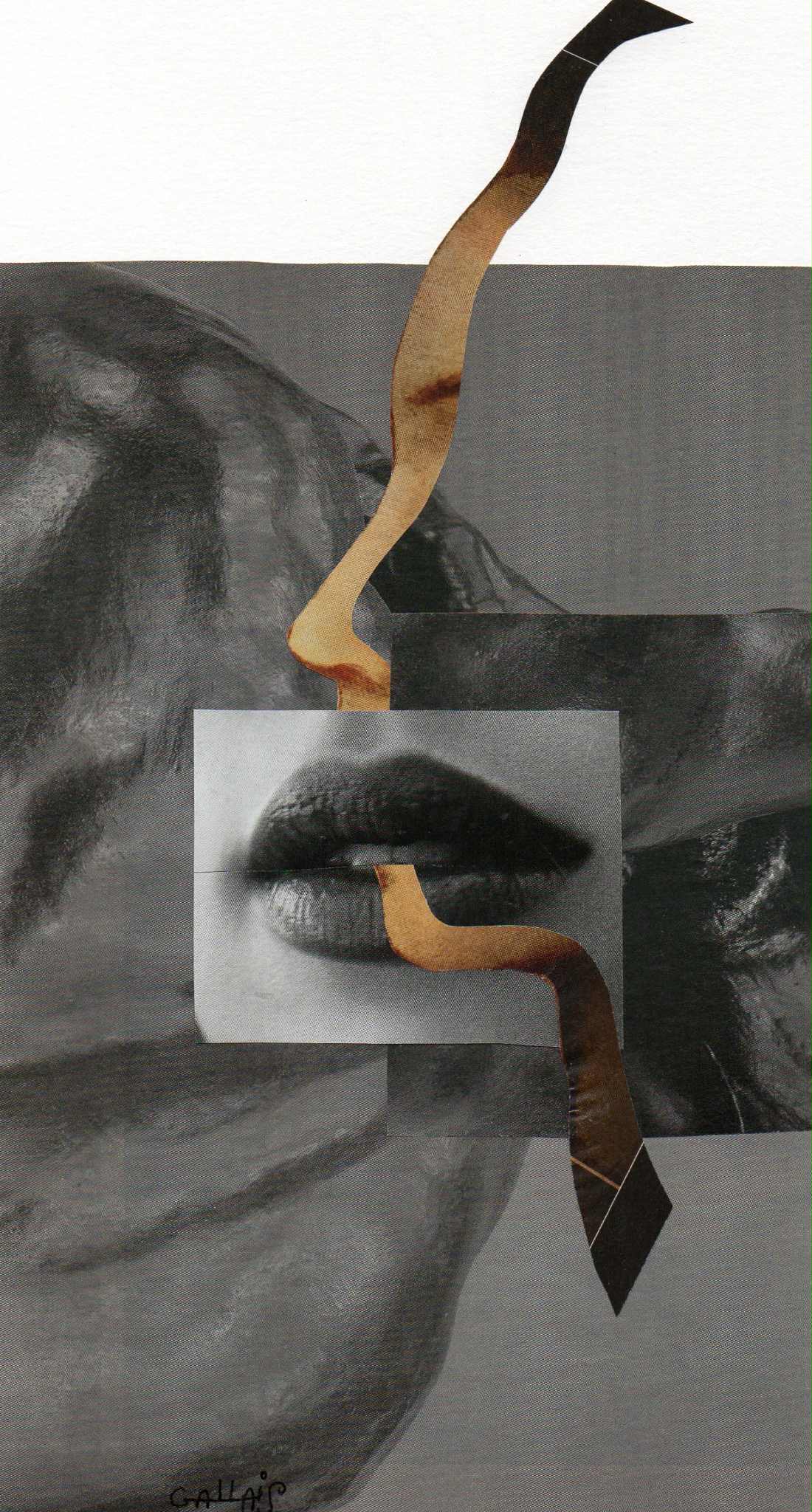Ouverte sous le signe de la tradition vue par Laurent Le Gall et Mannaïg Thomas, des mondes perdus étudiés par Annie Stora-Lamarre et de la vie surréaliste de François-René Simon, cette chronique en vient aux héros de Pierre Bayard et au paysan d’Édouard Morena.
Dans cette collection qui questionne les mots, la sélection des mots prend une importance décisive. Le choix de tradition pourrait sembler presque intrigant, à une époque où il semble faire moins polémique et trouver un peu partout des thuriféraires – gauche, droite, conservateurs, progressistes, publicitaires, décroissants : tout le monde investit la tradition. Laurent Le Gall et Mannaïg Thomas donnent au mot une profondeur qui est d’abord un brillant aperçu intellectuel et érudit, qui permet de saisir l’ampleur des débats ; notamment autour du binôme que la tradition a formé avec la modernité. En inquiétant l’évidence de l’opposition tradition/modernité à travers les pensées d’autrui, Le Gall et Thomas invitent à relire un nombre absolument vertigineux d’ouvrages pour faire rayonner les différents usages du mot tradition comme autant de pensées et de pratiques du temps. La récurrence de certaines références (Koselleck, Mauss) souligne ainsi la volonté de penser la tradition depuis la question du temps et de ses usages : ni tout à fait mémoire, ni pure invention, ni oralité ni écrit, histoire en aucun cas, la tradition se figure surtout dans les interstices ténus qui demeurent, une fois délaissés les espoirs d’une temporalité séparée par la théorie. La conclusion du livre, avec Aby Warburg, Ginzburg, Didi-Huberman, ouvre une piste de réflexion grosse de sens et pleine de confiance.
Mais Tradition n’est pas seulement la bibliographie raisonnée d’un concept auquel « nous sommes tous confrontés ». Il y a aussi dans le livre une analyse de certaines actualités artistiques, intellectuelles, politiques ou sociales, qui s’enrichissent de ce regard porté depuis la question de la tradition. La critique de l’exposition Nous les arbres à la fondation Cartier-Bresson en 2019-2020 est emblématique de cette dimension du livre, qui rappelle que « Le mot est faible » fournit avec force les moyens de dire autrement ce qui se vit aujourd’hui. Pierre Tenne
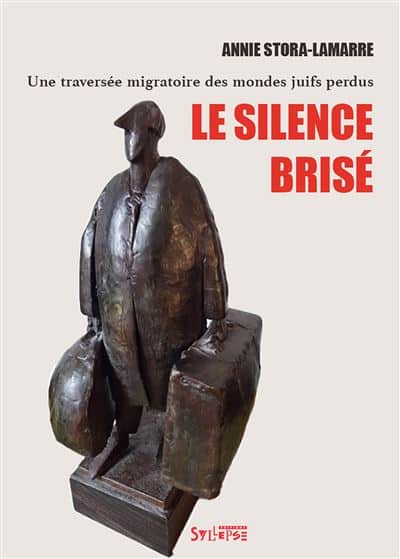
Annie Stora-Lamarre réexamine les vies des Juifs détaillées dans les enquêtes sociales concernant le monde des marginaux cher au XIXe siècle : le délinquant, le criminel, le vagabond. Dans cet herbier de l’anormalité, en toute fin de liste, apparaissait la figure de l’étranger. Retour donc dans les fichiers de la préfecture de police, vers ces « cosmopolites », ces « destructeurs » venus de ce monde juif, ces marchands et malfaisants venus répandre les germes de l’anarchie ou du socialisme.
En « remuant » les fichiers des Archives de la police de Paris, les dossiers de naturalisation traquent l’intrus. « Depuis combien de temps le postulant habite-t-il la France ? Quelles sont les localités où il a résidé successivement ? Sa conduite et sa moralité ont-elles donné lieu à quelques observations ? Jouit-il de la considération publique ? S’il est né en France, pour quel motif n’a-t-il pas satisfait à la loi du recrutement ? Le postulant a-t-il rendu quelques services publics ou accompli quelque acte de courage ou de dévouement de nature à justifier une remise totale du droit de Sceau ? Quelle est son attitude politique ? »
Grâce à cette subtile recherche, Annie Stora Lamarre nous fait découvrir tout un savoir sur les barrages et les façons de contourner les obstacles dans une culture d’intégration. À la suite des travaux précurseurs de Nancy Green et de David Weinberg [1], nous accédons certes à « l’enregistrement de la présentation de soi » – une violente épreuve – mais plus encore à une culture de l’adaptation et de l’inventivité pour se sortir des crocs policiers. Jean-François Laé
À l’heure où la célébration du premier Manifeste bat son plein, il sera profitable d’aller regarder du côté d’un des derniers témoins vivants de l’aventure surréaliste telle qu’elle s’est vécue collectivement (achevée officiellement, par « autodissolution » en 1969) et, donc, personnellement. Car ce que François-René Simon propose ici, ce n’est pas tant une histoire de la fin du mouvement surréaliste qu’une autobiographie, son « autobiographie depuis 1713 », ainsi que le livre est sous-titré, date cryptique où se cache, comme chacun sait, le monogramme d’André Breton.
Né en 1945, Simon a rencontré Breton en 1965, d’abord en tête à tête puis lors des réunions du groupe au café, enfin lors de vacances, l’été 1966, à Saint-Cirq-Lapopie. Dans cette autobiographie moins intellectuelle que sensible, passionnelle, Simon montre comment cette rencontre a déterminé sa vie, lui a donné son orientation : esthétique et morale, amicale et amoureuse. À travers souvenirs et anecdotes, mises au point et au besoin poings cognés sur les i (en revenant sur quelques polémiques qui ont émaillé la vie et la réception du mouvement), il donne ses mémoires qui ne sont pas seulement les siens, puisque le propre du surréalisme est d’avoir constitué une aventure collective et amicale, qui ne saurait cesser. C’est pourquoi l’autobiographie ici se décentre volontiers et l’autoportrait se dessine largement à travers sa relation à ses amis : à Breton et à tous les autres, d’Annie Le Brun à Jorge Camacho, en passant par Pierre Peuchmaurd, Alain Joubert… Ce qui rend plaisant la lecture de cet ouvrage, ce n’est pas seulement la masse d’informations qu’il contient, mais bien l’écriture elle-même : précise, subtile, drôle très souvent. L’humour de François-René Simon, tout en autodérision, nous montre et nous rend un homme extrêmement attachant. Un homme qui aura traversé l’histoire récente du surréalisme, mais que surtout le surréalisme aura traversé pour lui donner sa véritable consistance et faire de lui ce qu’il a été. Laurent Albarracin
Au départ et au cœur du livre, présenté comme « un exercice de pensée », il y a les guerres d’Italie, atroces, sans autre mobile que les appétits conquérants des rois, où ils ont tout perdu, y compris l’honneur allégué. Et une question : comment ce chevalier sans peur et sans reproche dont l’auteur se targue de descendre a-t-il pu tuer autant d’hommes, bravant l’interdit du Décalogue, et étouffer sa conscience de chrétien ?
Pierre Bayard rejette les thèses évolutionnistes qui expliqueraient la chose par un défaut d’individualisation, d’empathie, comme si les sentiments humains n’existaient pas avant la Renaissance, et entreprend de démontrer le contraire à l’aide des textes littéraires qui ont formé les principes courtois et chevaleresques médiévaux. Par le biais d’un personnage-délégué, frère cadet du chevalier devenu moine bénédictin, il complète les propos de son ancêtre putatif par des interpolations dans le style et l’orthographe archaïque de sa source principale, Jacques de Mailles, qui fut le compagnon d’armes et le secrétaire du chevalier. Procédé astucieux – irritant ou stimulant, chacun en jugera.
Dans Les enfants du Bon Dieu d’Antoine Blondin, un professeur d’histoire, las d’enseigner chaque année les mêmes faits aux mêmes dates du calendrier scolaire, décidait un jour de ne pas signer le traité de Westphalie, et réorientait l’histoire de l’Europe. Le moine opère le même coup de force quand son héros connaît un conflit de loyauté : doit-il rompre son allégeance ou rester fidèle au roi qui a commis une grave injustice ? Le Bayard de cet univers alternatif suit son ami trahi, le connétable de Bourbon, et se rallie à Charles Quint. Ainsi, quand le connétable est tué, c’est Bayard qui reprend le contrôle de l’armée, et empêche le terrible sac de Rome par les troupes impériales. Résultat, nombre de vies humaines et d’œuvres d’art sont épargnées, et il n’y a plus lieu de commander à Michel-Ange la fresque de la Chapelle Sixtine. Dominique Goy-Blanquet
En janvier dernier, une « crise paysanne » soulevait le pays, marquée par les blocages d’autoroutes et des interventions violentes dans certaines régions. Soutenu aussi bien par la FNSEA que par la Confédération paysanne, avec le soutien explicite de Gérald Darmanin (« On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS »), ce mouvement était caractérisé par les multiples contradictions qui traversent un monde paysan qui, bien sûr, n’a jamais existé dans l’univocité que lui attribuent sans cesse d’autres – politiques, universitaires, journalistes.
Édouard Morena a consacré son travail de doctorat à la Confédération paysanne, dans lequel il soulignait entre autres les quiproquos autour de la Conf’ et de ses représentants (José Bové, en premier lieu), dont il montre que les malentendus caractérisent en réalité la figure même du paysan. Le paysan est l’autre codé par une modernité toujours moins paysanne, agricole, ou rurale. Les chapitres historiques montrent l’ancienneté et la profusion de signifiants attachés au fur et à mesure des siècles au paysan : peu civilisé, gardien de l’authenticité voire de la nation, résistant au délitement de certains progrès, de droite puis de gauche puis de droite ou tout cela en même temps. L’aperçu historique donné par ce livre bref – c’est l’un des principes de la collection « Le mot est faible » – permet de mesurer la volatilité des affects qui s’y cristallisent. Les manifestations paysannes de 2024 ont montré, comme le souligne Édouard Morena, à quel point la polysémie du terme reste actuelle et toujours actualisée.
La conclusion du livre veut que le mot paysan soit inappropriable et inapproprié. Surtout, son usage relève, à lire Édouard Morena, de l’impropre : plaqué sur une myriade de réalités qu’il obscurcit, le mot paysan rejette le débat dans un fantasme à prétention réaliste dont les effets sont des plus indésirables. Dans le contexte combiné d’effondrement politique et écologique qui marque l’actualité, le terme de « paysan » devrait effectivement être plus collectivement interrogé : c’est l’un des intérêts premiers de ce livre que de faire la démonstration de cette nécessité. Pierre Tenne
[1] Nancy Green, Les travailleurs immigrés juifs à la Belle Époque. « Le Pletzl » de Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 1985 ; David Weinberg, Les Juifs à Paris de 1933 à 1933, Calmann-Lévy, 1974