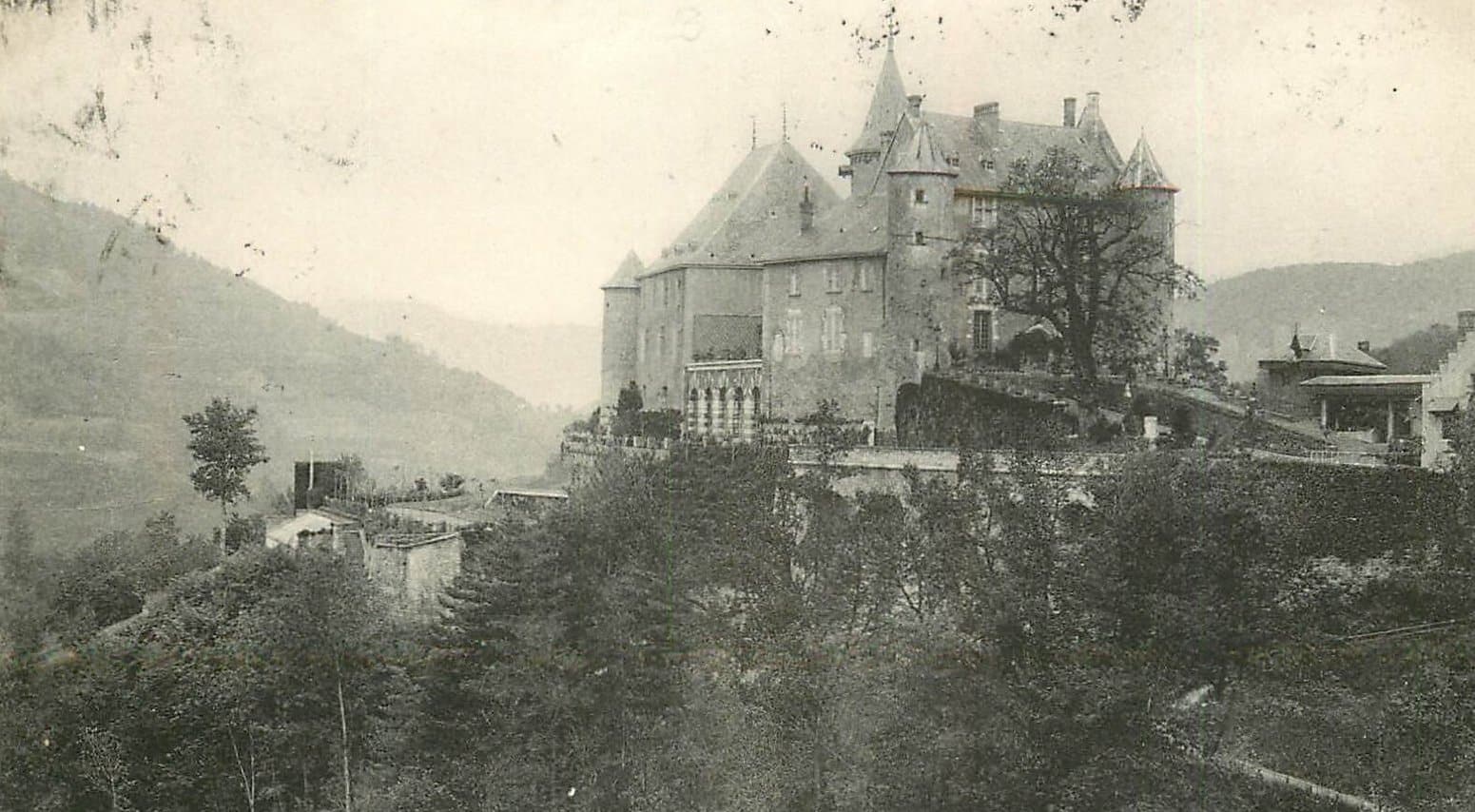Il arrive parfois que de célèbres thèses philosophiques, souvent oublieuses de leurs limites linguistiques, sociales, géographiques et épistémiques, deviennent des erreurs universelles… quasi indiscutées. L’assertion bien connue de Michel Foucault selon laquelle l’homme, en tant que dispositif conceptuel, serait une invention européenne des confins des XVIIIe et XIXe siècles, est un exemple d’un certain eurocentrisme en philosophie auquel la critique s’intéresse peu. Renversant cette thèse, l’historien Houari Touati démontre dans son nouveau livre que l’homme, après sa disparition aux lisières de l’antiquité tardo-antique, a été réinventé à Bagdad, sous les premiers califes abbassides, dans un contexte marqué par « la plus grande translation scientifique et philosophique jamais réalisée aux époques prémodernes ». Le concept de l’homme posséderait deux faces : l’une grecque, l’autre arabe. Auteur de nombreux travaux sur la civilisation des pays d’Islam et directeur de la revue Studia Islamica, Houari Touati répond à nos questions sur ce chapitre méconnu de l’histoire des idées.
La thèse de votre livre est forte, probablement inédite dans l’histoire des idées et de la philosophie. Pouvez-vous nous expliquer l’arrivée de l’homme, à la fin du VIIIe siècle, d’Athènes à Bagdad, par le truchement d’Alexandrie ?
Dimitri Gutas, qui est l’un des meilleurs connaisseurs du mouvement de traduction gréco-arabe, a expliqué que c’est l’intérêt des Abbassides pour l’astrologie, qu’ils ont conçue comme une science politique, qui les a conduits à s’approprier l’héritage philosophique et scientifique grec. Je ne conteste pas cette hypothèse, mais on ne peut attribuer à un phénomène aussi complexe une seule et unique cause, d’autant que parmi les plus grands philosophes de langue arabe la plupart ont contesté à l’astrologie sa validité scientifique. En outre, dans une culture où le poids de la classe religieuse était considérable, on ne pouvait se lancer dans une entreprise aussi risquée sans l’appui d’une partie au moins de ses membres les plus influents. Et c’est ce qu’ont fait les théologiens rationalistes dont l’État ne pouvait se passer dans un empire multiethnique et multiconfessionnel et dont les communautés savantes non musulmanes étaient particulièrement dynamiques. On peut donc émettre l’idée que la translatio studiorum (naql al-‘ulūm) a également joué son rôle, d’autant qu’elle n’est pas sans lien avec la translatio imperii (naql al-mulk). Or ces théologiens rationalistes avaient besoin d’une théorie de la physique – la plupart ont adhéré à l’atomisme –, mais également d’une théorie de l’homme.
Ils ont trouvé l’une et l’autre chez les Grecs. Dans leur théodicée d’un Dieu juste et bon, l’homme doit user de son principe de raison pour connaître ce Dieu et le reconnaître en tant qu’il est l’Artisan de l’univers, autre concept grec, comme il peut ne pas le faire, et c’est son choix. Dieu n’y peut rien. Il ne peut contraindre l’homme à l’aimer sous peine d’attenter à sa rationalité et à sa capacité. C’est ce que les mutazilites ont défendu à l’appui de cette définition de l’homme, qui fait de lui le « vivant capable » (al-ḥayy al-mustaṭī‘). On a là deux concepts clés de l’anthropologie des mutazilites : la vie et la capacité qu’ils n’ont pu développer qu’en philosophant, ce qu’ils ne pouvaient faire qu’en s’hellénisant. Voilà pourquoi, lorsque la philosophie grecque est arrivée en terre d’Islam, c’est sur le site de la théologie rationnelle qu’elle fut accueillie, avant que le « philosopher » (tafalsuf) – concept forgé au Xe siècle – ne se professionnalise, en requérant une classe d’experts.

Tout semble s’être joué en Irak, entre Bagdad et Samarra, dans le cercle du « philosophe des Arabes » al-Kindî (mort en 873), lequel a réuni un grand nombre de philosophes, de scientifiques et de traducteurs de différentes confessions et nationalités et dont le projet fut de reconstituer le curriculum d’étude de la philosophie telle qu’elle était enseignée dans les écoles philosophiques d’Athènes et d’Alexandrie à l’époque tardo-antique. Il s’agissait bien de restaurer le curriculum de la philosophie, car dans son intégralité il était tombé en désuétude depuis le VIe siècle. C’est dans ce nouveau contexte que l’homme venant de Grèce est accueilli sur un site propre qui lui est dédié et qui l’émancipe de la théologie. Se démarquant des théologiens rationalistes, les philosophes ont contesté que l’homme pût être défini par sa capacité. Car pour être capable, et disposer par là même du libre arbitre, il faut être doué de raison. Mais l’homme est par ailleurs un animal qui vient au monde nu (ārin), il lui faut par conséquent un mode de vie lui permettant d’« habiller » sa nudité, c’est-à-dire d’assurer sa viabilité, et d’actualiser une raison qu’il ne possède somme toute qu’en puissance. Alors ces mêmes philosophes ont considéré que la rationalité et la politicité (madaniyya) étaient ce qui le fondait le mieux.
Vous parlez dans votre livre de la cristallisation d’une science de l’homme (‘ilm insānī [عِلم إِنساني]) dans les contextes arabe et islamique. Quelle est la singularité de cette science ? Que disait-elle du propre de l’être humain ?
L’innovation a en effet consisté à réunir les différents discours philosophiques et scientifiques sur l’homme dans une même configuration épistémique à laquelle al-Kindî et ses amis ont donné le nom de « sciences humaines » au pluriel, pour mettre l’accent sur leur multiplicité, et de science humaine au singulier, pour en souligner l’unité. Il s’agit d’une innovation majeure. Pour la première fois, on a parlé de sciences humaines. Le concept était ignoré des Grecs : d’Aristote à Galien, en passant par leurs commentateurs et continuateurs, les philosophes et savants grecs ont parlé uniquement de « choses humaines » et de « choses divines » pour en faire l’objet de la philosophie. C’est ce qu’ont fait les premiers philosophes de langue arabe. Or, ce n’est pas la même chose que de parler de sciences humaines. Car il s’agit non seulement de faire l’inventaire de ces sciences mais aussi de les adosser à un régime d’empiricité en mesure de décrire l’homme à travers ses différents dispositifs discursifs : l’embryologie, la physionomie, la physiognomonie, la psychologie, l’éthique, la science politique, l’astrologie, la géographie, etc. Il s’agit chaque fois de bâtir un savoir duquel émerge l’homme en tant que dispositif conceptuel.
La partie la plus intéressante de ce savoir est empirique ou expérimentale. À l’appui des paradigmes explicatifs de l’hippocratisme et de l’aristotélisme, les géographes sont sans doute ceux qui ont poussé le plus loin la recherche empirique en voyageant et en usant de l’autopsie (‘iyān), c’est-à-dire de l’observation directe, de préférence visuelle, pour produire un savoir inédit et vérifiable selon des procédures éprouvées d’attestation du dire-vrai validées par l’épistémologie légale. L’expérimentation n’est pas en reste : afin de contester Aristote, pour qui seuls les mâles humains émettent du sperme et sont par conséquent principe actif de la génération et de la reproduction de l’espèce, au contraire des femelles humaines qui n’en ont pas et qui ne contribuent à la reproduction que par leur matière menstruelle, et Galien, qui admet comme Hippocrate qu’elles produisent du sperme, mais qui considère comme Aristote qu’elles sont froides alors qu’ils sont chauds, le philosophe et médecin Razès s’est livré à des expériences physiques pour montrer que les femmes sont aussi chaudes que les hommes. L’explication physiologique a des conséquences éthiques que Razès n’a pas manqué de rappeler à un théologien ismaélien refusant aux hommes d’être semblables les uns aux autres et aux femmes d’être capables de philosopher. Ces sciences de l’homme ne sont évidemment pas les nôtres, mais le principe qui les gouverne n’en est pas moins resté inchangé. Car l’homme n’existe pas sans les sciences qui le fondent et l’historicisent.
Comment les philosophes et théologiens arabes expliquaient-ils le rire chez l’être humain ?
Parmi les passions, le rire est la grande affaire de l’homme. Ainsi en ont décidé les logiciens grecs suivis par leurs émules arabes, en distinguant la définition substantielle de l’homme de sa définition descriptive dont la plus connue est celle qui fait du rire le propre de l’homme : il est le seul animal qui rit. Mais pourquoi est-il le seul animal qui puisse rire ? Des deux éléments constitutifs de l’homme, quel est celui qui en est le déclencheur : le corps ou l’âme ? Quid de la physiologie du rire ? Comment opère-t-elle ? Par le chatouillement uniquement ? Mais rire, c’est aussi parfois pleurer, qui semble également le propre de l’homme : pourquoi et comment le rire en vient à s’accompagner de larmes ? Et s’il y a une psychologie du rire, comment se peut-il qu’il soit un acte psychique ? C’est ainsi que des questionnaires anthropologiques ont pu se constituer parce que « l’homme est devenu un problème pour l’homme », selon l’heureuse formule de l’écrivain philosophique irakien de la fin du Xe siècle al-Tawḥîdî, qui a laissé l’un des plus importants questionnaires philosophico-anthropologiques que l’on connaisse à l’époque prémoderne.

Mais il semble que le rire ait d’abord été l’affaire des théologiens. En réponse aux exégètes littéralistes du Coran qui ont soutenu que Dieu rit aussi bien que l’homme, opinion validée par la théologie traditionnelle d’al-Ash‘arî, les théologiens rationalistes ont rétorqué que Dieu ne peut rire, car le rire est humain. Seuls les hommes disposent d’un appareil phonatoire et respiratoire rendant mécaniquement possible leur rire. En outre, Dieu ne rit pas parce qu’il ne s’étonne pas. Seul l’homme jouit de cette capacité d’étonnement. De toutes les espèces animales, il est la seule à disposer d’un logos (nuṭq) psychique et discursif. Pour la première fois, le rire a sa théorie. Ni Aristote, ni Alexandre d’Aphrodise, ni Galien, ni le pseudo-Proclus (Aetius), qui se sont penchés sur la question, n’ont pu résoudre son énigme. Et encore moins Cicéron et Quintilien : alors que l’un et l’autre ont soulevé la question, ils se sont abstenus d’y répondre. Cette théorie du rire l’associant à l’étonnement (ta‘ajjub) est ensuite adoptée par les philosophes et les médecins de langue arabe, avant de parvenir à l’Europe latine à travers Avicenne notamment. Le ta‘ajjub est devenu l’admiratio. Mais il semble que les scolastiques latins ne lui aient guère prêté attention. Il faut attendre la Renaissance pour en retrouver réception. Le médecin humaniste italien du XVIe siècle Girolamo Fracastoro est le premier érudit européen à l’exposer dans son De sympathia (1550). Mais c’est à travers Descartes et Hobbes qu’elle s’est répandue dans la culture européenne. Voilà pourquoi, en plus d’être grec, l’homme est arabe.
Qui était al-Ash‘arî ? Pouvez-vous nous expliquer comment, à partir du Xe siècle, ce théologien et ses disciples ont vidé le concept de l’homme de sa substance, à savoir celle d’un « être rationnel et mortel », pour les philosophes, et d’un « vivant capable », pour les mutazilites ?
Ash‘arî est le fondateur d’une école théologique traditionnelle, qui existe encore de nos jours et prédomine dans le sunnisme, l’islam majoritaire. Il a appartenu à l’école théologique mutazilite de Basra, son foyer de naissance, avant de s’en séparer, à la suite d’une grave crise de succession survenue à la fin du IXe siècle. Sa critique la plus féroce a porté sur l’anthropologie, qui dépouillerait l’homme de toute consistance qu’il tirerait de lui-même. Alors il a contesté que l’homme puisse être l’animal raisonnable mortel comme disaient les philosophes et rejeté qu’on le définisse par sa vie et sa capacité comme le soutenaient les théologiens mutazilites. Aux uns et aux autres, il a répondu par une théorie de l’« acquisition » (kasb) dans laquelle c’est Dieu qui crée les actes humains et c’est l’homme qui les acquiert, de façon que l’agentivité humaine n’appartienne qu’à Dieu par cela même que, si l’homme venait à être agent de ses actes, il se substituerait à son créateur. Les mutazilites ont répliqué en assimilant cette théorie de l’acquisition à la théorie de la « contrainte divine » (jabr) des partisans du déterminisme fataliste. Théorie selon laquelle l’homme n’est rien de plus qu’une feuille que le vent fait tourbillonner au gré de ses mouvements capricieux. Certains théologiens ash‘arites ont fini par se convaincre de cette proximité doctrinale avec ces fatalistes appelés jabrites. Ils se sont employés à corriger la théorie du maître, mais les plus hardis sont allés jusqu’à considérer que les actes volontaires humains n’ont pas un mais deux agents : Dieu et l’homme. Ils n’ont pas été suivis. La plupart des ash‘arites s’en sont tenus à la théorie de l’agir humain professée par le fondateur de leur école. Cette tendance dominante de la théologie traditionnelle a fini par imposer son hégémonie et évincer le mutazilisme en même temps qu’à exercer de telles pressions sur la philosophie – avant et après Ghazali – que l’homme, qui était entré en Islam par la porte de la théologie, en est sorti par cette même porte. Alors les détracteurs de l’homme en Islam ont annoncé sa mort.
De quelle manière les penseurs de la Nahda (Renaissance) au XIXe siècle ont-ils pensé et critiqué la « disparition de l’homme » en Islam ? Ont-ils proposé une « renaissance de l’homme », en fidélité aux idéaux humanistes et pluralistes de la Bagdad du VIIIe siècle ?
La Nahda est un grand mouvement culturel et intellectuel, avec deux versants, l’un profane et l’autre religieux. Il s’est assigné pour mission historique de faire sortir les peuples de l’Islam, arabes et non arabes, de leur « sommeil » comme on disait en cette époque qui va de la fin du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale pour certains, au début de la Seconde pour d’autres. Un mouvement littéraire en est issu, qui a perduré, mais les réformistes modernistes n’ont pas su ou pu s’imposer aux réformistes religieux, qui ont pris le dessus. La question de l’homme n’en est pas moins venue à se poser dans ce contexte d’effervescence intellectuelle, culturelle et politique, notamment parce qu’il fallait arracher l’islam à l’idée de fatalisme à laquelle l’Europe coloniale l’avait associé. Ce fut le grand combat de deux hommes : un Persan, Jamal al-Din al-Afghani, et un Égyptien, Muhammad ‘Abduh. Mais en matière de théologie, c’est le second qui fut le plus hardi des deux. Al-Afghani s’en est tenu à une conception néo-ash‘arite de l’homme ; mais c’est ce qu’avait professé ‘Abduh, avant de prendre des positions qui l’ont rapproché du mutazilisme. Une crise doctrinale a secoué le réformisme religieux, qui est résorbée par le disciple et successeur de ‘Abduh à la tête du mouvement : le Syrien Rashid Rida. Non sans provoquer une sorte de contre-réforme. Car pour réinstaurer l’orthodoxie ash‘arite – dont il a répandu l’antihumanisme à travers sa revue al-Manar et son commentaire du Coran –, il a dû s’en prendre, à la mort de son maître, à son Traité de théologie en l’expurgeant de toute trace de mutazilisme.
Le réformisme religieux a sombré dans le salafisme, avant de se diluer dans l’idéologie politico-religieuse des Frères musulmans et de faire jonction avec le wahhabisme qu’il n’a pu réhabiliter qu’avec les conséquences qui secouent encore le monde de leurs convulsions. Il y a bien eu ensuite des intellectuels musulmans pour renouer avec le réformisme humaniste de ‘Abduh, mais peu nombreux sont ceux qui ont osé s’affranchir de l’ash‘arisme et affirmer sans ambages l’agentivité de l’homme ainsi que son libre arbitre, en tenant l’un et l’autre pour gage de son autonomie – si relative soit-elle – et de sa responsabilité morale, dans la mesure où elle est de l’espèce qui s’exerce indistinctement vis-à-vis de soi et de ses semblables.




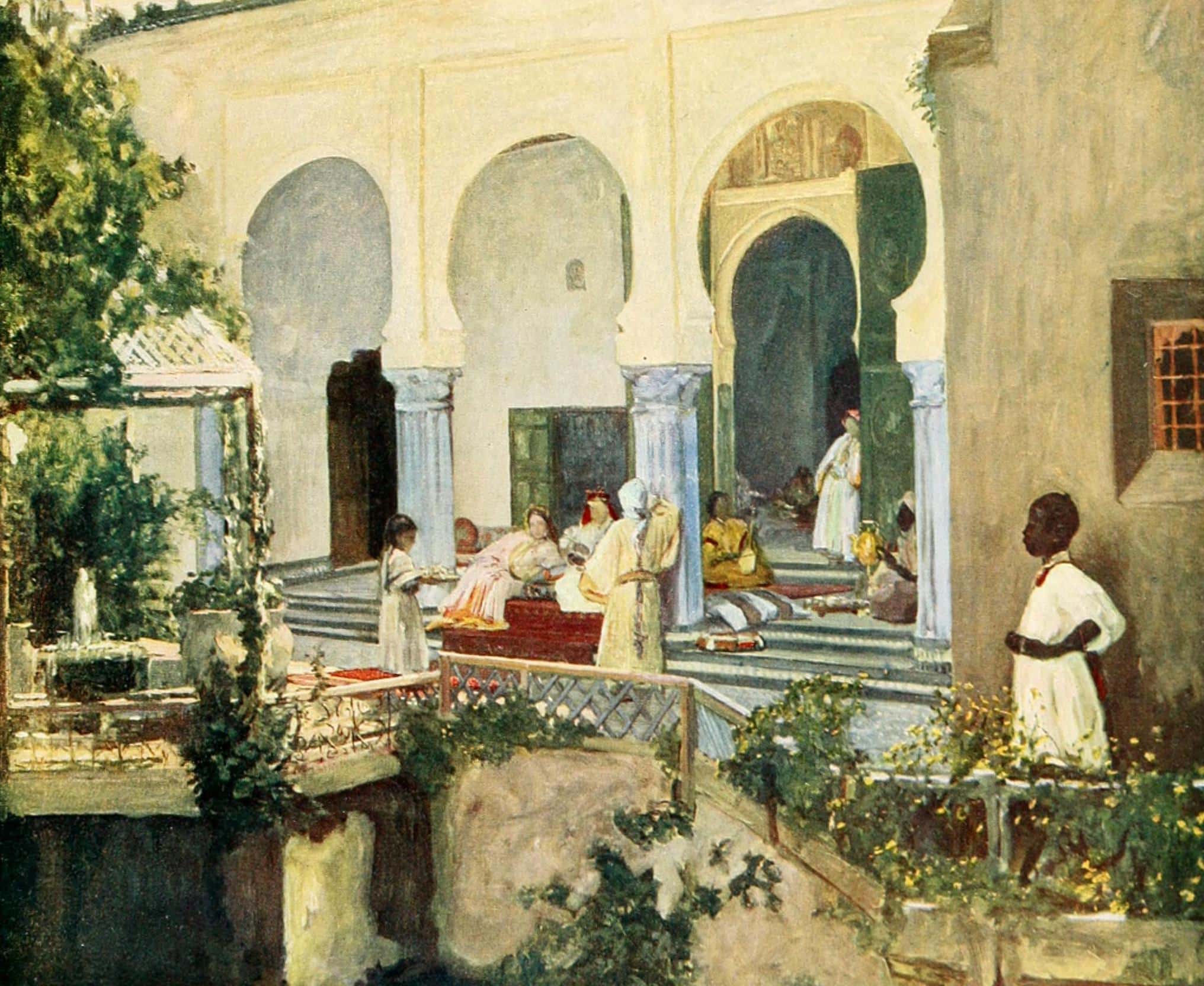

![Theodor W. Adorno, Trois études sur Hegel [1970], tr. de l’allemand par le Groupe du Collège international de philosophie, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 168 p. Theodor W. Adorno, La « Critique de la raison pure » de Kant [1959], tr. de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 540 p. Theodor W. Adorno, Leçons sur l’histoire et sur la liberté (1964-1965),](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/11/Paul_Klee_Seiltanzer_1923.jpg)